
par jbentolopes | 30 octobre 2022 | TBS Press
Alors que les investissements reposaient principalement sur des indicateurs de rendement et de risque financier, la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) marque une nouvelle étape pour les acteurs des marchés financiers en matière de prise en compte des environnementaux et sociaux dans l‘investissement.
Qu’est-ce que la SFDR et quels sont ses objectifs ?
La transition écologique vers une économie peu carbonée et respectueuse de l’environnement nécessite une coopération de tous les acteurs de la société : entreprises, citoyens, secteur public et marchés financiers. Depuis le 8 mars 2021, la réglementation SFDR vient transformer le fonctionnement des marchés financiers de l’Union européenne pour accélérer justement la transition écologique à travers la finance durable.
Transparence
Le premier volet de la SFDR concerne la publication d’informations qui permettent d’évaluer la durabilité et l’impact extra-financier des investissements.
Il s’agit ici d’obliger les acteurs financiers à communiquer de manière transparente sur les risques et les impacts concernant la durabilité des investissements.
L’objectif du règlement SFDR : faciliter l’orientation des flux financiers vers des placements plus responsables et durables.
Classification
Le deuxième volet concerne la classification des acteurs financiers selon des critères éthiques. Elle met notamment en avant les sociétés de gestion qui sont les plus avancées en matière de critères ESG, ie qui proposent les produits les plus éthiques.
L’objectif du règlement SFDR : permettre de classifier les acteurs financiers selon les types d’investissements et de produits qu’elles proposent.
Qu’est-ce qu’un investissement durable selon la SFDR ?
Les 4 critères principaux
Selon la SFDR, un investissement durable est un investissement dans une activité économique qui :
- Contribue à un objectif environnemental
Le règlement SFDR comptabilise 5 objectifs environnementaux en matière :
– D’utilisation efficace des ressources
– De production de déchets
– D’émissions de GES
– D’effets sur la biodiversité
– D’effets sur l’économie circulaire
- Contribue à l’amélioration du capital humain
On parle par exemple d’un investissement dans la formation des salariés.
- Participe à l’amélioration de la vie des communautés économiquement ou socialement défavorisées.
- Contribue à un objectif social
En favorisant : l’intégration sociale, la cohésion sociale, les relations au travail ou encore la lutte contre les inégalités.
Le principe DNSH et le principe de bonne gouvernance
Par ailleurs, un investissement est durable lorsqu’il respecte le principe DNSH (Do Not Significantly Harm) et le principe de bonne gouvernance.
Le principe DNSH, c’est le principe selon lequel une activité durable ne doit pas causer de préjudice important à un autre objectif durable (environnemental). Concrètement, cela veut dire que si une activité est considérée comme durable en elle-même mais qu’elle a des effets négatifs sur un des objectifs environnementaux énumérés juste au-dessus, alors elle n’est pas considérée comme DNSH.
Concernant le principe de bonne gouvernance, cela veut dire qu’avant d’investir dans un projet, un fond doit mettre en place une politique d’appréciation de la bonne gouvernance des sociétés dans lesquelles il souhaite investir.
SFDR : quels sont les grands changements qu’elle implique ?
Le reporting et la publication d’informations sur des critères de durabilité
Pour intégrer la SFDR, les acteurs concernés sont dans l’obligation de fournir des informations sur deux facteurs essentiels : les risques en matière de durabilité et les principales incidences négatives.
Ainsi, en plus des rendements et des risques, les investisseurs, analystes et conseillers financiers doivent s’intéresser aux impacts environnementaux / sociaux que peut avoir un investissement.
En fait la SFDR vient rendre plus formelle et comparable l’agrégation des différents impacts sur l’environnement des projets dans lesquels investir.
L’identification des produits d’investissement
L’application du règlement SFDR implique la classification des fonds et des produits proposés par ces fonds en trois catégories. Avec ce règlement, tous les fonds d’investissement doivent indiquer la manière dont les critères ESG sont intégrés dans les produits financiers.
Les fonds article 9
On retrouve ici tous les produits qui poursuivent un objectif d’investissement durable. Il s’agit donc des investissements les plus vertueux : ceux qui visent à réduire les impacts négatifs sur l’aspect Environnemental, Social et de Gouvernance. Ces produits intègrent le respect des droits de l’Homme et la lutte contre la corruption.
Ces fonds peuvent par exemple avoir pour objectif de favoriser la transition bas-carbone ou de favoriser le bien-être au travail.
Les fonds article 8
Ici sont regroupés les regroupés les produits qui ne poursuivent pas directement un objectif d’investissement durable mais qui intègrent les critères ESG dans leur démarche.
Les fonds article 6
Cette catégorie regroupe tous les autres produits dits “classiques”. Il s’agit en fait des produits qui n’ont pas de démarche ESG.
Par Alise DURAND
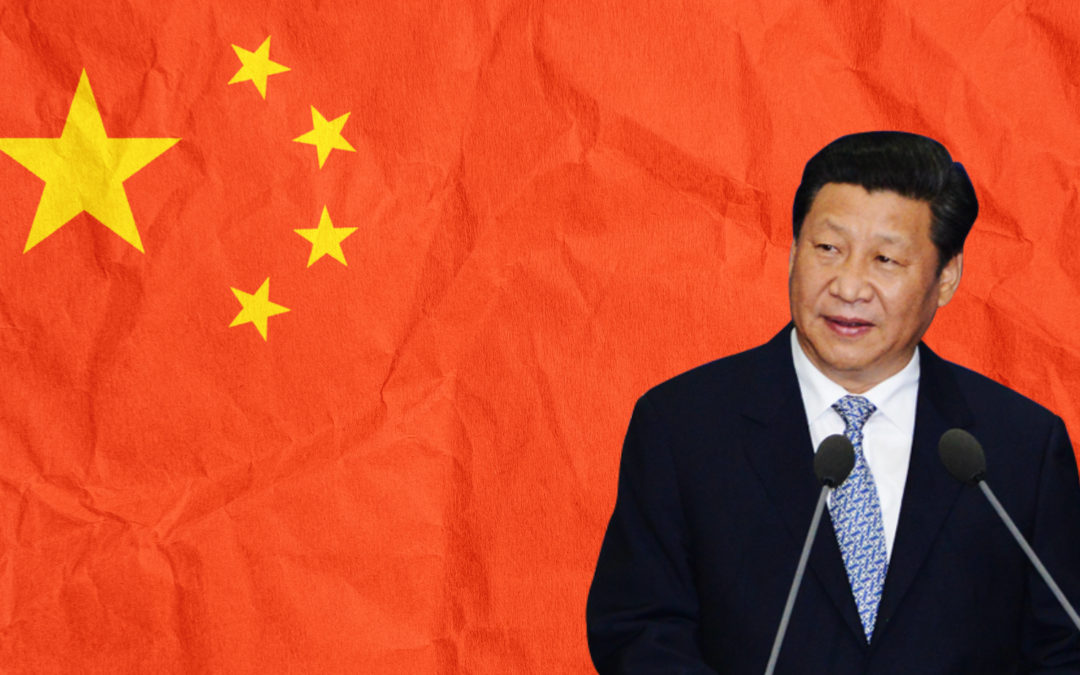
par jbentolopes | 14 octobre 2022 | TBS Press
Quand la Chine s’éveillera…le monde tremblera titrait Alain Peyrefitte dans son ouvrage paru en 1973. Un demi-siècle auparavant, Alain Peyrefitte mettait déjà le monde en garde contre la menace de l’expansionnisme chinois. Depuis, Pékin a connu de profondes mutations aussi bien sur le plan national qu’international. Aujourd’hui plus que jamais, la Chine veut devenir la puissance par excellence. En 2017, lors du XIXe congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping a ranimé « le rêve chinois ». Celui de faire de la Chine la première puissance mondiale d’ici 2049, date du centenaire de la République populaire de Chine. L’Empire du Milieu ne cache plus son aspiration à devenir le numéro 1 dans tous les domaines…ou presque. Ses ambitions de grandeurs sont décuplées : puissance économique, démographique, politique, énergétique, militaire, diplomatique, culturelle, technologique, spatiale, maritime… La Chine entend être présente sur tous les fronts et le fait savoir au monde, en particulier aux Américains qu’elle cherche à dépasser. Elle a d’ores et déjà annoncé son intention de les dépasser d’ici 2030 dans le domaine des technologies, notamment de l’intelligence artificielle. De fait, l’essor de la Chine sur la scène internationale a incité l’administration Obama, dès 2011, à déplacer le centre de gravité de la politique étrangère américaine vers l’Asie, désormais cœur de l’économie mondiale. Ce pivot vers l’Asie a pour but d’intensifier la présence diplomatico-militaire américaine afin de contrer l’influence chinoise dans la région Indo-Pacifique. Néanmoins, une décennie plus tard, la stratégie de rééquilibrage n’a pas eu l’effet escompté. Bien que cherchant à renforcer la coopération avec ses alliés dans la région, les puissances asiatiques semblent douter de la crédibilité de la puissance américaine à un moment où les tensions sino-américaines se sont envenimées jusqu’à atteindre leur paroxysme ces dernières années. Si les Américains et plus largement les Occidentaux pensaient être les maîtres du jeu (du monde) dont ils ont créé les règles, la renaissance de l’Empire du Milieu est venue rappeler qu’un Phœnix pouvait renaître de ses cendres.
Chine, une puissance revancharde
Lors de son arrivée au pouvoir en mars 2013, le premier discours de Xi Jinping est marqué par son appel à la « renaissance grandiose de la nation chinoise ». Cet appel n’est pas anodin puisqu’il fait référence à ce que les Chinois ont appelé le « siècle de la honte ».
Alors refermée sur le monde entre le XVIe et le XIXe siècle, l’Empire du Milieu vit en autarcie : un grand marché intérieur, une main d’œuvre abondante et une marchandise conséquente (thé, épices, soie, porcelaine,…) que les puissances coloniales convoiteront. La Chine se pense alors au centre du monde. Cependant, cette prétention de supériorité lui est fatale. Aveuglée, elle n’anticipe pas l’arrivée et l’invasion des puissances européennes sur son sol. La Chine se voit donc obligé de céder des pans entiers de son territoire et plusieurs ports comme celui de Hong-Kong aux Britanniques, après les deux guerres de l’opium (1839-1842, 1856-1860) et la signature d’une série de « traités inégaux », avec les puissances coloniales européennes et japonaise, forçant notamment l’ouverture de la Chine au reste du monde. Ces humiliations successives, tout au long du XIXe et jusqu’au début du XXe siècle, ont considérablement affaibli l’empire chinois, privé de ses débouchés géographiques du fait de l’occupation du littoral chinois. Autrefois berceau de l’humanité, l’empire devient à la fin du XIXe siècle une puissance de second plan au moment où les Occidentaux et les Japonais s’industrialisent. De la proclamation de la République de Chine en 1912 par Sun Yat-Sen, mettant fin à la dynastie Qing, pour tenter de moderniser le pays, à l’arrivée de Mao Zedong qui instaure la République populaire de Chine en 1949, avec un État totalitaire et à la puissance limitée, rien ne permettra de rattraper le retard face aux Occidentaux. Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, en 1979, pour que s’opère de profonds changements structurels qui viendront moderniser le pays et ouvrir ce dernier à l’économie de marché.
Depuis les années 1980, la Chine ne cesse d’affirmer sa puissance et souhaite retrouver de sa grandeur. Les contentieux historiques ont attisé le ressentiment chinois. Les plaies sont toujours ouvertes et Xi Jinping a bien l’intention d’effacer ces traumatismes. Cela passera nécessairement pour Pékin par un rééquilibrage des forces en remettant en cause la vision occidentale du monde et notamment la légitimité de l’hégémonie américaine.
L’Occident face à ses faiblesses
« Si nous ne fixons pas les règles, la Chine les fixera » alertait Obama, en 2015, pour convaincre Washington de signer l’accord de partenariat transpacifique visant à créer une zone de libre-échange entre les pays de la région Indo-Pacifique et celle d’Amérique. L’ex-président pointait du doigt le fait que la non-signature de l’accord laisserait le champ libre à Pékin d’imposer ses propres règles à la région au détriment des Américains. En sachant que la Chine cherche par tous les moyens à décrédibiliser le pays de l’Oncle Sam qu’elle estime en déclin, le risque est donc trop important pour ne pas le prendre en compte…Pourtant, l’arrivée au pouvoir du président américain Trump vient anéantir la stratégie de rééquilibrage mise en place par l’administration Obama. En effet, trois jours à peine après son investiture, le milliardaire républicain, ne voyant pas d’un bon œil cet accord, décide de ne pas ratifier et décide de retirer par décret les États-Unis de l’accord le 23 janvier 2017. L’administration Trump marque un tournant dans la politique étrangère américaine car elle rentre dans une logique de confrontation avec la Chine, avec qui elle mène notamment depuis 2018 une guerre commerciale à coût de taxes douanières.
-
L’Europe : un no man’s land géopolitique ?
Durant son mandat, le républicain n’a pas manqué d’afficher sa défiance vis-à-vis de l’Europe. Plus largement, le fait que les présidents américains montrent davantage d’intérêt pour ce qu’il se passe en Asie et délaissent donc en partie les Européens, pourtant alliés de longue date, confirme les limites de l’influence géopolitique européenne. En effet, l’Union européenne est sous la protection de l’OTAN, donc vassale des États-Unis. De plus, l’Union européenne est composée d’une communauté d’États membres très hétérogène, divisée et qui peine à parler d’une seule voix. Par conséquent, elle limite son potentiel de puissance et apparaît donc comme un acteur de second rang dans le domaine de la géopolitique. Toutefois, certaines puissances y voient une opportunité pour avancer leurs pions sur le Vieux Continent (Chine, Russie, et Turquie entre autres).
La stratégie des nouvelles routes de la soie inaugurée par Xi Jinping en 2013 consistant à relier la Chine à l’Afrique et à l’Europe en est un parfait exemple. « Diviser [les Européens] pour mieux régner » telle serait la façon de résumer la stratégie chinoise en Europe. En effet, Pékin profite des divisions en Europe pour signer des contrats avec certains pays européens et contrôler ainsi des ports comme le Pirée en Grèce ou encore celui de Venise en Italie. Le but de la Chine est clair : accroître son influence en Europe.
-
Un leadership à réaffirmer
Par ses choix en matière de politique étrangère, en cherchant notamment à freiner la montée en puissance chinoise, Trump a en réalité accéléré l’ascension de la Chine et a au passage remis en cause la crédibilité des Américains auprès des alliés de la région Indo-Pacifique.
L’arrivée de Biden au pouvoir en janvier 2021 ne rompt pas totalement avec la politique étrangère de son prédécesseur puisqu’il n’atténue pas les tensions sino-américaines. Néanmoins, le président américain à une approche similaire à celle d’Obama. Il cherche donc à redorer le blason de l’Amérique et à renouer des relations solides avec ses alliés de l’Indo-Pacifique afin de retrouver un certain leadership. Ainsi, le 28 et le 29 septembre dernier, les États-Unis ont organisé pour la première fois un sommet avec les États insulaires du Pacifique Sud dans le but de réduire l’influence chinoise dans la région qui menace la souveraineté de ces îles. Le sommet s’est conclu par l’annonce d’un ensemble d’engagements dans de nombreux domaines (climat, économie ou encore coopération sécuritaire) avec une enveloppe d’aide d’une centaine de millions de dollars. Toutefois, un certain nombre d’États insulaires semblent douter de cet engagement américain, pensant notamment qu’il s’agit plus d’une aide temporaire que d’une aide permanente accordée à ces derniers. De plus, ce partenariat avec les États-Unis met les îles dans une position délicate avec la Chine. C’est pourquoi, les Iles Salomon ont déjà annoncé le 4 octobre dernier s’opposer à la première version de la déclaration de partenariat en expliquant qu’ils ne veulent avoir à « choisir un camp ».
Réaffirmer le leadership américain ne va pas être si simple pour Biden. D’autant plus que les États-Unis traversent actuellement une zone turbulence du point de vue de leur politique intérieure. En effet, l’invasion du Capitole le 6 janvier 2021 a mis à mal la démocratie américaine et Pékin s’en frotte les mains. Les élections de mi-mandat du 8 novembre prochain annoncent un scrutin très serré entre le camp démocrate et le camp républicain pour le renouvellement de la Chambre des représentants et une partie du Sénat. La crédibilité du président américain est en jeu aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale. Perdre la majorité dans l’une des deux chambres affaiblirait l’image de l’Amérique et son dynamisme en serait directement affecté face à la montée en puissance chinoise.
Par ailleurs, la Chine prend un malin plaisir à critiquer les États-Unis, qui accusent notamment Pékin de « rejeter l’ordre international fondé sur des règles », des règles que les États-Unis eux-mêmes n’ont pas toujours respectées. Par exemple en Irak. De fait, les règles occidentales ne paraissent plus aussi légitimes qu’auparavant, les puissances du Sud se sentent méprisées par l’Occident, ce qui fait bien les affaires de la Chine…Par conséquent, Washington doit envisager une stratégie prudente vis-à-vis de cette dernière, surtout quand il s’agit de s’aventurer dans une zone aussi turbulente que l’Indo-Pacifique, bien connue de Pékin.
L’Indo-Pacifique : théâtre d’une nouvelle bipolarité ?
« Qui tient la mer tient le commerce du monde ; qui tient le commerce tient la richesse ; qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même » (Walter Raleigh, explorateur britannique). Cette citation résume à elle seule ce qui se joue actuellement dans la région stratégique de l’Indo-Pacifique qui représente près des 2/3 de la population mondiale et où transite 2/3 du commerce maritime mondial. De fait, il s’agit d’une zone particulièrement stratégique pour des puissances comme la Chine. C’est pourquoi l’Empire du Milieu cherche notamment à maîtriser les routes maritimes par la mer de Chine méridionale où il revendique près de 90% des eaux du fait qu’elles contiennent d’importantes ressources halieutiques et énergétiques. La nation qui parviendra à avoir la mainmise sur cet espace contrôlera l’une des routes commerciales les plus importantes au monde. Maîtriser le Sea Power pour affirmer sa puissance par les mers et océans est donc primordial pour Pékin qui cherche à la fois à sécuriser ses approvisionnements pour sa vaste population, évincer Washington et contrôler la région en acquérant le leadership régional.
-
Une stratégie chinoise agressive
La stratégie d’affirmation de la puissance chinoise passe par la revendication de zones économiques exclusives (ZEE) et par une militarisation de la zone. En effet, la Chine souhaite s’emparer d’un certain nombre d’îlots et d’archipels afin d’élargir sa ZEE et accroître ainsi son influence. De fait, depuis 2014, Pékin n’hésite pas à construire des îles artificielles sur l’archipel des Spratleys et des Paracels, appelées également « la grande muraille de sable ». Une aberration environnementale pour un pays qui prône pourtant des engagements climatiques forts pour les années à venir… Ces îles artificielles ont pour but d’y installer des bases militaires afin d’y défendre les eaux territoriales, qui lui appartiendrait de droit selon elle.
La militarisation de la zone fait qu’elle devient le théâtre de conflictualité, en grande partie entre les États-Unis et leurs alliés d’un côté et de l’autre la Chine. Cette dernière souhaite acquérir le leadership régional mais tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. En effet, la politique agressive de Pékin se heurte aux revendications d’autres États de la région avec qui la Chine est en concurrence (le Vietnam, les Philippines, l’Indonésie, Brunei, la Malaisie et évidemment Taïwan), ce qui provoque des situations conflictuelles. C’est pourquoi, les deux puissances que sont l’Inde et le Japon rejettent la vision chinoise qui viserait à recentrer l’Indo-Pacifique autour de la Chine. De fait, le Japon rompt avec sa traditionnelle doctrine prônant la neutralité militaire, héritée de l’article 9 de sa Constitution (rédigée sous la houlette des Américains au lendemain de la Seconde Guerre mondiale). Afin de faire face au géant chinois, perçu comme une menace, Tokyo augmente ainsi son budget militaire ces dernières années. De plus, la stratégie du collier de perles, visant à prendre le contrôle de plusieurs ports en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, mise en place par Pékin représente également une menace pour l’Inde qui y voit un encerclement, en particulier dans l’Océan Indien et chez ses voisins comme le Pakistan, rival historique de New Delhi.
Par ailleurs, l’Empire du Milieu s’impose par la mer en multipliant ses exercices militaires en mer de Chine méridionale afin de dissuader ses rivaux et notamment les États-Unis, qui en font régulièrement du fait de la présence de nombreuses bases militaires américaines dans la région. Dernier exercice en date : celui avec la Corée du Sud au début du mois d’octobre 2022 en réaction à des tirs nord-coréens. Le but de la Chine est clair : montrer aux autres puissances que c’est elle qui fixe les règles du jeu dans cette zone. Le 17 juin dernier, la Chine a d’ailleurs présenté son troisième porte-avions nommé « Fujian » (en référence au nom d’une province chinoise se trouvant en face de Taïwan et dont beaucoup de Taïwanais sont originaires) bien plus grand que les deux déjà existant. Un message fort envoyé aux États-Unis, même si la Chine est encore bien loin de dépasser ceux de la flotte navale américaine, mais aussi à Taïwan que Pékin considère comme une partie intégrante du territoire chinois et non comme un territoire indépendant. De quoi attiser les tensions toujours plus virulentes entre ces deux pays.
-
Taïwan et la rivalité sino-américaine : Un casus belli inévitable ?
Le ton est monté entre la Chine et les États-Unis au sujet d’une visite historique de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan le 2 août dernier. Pour riposter à cette visite qui a fortement déplu à Pékin, l’armée chinoise a lancé des exercices militaires de plusieurs jours dans les eaux territoriales de Taïwan. Xi Jinping a toujours affirmé qu’il récupérerait un jour l’île, quitte à le faire par la force si nécessaire. En effet, Taïwan représente un enjeu existentiel pour Pékin. Toute proclamation d’indépendance de l’île provoquerait donc immédiatement un casus belli avec Pékin. Le 18 septembre dernier, le président américain Joe Biden a d’ailleurs affirmé qu’en cas d’invasion chinoise, les États-Unis défendraient Taïwan.
Pourtant, aucun d’entre eux n’a intérêt à provoquer une guerre. En effet, un tel conflit serait non seulement dévastateur pour la région mais aussi pour l’économie mondiale. Une invasion de la Chine engendrerait des pertes humaines et des sanctions commerciales américaines à l’encontre de Pékin, déjà fragilisé par le ralentissement de son économie et le départ de nombreux investisseurs occidentaux. Par conséquent, malgré les litiges avec le pays de l’Oncle Sam, l’Empire du Milieu a besoin des États-Unis, et plus largement du monde entier pour vendre ses produits. Sa dépendance aux exportations ne lui permet donc pas de se mettre à dos une partie du monde.
Par ailleurs, il est dans l’intérêt commun que les Américains et les Chinois coopèrent dans certains domaines tels que le climat ou encore le ralentissement de la prolifération des armes nucléaires. Toutefois, l’ambiguïté de la puissance chinoise rend cette coopération difficile. Il faut donc trouver un juste équilibre pour éviter de tomber dans une relation perdant/perdant.
- En effet, se mettre à dos la Chine n’est pas non plus dans l’intérêt des puissances mondiales car une Chine moins coopérative risque de réduire à néant les efforts en matière de lutte contre le réchauffement climatique notamment. D’ailleurs, à la suite de la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, Pékin a annoncé suspendre les pourparlers sur le changement climatique avec Washington, entamés lors du sommet de la COP26 à Glasgow l’an dernier. En faisant cette annonce, la Chine « punit le monde entier » et pas seulement les États-Unis. Cette décision montre qu’en réalité les intérêts chinois sont avant tout tournés vers sa nation.
- Pékin et Washington n’ont aucun intérêt à voir d’autres pays se doter de l’arme nucléaire. Or la menace d’une guerre pousse les pays à vouloir s’en doter, perçu comme une « assurance-vie » notamment pour les régimes autoritaires. Posséder l’arme nucléaire dissuaderait par exemple les Occidentaux de venir se mêler des affaires intérieures. De plus, la multiplication des missiles balistiques par la Corée du Nord ne fait pas non plus les affaires de Xi Jinping puisque cela renforce la présence américaine en mer de Chine.
La guerre n’est certes pas inévitable mais il est fort à parier que le sort de l’armée russe, qui perd actuellement du terrain en Ukraine, pousse Xi Jinping à y réfléchir à deux fois, surtout à quelques jours du XXe Congrès du PCC où le président chinois brigue un troisième mandat et doit rester crédible aux yeux de sa population pour maintenir sa légitimé.
La Chine face à ses propres défis
« Le rêve chinois est le rêve de notre État, de notre nation et de chaque Chinois. ». Les motivations de Xi Jinping sont avant tout nationalistes. Nul doute que le président chinois sera reconduit pour un troisième mandat le 16 octobre prochain lors du XX Congrès du PCC car il est celui qui incarne le mieux ce « rêve chinois », c’est-à-dire celui d’une Chine puissante et prospère. Toutefois, le défi n’est pas aussi simple à relever avec des indicateurs en berne : une croissance de 0,4% en un an au deuxième trimestre sur fond de faillites bancaires et immobilières et une stratégie zéro Covid qui montre ses limites… Une mauvaise performance qui affecte particulièrement la classe moyenne chinoise pour qui la colère monte. D’autant plus que les inégalités se creusent et que Pékin est confronté à des problèmes de dégradation de l’environnement. La classe moyenne, qui est au cœur du « rêve chinois » du président, est également celle qui prône le plus les valeurs démocratiques. Par conséquent, Xi Jinping est très attentif aux problèmes nationaux et il est à penser que le régime chinois va encore se durcir par peur d’une possible déstabilisation intérieure. Ainsi, le durcissement du régime chinoise passe notamment par un renforcement du contrôle social avec le système de « crédit social » et la reconnaissance faciale à grande échelle pour veiller à un suivi étroit des individus. Le soulèvement actuel en Iran est une leçon pour la Chine : même les régimes autoritaires peuvent être contestés de l’intérieur.
Chine, leader d’un nouvel ordre mondial ?
L’hégémonie d’une seule puissance n’est plus possible ni même souhaitable dans ce monde complexe et polycentrique dans lequel nous vivons. Les États-Unis ne peuvent plus être les gendarmes du nouvel ordre mondial. Même si la Chine souhaite devenir la première puissance mondiale et contribue à modifier l’ordre mondial à son avantage, elle n’a pas non plus l’intention d’endosser le rôle de nouveau gendarme du monde. Le monde dans lequel chacun se dirige fera cohabiter plusieurs puissances. Aucune n’aura une hégémonie incontestable. La Chine s’est éveillée et il est clair qu’elle jouera un rôle majeur dans l’évolution des rapports de forces avec les autres puissances. Toutefois, la complexité et l’ambiguïté des rapports de forces entre puissances aujourd’hui ne permet pas à la Chine de devenir un leader incontestable comme l’a pu l’être autrefois les États-Unis. Par conséquent, le nouvel ordre mondial annonce une recomposition du paysage géopolitique mais Pékin n’en sera qu’un acteur parmi tant d’autres.
Par Jessica LOPES BENTO
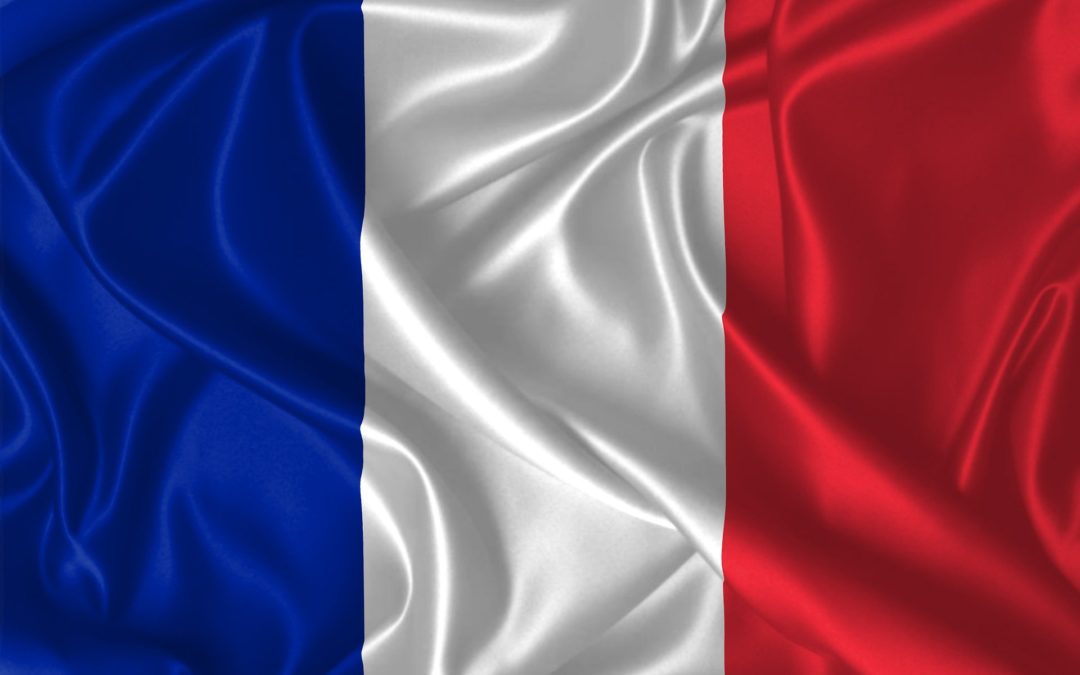
par jbentolopes | 8 avril 2022 | RDVC en parle, TBS Press
*Pour en savoir plus sur chaque candidat, vous pouvez lire plus en détails leurs programmes sur leurs sites officiels de campagne.




Les sites de campagnes :
Par Jessica LOPES BENTO

par jbentolopes | 27 mars 2022 | TBS Press
L’ADEME dévoile en 2017 que le volume annuel de consommation par personne est aujourd’hui trois fois plus élevé qu’en 1960.
Écoresponsabilité : contexte, notion et avantages
Un peu d’histoire
Faisons un bond dans les années 1980 en Italie. En réaction à l’implantation d’un McDonald’s en plein cœur de Rome en 1986, un groupe de gourmets, mené par Carlo Petrini, s’oppose à la diffusion de la « junk food », de la standardisation et de l’hyper-industrialisation alimentaire. C’est l’avènement du mouvement Slow Food. Ce dernier propose de renouer avec l’alimentation locale et de comprendre les conditions de production des divers aliments pour redonner sens au plaisir gustatif tout en respectant l’environnement.
Qu’est-ce que l’écoresponsabilité ?
En 1994, le Parlement européen s’est saisi de la question de la responsabilité environnementale, avec une approche visant la réparation du dommage environnemental. Ainsi est apparu en 2003 une proposition du principe du pollueur – payeur, même si celui-ci était déjà présent dans l’OCDE à partir de 1972. Par la suite, ce principe a été intégré en droit international de l’environnement. Il est notamment défini comme le fait d’internaliser les coûts de protection de l’environnement, compte tenu de l’idée que c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, en ayant en vue l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement.
De manière générale, l’écoresponsabilité invite l’ensemble des entreprises, et des citoyens, à réfléchir à l’impact de leurs activités sur l’environnement (construction des bureaux, gestion des déchets, gestion de l’énergie, utilisation d’eau, déplacements, numériques) et à y intégrer les enjeux du développement durable.
La démarche écoresponsable commence par identifier le périmètre d’action et évaluer son empreinte carbone afin de choisir ce qui mérite d’être traité en priorité.
Dans un deuxième temps, il faut imaginer et proposer des solutions pour réduire les impacts négatifs sur l’environnement.
Enfin, il est important de former ses collaborateurs et d’instaurer un temps de discussion afin d’échanger sur les bonnes pratiques à adopter pour diminuer son bilan carbone.
En tant qu’entreprise, intégrer les principes du développement durable dans votre activité est une opportunité. Cela permet de réduire certains coûts, d’attirer de nouveaux clients dans la mesure où les consommateurs ont des attentes de plus en plus fortes envers les entreprises, et, de nouer de bonnes relations au niveau local (avec les fournisseurs et les consommateurs). De plus, travailler dans un restaurant qui fait sens pour l’environnement est une source de motivation pour les collaborateurs !
Comment s’informer en tant que consommateur ?
Le label
Pour permettre aux entreprises d’officialiser leur engagement en matière d’écoresponsabilité, il existe différents labels. En voici quelques-uns :
Tout d’abord, la marque NF Environnement permet de distinguer des produits ou services plus respectueux de l’environnement que les équivalents classiques. Ses critères garantissent l’aptitude à l’usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Elle concerne à la fois le produit et son emballage.
Le label MSC (Marine Stewardship Council) récompense les pêcheries dont la gestion et les pratiques sont reconnues comme étant écologiquement responsables. Ce label certifie que le produit issu de la mer provient d’une pêcherie durable, bien gérée et ne contribue pas au grave problème de surpêche.
Le label GOTS (Global Organic Textil Standard) se réfère aux produits en coton, laine, soie et chanvre. Il permet de certifier l’origine biologique des fibres et le respect de l’environnement et de l’être humain, dans les processus de fabrication. Il assure par exemple qu’au moins 70% des fibres naturelles utilisées pour la fabrication des vêtements sont d’origines naturelles.
Le label est-il toujours fiable ?
Il faut toutefois se méfier de certains labels puisqu’ils ne sont pas toujours certifiés par un organisme accrédité et indépendant. Un label peut par exemple provenir d’un organisme privé. Les exigences auxquelles les produits ou les entreprises labellisés doivent répondre sont donc moins encadrées que celles qui sont demandées pour obtenir une certification.
Par exemple, la certification B Corp permet à une entreprise de certifier qu’elle respecte des normes élevées de performance vérifiée, de responsabilité et de transparence sur des facteurs allant des avantages sociaux aux employés, aux pratiques de la chaîne d’approvisionnement et aux matériaux d’entrée. Danone et Nature & Découvertes ont obtenu la certification B Corp.
Et pour mon entreprise ?
Devenir une entreprise à mission
Une majorité des français considèrent qu’une entreprise doit être utile pour la société dans son ensemble. La loi a donc introduit en 2019 la qualité de société à mission permettant à une entreprise de déclarer sa « raison d’être » envers plusieurs objectifs sociaux et environnementaux.
Pour devenir une entreprise à mission, une société doit définir, en plus de ses engagements économiques, des engagements sociaux et environnementaux et baser sa stratégie dessus. Contrairement au statut d’entreprise écoresponsable, le statut d’entreprise à mission est clairement défini puisque les missions doivent être mentionnées dans les statuts et aussi dans la base de données des entreprises de l’INSEE.
Les étapes pour y parvenir
- Élaboration et définition de la raison d’être de l’entreprise ;
- Déterminer des objectifs environnementaux et sociaux ;
- Appliquer un mode de gouvernance et de gestion qui répond à ces objectifs ;
- Modifier les statuts juridiques de l’entreprise (vote des associés, publication d’une annonce légale, enregistrement de ces modifications au Registre du Commerce et des Sociétés, publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) ;
- Nominer un comité de mission comprenant au moins un salarié de l’entreprise ;
- Contrôler au moins tous les deux ans par un organisme indépendant agréé.
Par Alise DURAND

par jbentolopes | 19 mars 2022 | TBS Press
Dimanche 14 mars 2021, une bombe explose au sein du microcosme des très puissants patrons du CAC 40. La tête du chantre de la RSE vient de tomber.
Le conseil d’administration du groupe Danone a voté le départ immédiat de son charismatique et médiatique Président Directeur Général, Emmanuel Faber.
Depuis des mois celui qu’on surnomme « Le Moine-Soldat » est dans le viseur des actionnaires qui le jugent responsable des mauvaises performances économiques du géant agroalimentaire face à ses concurrents, comme Nestlé ou Unilever.
A l’initiative de ce renvoi, on trouve deux fonds activistes : Bluebell Compagnie et Artisan Partners. Entrés dans le capital de Danone courant 2020, ils sont minoritaires mais pourtant font la pluie et le beau temps au CAC40. Les fonds activistes, grâce à leur autorité d’acteur financier expérimenté, s’imposent dans la prise de décision des directions générales et proposent une stratégie déjà appliquée et prouvée pour améliorer les performances financières de l’entreprise, ce qui convainc généralement les autres actionnaires, qui se rallient à leur vision.
C’est lorsqu’il y a un désaccord de fond entre la direction générale et les fonds activistes que ces derniers vont tenter de la faire tomber.
C’est ce qu’il s’est passé dans le cas de Danone en 2021. Les deux fonds depuis leur entrée dans le capital n’ont pas cessé de critiquer les performances financières du Groupe, jusqu’à réclamer la tête de son PDG, Emmanuel Faber.
Car aujourd’hui on mesure la performance d’une entreprise à l’aune de celle de ses concurrentes. Méthode très discutable car la performance d’aujourd’hui ne garantit pas celle de demain. Par exemple un investissement de long terme fait baisser le chiffre d’affaires du moment alors qu’il assure l’avenir de l’entreprise. En d’autres termes une « sous-performance » peut être un signe de viabilité à long terme.
L’affaire Danone est l’exemple parfait du problème de la Corporate Governance dans l’économie.
Aujourd’hui la notion d’entreprise se voit réduite à une organisation marchande destinée à faire du profit : le caractère lucratif de l’entreprise est même le seul critère discriminant que retient l’INSEE pour comptabiliser le nombre d’entreprises en France.
Jusque dans les années 70 l’intérêt de l’entreprise était censé entraîner l’intérêt de la société. Comme l’illustrait le slogan « What Is good For General Motors Is good For America ».
Mais depuis les années 80 la logique s’est inversée, à la place des intérêts de l’entreprise les dirigeants se sont mis à privilégier les intérêts des actionnaires, contraints par une nouvelle doctrine appelée la Corporate Governance (corporate désigne en anglais non pas l’entreprise mais la société anonyme). Cette doctrine fait systématiquement prévaloir la société anonyme, donc l’actionnariat, sur l’entreprise.
La doctrine de la Corporate governance s’est diffusée dans le monde à travers la réglementation : rapport Cadbury en 1922 en Angleterre, rapport de l’American Law Institute en 1994 aux Etats Unis, rapports Vienot en 1995 et 1999 en France, rapport de l’OCDE en 1999 dans l’Union Européenne ou de façon plus insidieuse encore dans les codes de bonne gouvernance imposés aux dirigeants de grandes entreprises.
Les principes de la shareholder value se sont peu à peu légitimés au cours du 20e siècle, aidés par une conjoncture particulière et la montée en puissance du néolibéralisme.
Friedman affirmait dans Capitalisme et Liberté le dirigeant d’entreprise n’a « qu’une seule responsabilité sociale, vis-à-vis de son actionnaire : utiliser ses ressources et s’engager dans des activités destinées à accroître ses profits ».
Idée entérinée par les économistes Armen Alchian et Harold Demsetz en 1972 dans leur théorie de la firme, qui affirment que le meilleur moyen d’avoir une direction efficiente est de la faire nommer par les actionnaires, car leurs intérêts financiers y sont directement liés.
Conséquence en chiffre de cette nouvelle doctrine, la valeur actionnariale a primé sur les investissements productifs. En France, les dividendes versés aux actionnaires ont pratiquement doublé en 10 ans (2009-2019), alors que les inégalités de revenus des ménages ne cessaient d’augmenter.
Comment restaurer l’entreprise face à la société anonyme ?
-
Par l’autogestion et la participation
A l’instar des lois allemandes sur la co-détermination, évoquant dès 1920 le devoir de production commun au-delà de l’opposition des intérêts entre salariés et actionnaires, un conseil de surveillance est mis en place dans lequel les salariés occupent une partie des sièges, voire la moitié dans les grandes entreprises, pour contrôler la gestion. De nombreuses études, comme celle du rapport Biedenkopf en Allemagne en 1951 montre qu’en pratique la co-détermination ne nuit pas aux performances des entreprises.
Car elle part du principe que l’entreprise est une organisation économique profondément encastrée dans les rouages de la société. A la fois dépendante d’elle et rétro agissant en permanence sur elle. Cette fois-ci au lieu de se questionner sur la place et le poids décisionnaire des salariés, l’accent est mis sur la mission de l’entreprise et ses responsabilités à l’égard de son environnement au sens large.
La démarche RSE s’est développée avec des instruments extra-judiciaires : critères d’évaluation, agences de notation, normes ISO. Cependant on ne peut que constater les limites des démarches de RSE. Tant que les actionnaires ont la possibilité de révoquer les dirigeants à tout moment ou que l’entreprise peut être rachetée comme dans le cas de Ben & Jerry’s, le souci que peuvent avoir les dirigeants de ménager un certain équilibre restera dérisoire.
-
Par la théorie des stakeholder (parties prenantes)
Remplacer le mandat par l’habilitation :
Les dirigeants sont habilités par les salariés à exercer un pouvoir de direction afin de piloter les opérations dans l’intérêt de l’entreprise ; et non mandatés par les actionnaires d’accroître leurs dividendes.
Avec la théorie des stakeholders, ce ne sont pas seulement aux contributeurs directs, salariés, actionnaires, banquiers, d’avoir un pouvoir décisionnaire mais aussi aux parties affectées par l’activité de l’entreprise, consommateurs, riverains, voire O.N.G. ou syndicats.
Cette théorie plaide généralement pour qu’une grande latitude soit laissée aux dirigeants tout en considérant que les parties prenantes pourront faire valoir leurs attentes auprès des managers.
Cependant pour toutes les sociétés côtées, il n’est pas possible de s’affranchir des préceptes de la « Corporate Governance ».
Mais le législateur peut mettre de nouveaux statuts à côté de la société anonyme.
Comment concrètement empêcher que l’objectif du profit à court terme ne continue à assujettir les dirigeants et leur stratégie ? Comment restaurer l’autorité du dirigeant, essentiellement sa capacité à construire des objectifs d’entreprise qui ne concordent pas toujours avec l’intérêt à court terme des actionnaires ?
Aujourd’hui certaines entreprises parviennent à combiner des objectifs sociétaux avec des exigences de rentabilité financière, mais en faisant cela les dirigeants actuels courent des risques et peuvent être accusés de manquer à leurs devoirs (fiduciary duties) vis-à-vis des actionnaires.
Ils peuvent invoquer la « Business Judgment Rule » pour faire accepter leur décision, avec comme argument des effets potentiels à long terme sur les intérêts des actionnaires cependant cette règle les protège peu surtout en situation d’OPA.
Alors comment donner vraiment plus de pouvoirs aux dirigeants ? Les économistes Blanche Segrestin et Armand Hatchuel proposent d’introduire une nouvelle option juridique la « société à objet social étendu » ou SOSE. Cette norme introduit dans l’objet social de l’entreprise le développement à long terme de capacité d’innovation du collectif, le développement des compétences des salariés et de leur employabilité, le respect des politiques de solidarité ou des règles pour gérer des éventuelles restructurations et la minimisation des effets des activités sur l’environnement.
Encore plus important les dirigeants d’une société avec un statut de SOSE ne pourraient plus être révocables ad nutum par les actionnaires mais sur « juste motif », c’est-à-dire s’ils contreviennent aux objets pour lesquelles ils sont missionnés par les statuts.
L’État de Californie a déjà voté une loi similaire, le 9 octobre 2011, le gouverneur Jerry Brown a ratifié la création d’un nouveau type de société la « flexible purpose corporation ». Cette nouvelle société permet de « faire le bien tout en étant conforme » « making good while doing well » en autorisant les dirigeants à poursuivre des objectifs autres que la valeur actionnariale.
En définitive le libéralisme économique et le capitalisme se définissent par la liberté d’entreprendre, et la libre concurrence, mais rien dans leurs principes ne détermine les formes de l’action collective pour produire de la valeur et des profits. Les règles de gestion d’entreprise ne sont ni naturelles ni invariantes, ce sont plutôt des outils d’organisation, qui peuvent évoluer avec l’état des connaissances et des normes sociales en vigueur.
Aujourd’hui le droit devrait évoluer pour dissiper la confusion entre société anonyme et entreprise, et mettre un terme à l’une des plus endémique des crises contemporaines, celle de l’entreprise dont on a négligé la capacité à réguler le capitalisme.
L’entreprise doit surtout répondre aux enjeux économiques et sociaux contemporains de la compétitivité et de l’innovation. S’il y a un siècle elle était déjà née de l’impératif d’inventivité technique, les investissements en innovation et en création ne peuvent plus passer actuellement après les versements des dividendes aux actionnaires. Dans un monde où le niveau d’éducation, de connexion, et de communication ne cesse de croître et où les besoins en développement humain s’étendent et le désir d’égalité s’intensifie, l’innovation est plus que jamais le moteur de la création de richesse.
Il est urgent de réformer l’Entreprise pour qu’elle redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une dynamique de création collective et un vecteur de progrès économiques et sociaux.
Par Emma LAVABRE

par jbentolopes | 13 mars 2022 | TBS Press
En septembre 2017, à l’occasion d’une conférence avec des étudiants portant sur les nouvelles technologies, le président russe Vladimir Poutine prononçait cette phrase : “Le pays qui deviendra leader en intelligence artificielle sera le maître du monde”. De fait, l’intelligence artificielle est vouée à devenir un outil de domination géopolitique majeur dans les années à venir pour les pays qui souhaitent affirmer leur puissance. C’est d’ailleurs ce qui amène les Etats à s’affronter sur un nouveau terrain géopolitique : le cyberespace, un espace sans frontières, libre et anonyme, où une multitude d’informations s’échangent et qui peut également devenir le théâtre de conflits entre différents acteurs. Les militaires qualifient même le cyberespace de “cinquième dimension”, autrement dit de cinquième champ de bataille, après la terre, la mer, l’air et l’espace. Le risque de cyberguerre est donc réel et les menaces au sein du cyberespace se multiplient. De fait, il est nécessaire que les Etats agissent pour faire face à ces menaces.
L’émergence d’un nouveau terrain géopolitique et de nouveaux acteurs
Le cyberespace est un lieu d’information créé par l’interconnexion à l’échelle mondiale des réseaux de télécommunications, permis grâce à Internet. Le cyberespace est donc un produit dérivé d’Internet, qui est lui-même un produit dérivé d’une invention militaire. En effet, Internet est né de la création “d’Arpanet”, un système de communication mis en service par le ministère américain de la Défense en 1969, dont le but était de permettre à l’armée américaine de maintenir un moyen de communication capable de résister à une éventuelle attaque nucléaire. Internet est ensuite devenue dans les années 1990-2000, le réseau de télécommunications mondial que tout le monde connaît aujourd’hui avec près de 4,95 milliards d’internautes en janvier 2022, soit pratiquement 60% de la population mondiale.
Si le cyberespace est l’objet d’affrontements entre puissances depuis des décennies, de nouveaux acteurs émergent et contrôlent également cet espace avec des intérêts divergents : on y retrouve les multinationales ainsi que les acteurs issus des “zones grises” du web, qui sont la face cachée d’internet, représentée par le “dark web”.
- Les acteurs des “zones grises” sont des pirates informatiques (des “hackers”), des groupes de hackers comme Anonymous ou encore des groupes criminels et terroristes et dont leur but est de défendre leurs intérêts économiques et politiques. Par exemple, l’organisation terroriste Daech a eu recours au dark web pour recruter notamment des djihadistes européens afin de rejoindre la Syrie et l’Irak entre 2014 et 2018.
- Les Etats peuvent développer leur cyberpuissance par le biais de leurs multinationales, acteurs-clés du cyberespace et véritable outil de leur softpower. Les sièges sociaux des principales multinationales se trouvent dans la Silicon Valley en Californie. Les États-Unis dominent assez largement dans ce domaine avec ses GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), ce qui s’explique par les importantes avancées dans le domaine de la R&D. Cependant, dans le contexte actuel de la guerre technologique sino-américaine, l’hégémonie numérique américaine est de plus en plus contestée par l’émergence des géants du numérique chinois, les BATX (Baidu, le “google chinois” – Alibaba, “l’amazon chinois” – Tencent, service internet et mobile chinois – Xiaomi, produits électroniques). Par exemple, la capitalisation boursière de Tencent a dépassé celle de Facebook en juillet 2020 en s’élevant à 664,50 milliards de dollars contre 656,15 milliards de dollars pour Facebook. De plus, l’entreprise de téléphonie chinoise, Huawei, a été accusée au début de l’année 2019 d’espionnage industriel par les Américains et la diffusion de la 5G par le bais des services de cette dernière fait régulièrement polémique. Par conséquent, le duel technologique sino-américain montre à quel point le cyberespace est devenu un enjeu géopolitique.
Néanmoins, malgré l’émergence de nombreux acteurs, cet espace reste restreint du fait de contraintes matérielles majeures et assurent, de fait, une domination des acteurs présents dans le cyberespace. En effet, ce sont notamment les câbles sous-marins qui assurent 99% des communications mondiales contre seulement 1% pour les satellites. De plus, 97% des communications entre l’Europe et l’Asie transitent par le réseau de câbles sous-marins provenant des États-Unis, acteur de premier rang donc dans le cyberespace. Les géants du numérique investissent également dans l’installation de ces câbles et sont donc des acteurs à part entière. Par exemple, Facebook ou encore Telstra (une entreprise australienne de télécommunication) ont investi dans l’installation du câble sous-marin Hong Kong-Americas reliant Hong Kong à la côte ouest américaine.
Les menaces au sein du cyberespace : un miroir des tensions internationales ?
Le cyberespace peut être source de conflit et de menaces. En effet, un État peut être soit l’auteur, soit la victime d’espionnage ou de cyberattaque.
Le cyberespionnage est l’une des menaces les plus courantes et dont le but est de collecter des informations sur un État en s’introduisant dans le système informatique du pays en question.
La révélation de l’affaire Pegasus en juillet 2021 par Forbidden Stories en est un très bon exemple. Il s’agit d’un logiciel espion créé par l’entreprise israélienne NSO Group, spécialisée dans la cybersurveillance et vendu par cette dernière à une cinquantaine de gouvernements, dont les Émirats arabes unis et le Maroc. Des chefs d’État, des journalistes ou encore des opposants politiques ont été espionnés par ce logiciel. De fait, cette affaire a provoqué une crise géopolitique impliquant des acteurs étatiques et privés. Le cyberespionnage constitue une véritable arme géopolitique : le logiciel Pegasus a notamment permis à Israël de continuer son rapprochement politique avec le Maroc et les Emirats arabes unis, déjà initié lors de la signature des accords d’Abraham du 15 septembre 2020.
Selon Shoshana Zuboff, professeure à Harvard Business School, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, une ère de l’écoute et du « capitalisme de surveillance ». En 2013, le lanceur d’alerte Edward Snowden avait déjà mis en lumière l’idée selon laquelle les services secrets américains et britanniques espionnaient les liaisons téléphoniques et informatiques de millions de personnes par le biais de câbles sous-marins, transitant entre l’Europe et les Etats-Unis. Il a également révélé la même année le programme de surveillance massif de la NSA (l’Agence nationale de la sécurité), nommé les “Five Eyes” et crée en 1995. Ce programme avait pour but de surveiller les données informatiques échangées à travers le monde. Des pays comme le Brésil ont rapidement réagi face à ces révélations en décidant de construire un câble sous-marin, l’année suivante, reliant directement le Brésil à l’Europe afin de ne plus passer par les Etats-Unis. De fait, ce qui se passe dans le cyberespace peut avoir un impact significatif sur les relations internationales.
Autre menace de grande ampleur : la subversion, qui est étroitement liée à l’espionnage, peut être un moyen d’influencer l’opinion publique nationale ou internationale en déstabilisant l’adversaire et constitue donc également une menace majeure au sein du cyberespace. Par exemple, la société britannique Cambridge Analytica, spécialisée dans l’analyse de données et d’influence de l’opinion sur Internet, a été accusée d’avoir influencé le vote des électeurs américains en faveur de Donald Trump, notamment par le biais de la désinformation sur Facebook, lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.
Les menaces dans le cyberespace sont récurrentes. Par conséquent, les conflits au sein du cyberespace sont tout sauf anodins. Une cyberattaque bien menée peut constituer une menace existentielle pour la sécurité d’un pays et peut même porter un coup fatal à l’économie d’un pays et in fine accroître les tensions internationales.
-
Les conséquences d’une cyberattaque : l’exemple estonien
En 2007, une vague de cyberattaques, attribuée à la Russie, a paralysé l’ensemble du réseau informatique de l’Estonie, membre de l’Union européenne. La plupart des hackers étaient russes et protestaient contre le déplacement d’un monument érigé en l’honneur des soldats soviétiques morts lors de la Seconde Guerre mondiale et qui ont contribué à la libération du pays en 1944. De fait, ces cyberattaques ont touché l’intégralité du système informatique estonien : sites Internet du gouvernement, banques, médias, ou encore opérateurs téléphoniques. Par conséquent, ces cyberattaques ont perturbé la vie institutionnelle et quotidienne de ce pays où notamment 95 % des opérations bancaires s’effectuent par voie électronique.
Le cas estonien montre la nécessité pour les Etats de construire une véritable coopération internationale dans le domaine de la cyberdéfense afin de sécuriser les systèmes informatiques et de riposter en cas d’attaques.
Entre souveraineté nationale et coopération internationale
Le cyberespace constitue un véritable terrain géopolitique en perpétuel mouvement. Face aux menaces grandissantes, les Etats doivent s’organiser afin d’établir ensemble une cyberdéfense capable d’y faire face.
-
L’émergence d’une gouvernance régionale et mondiale dans le domaine de la cyberdéfense…
A l’échelle européenne, des progrès notables en matière de coopération ont été réalisées. En 2004 est créé l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) dont le but est notamment de promouvoir la coopération entre les Etats membres dans le domaine de la cybersécurité. Néanmoins, ces dernières années l’Union européenne et l’OTAN ont renforcé leur coopération et de nombreux Etats européens se placent sous le bouclier de l’OTAN, acteur majeur de la cybersécurité dans l’Union européenne.
A l’échelle mondiale, un Forum mondial sur la gouvernance de l’Internet (FGI) est créé en 2005, sous l’égide des Nations unies, et a lieu tous les ans afin de débattre sur l’ensemble des politiques publiques relatives à l’Internet et de garantir notamment la transparence, la stabilité ou encore la sécurité de l’Internet. De plus, en 2015, l’ONU a présenté un rapport détaillé sur les comportements a adopté dans le cyberespace et qui incite les Etats à coopérer et à venir en aide aux Etats victimes d’attaques.
A l’heure actuelle, il est plus juste de parler de cybersécurité plutôt que de cyberdéfense dans la mesure où les Etats emploient des moyens permettant de sécuriser les systèmes informatiques et les données sans pour autant mener des actions de défense à proprement parler pour se protéger d’une menace.
-
…entravée par un vide juridique et des Etats refusant tout abandon de leur souveraineté nationale
Les cyberattaques récurrentes ainsi que les liens étroits pouvant exister entre certains gouvernements et des cybercriminels rendent difficile la mise en place d’une coopération internationale dans le domaine de la cyberdéfense. De plus, il existe un vide juridique au sein du cyberespace : il est particulièrement difficile d’accuser avec certitude un acteur d’être responsable d’une cyberattaque. Le droit international ne stipule pas non plus que le droit des conflits s’applique aux conflits au sein du cyberespace car ce sont des conflits virtuels et donc non-physiques. De fait, ce vide juridique rend illégitime le principe même de défense au sein de cet espace.
En outre, avec des Etats souhaitant maintenir une certaine souveraineté numérique sur cet espace stratégique, la coopération risque d’être limitée. En effet, le cyberespace constitue un véritable enjeu de souveraineté et d’affirmation de puissance pour les États. Par exemple, les pays de l’Organisation de coopération de Shanghai, dont fait partie la Chine et la Russie, s’opposent fermement à la mise en place d’une cybercoopération mondiale. La majorité des cyberattaques dans le monde est attribuée à la Russie tandis que pour la Chine, l’enjeu du cyberespace est de taille : cet espace constitue un tremplin pour assoir sa puissance technologique à l’échelle mondiale mais elle permet également d’assoir la légitimité du Parti communiste chinois qui souhaite maintenir le contrôle sur sa population en appliquant notamment une stricte censure au sein du cyberespace.
Guerre russo-ukrainienne : un risque de cyber guerre ?
L’Ukraine est régulièrement victime de nombreuses cyberattaques, attribuées à la Russie, et la menace d’une cyberguerre plane sur le pays depuis l’invasion russe le 24 février dernier. En effet, l’Ukraine a recruté des hackers afin de créer une armée digitale, l’IT Army, comprenant près de 260 000 hackers, prête à mener des cyberattaques visant des infrastructures russes. De plus, le groupe Anonymous a annoncé être en guerre contre le gouvernement russe : ils ont déjà notamment mis hors service 1500 sites russes et biélorusses selon leurs affirmations. L’Union européenne se tient également aux côtés de l’Ukraine en cas de cyberattaques. Les Russes ont également attaqué les satellites de communication ukrainiens dans le but de leur couper tout accès à Internet, ce qui a amené le milliardaire américain Elon Musk à activer son service d’accès Internet par satellite au-dessus de l’Ukraine. De son côté, l’OTAN a annoncé en février dernier son intention de renforcer sa coopération avec l’Ukraine contre les cyberattaques. Les menaces se multiplient et nourrissent un sentiment d’inquiétude de la part des Occidentaux. La Russie aurait menacé, le 12 mars, de provoquer un crash de la Station Spatiale Internationale suite aux sanctions adressées à son encontre.
Des pays comme la Russie, refusant tout abandon de leur souveraineté numérique, constituent donc une réelle menace pour la cyberdéfense des Etats. Par exemple, quelques heures après l’annonce de sanctions japonaises à l’encontre de la Russie, un fournisseur de l’entreprise automobile Toyota a été touché par une cyberattaque le 1er mars, paralysant la chaîne de production pendant une journée. Même si rien ne permet d’affirmer avec certitude que la Russie en est responsable, cela montre la menace que représente un pays ne se conformant pas aux intérêts généraux mondiaux.
Quid de la France ?
De manière générale tous les pays, dont la France, sont en état d’alerte. Un responsable de l’OTAN a déclaré que si une cyberattaque visait un des pays membres de l’OTAN, l’article 5 de la charte de l’OTAN selon laquelle « une attaque contre un membre de l’alliance est considérée comme une attaque dirigée contre tous les alliés », pourrait être déclenché.
Avec l’approche de la présidentielle française, le risque de cyberattaque, d’ingérence de puissances étrangères et de désinformation sur les réseaux sociaux, augmentent également drastiquement.
La France n’est donc pas à l’abri d’une cyberattaque étant donné le contexte actuel. A une échelle plus individuelle, il est nécessaire d’être extrêmement vigilant face aux mails d’inconnus ou autres messages et publications sur les réseaux sociaux. Par exemple, certains mails peuvent inciter à soutenir le président ukrainien alors que derrière ce mail des virus peuvent être dissimulés dans des formulaires demandant des informations personnelles sur la personne. Passer par des messageries chiffrées ou encore activer la double authentification, en confirmant par SMS chaque connexion internet peuvent être des solutions pour se prémunir de ces éventuelles menaces.
Par Jessica LOPES BENTO


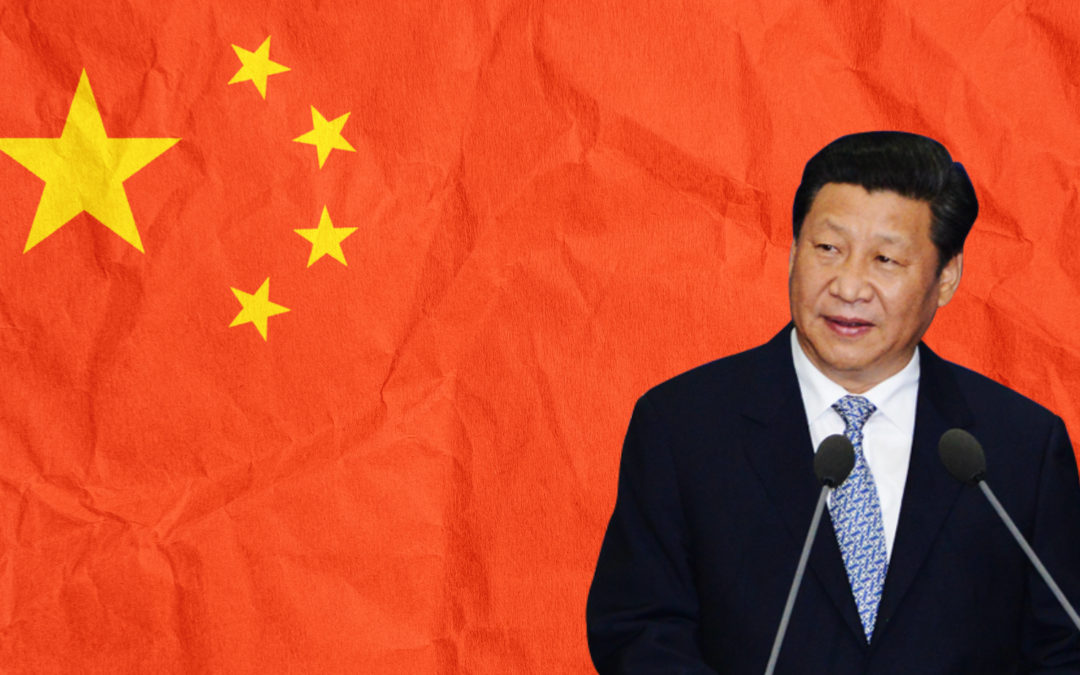
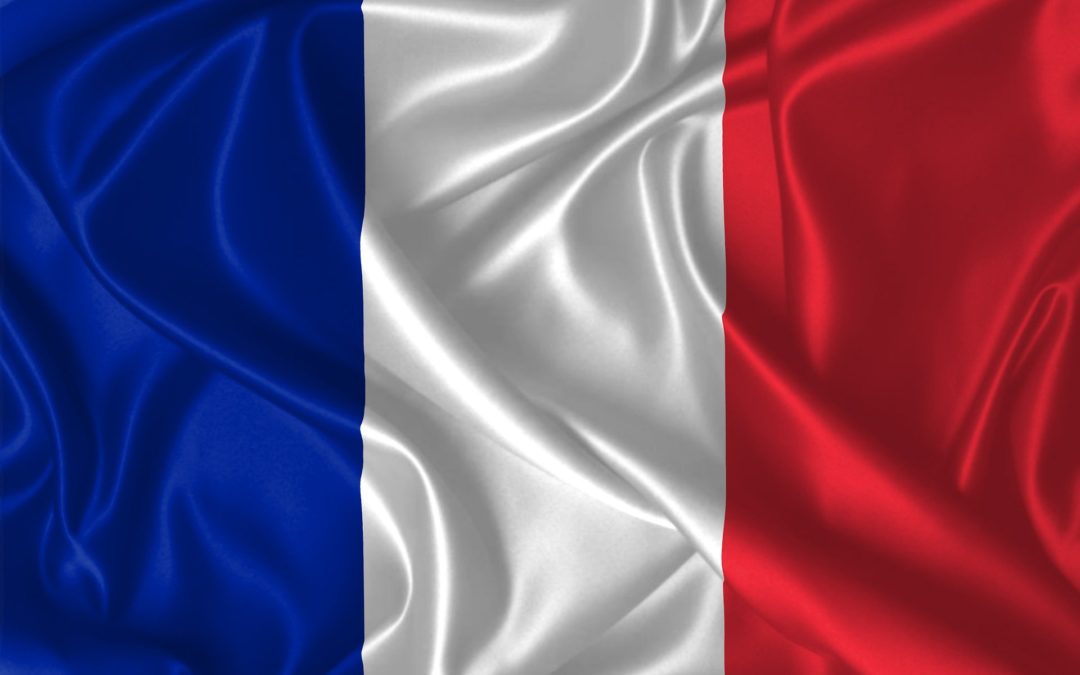







Commentaires récents