
par Sébastien MAGNE | 4 décembre 2015 | Cinéma, Culture, Pop Culture, TBS Press
Parce que je veux continuer d’aller au cinéma, non pas car il s’agit d’un acte de résistance face aux horreurs récentes (comme disent certains faire « comme avant » et
aller en terrasse ne suffit pas) mais parce que j’aime le cinéma tout comme j’aime me battre, j’aime me beurrer la biscotte, j’aime quand on m’enduit d’huile, j’aime les panoramas, j’aime le bruit blanc de l’eau,
enfin bref vous avez compris j’espère!
Nouvelle critique, nouveau format pour ceux qui auraient été traumatisés par la longueur de ma critique sur
Interstellar ou
Gonegirl.J’essaye cette fois d’adopter une forme plus ludique, tout en tentant de répondre aux détracteurs qui voient dans le nouveau « 007 Spectre » l’épuisement d’une collaboration pourtant initialement fructueuse (financièrement et artistiquement) entre Sam Mendès (réalisateur) et Daniel Craig avec comme point de départ le succès: Skyfall.
J’élude le pitch cette fois et je précise au passage qu’il n’y a pas de spoilers majeurs dans cette critique.
1) « un film longuet et ennuyeux »
Je devrais mettre des guillemets et préciser que cette phrase émane d’une personne qui n’aime probablement pas les films d’action (et c’est son droit). Selon moi, difficile de s’ennuyer dans ce 24ème opus de James Bond, tout le monde y trouve son compte : le grand public, les fans de la première heure de James Bond et la critique.
Imaginons un instant la conversation qu’ont peut être tenue Sam Mendès et les producteurs de la Metro Goldwyn Mayer afin de définir le cahier des charges de Spectre :
-
Les producteurs : « Ok Sam, tu es un génie, la critique a encensé Skyfall, et tu nous as pondu le James Bond le plus rentable de tous les temps avec plus d’un milliard de recettes. On ne va pas se plaindre. Notre dernier benchmark indique que ton film a conquis la critique par sa noirceur inédite dans un James Bond (7,8/10 sur IMDB) mais il révèle aussi qu’une partie du public a émis quelques réserves. Je te lis les derniers consumer insights : 1) on en a marre des blockbusters aux tonalités tragiques avec un anti-héro tourmenté par son passé, et ayant un lourd passif familial 2) je ne reconnais plus le charme, le glamour et l’humour des James Bond d’antan dans ces nouvelles productions.
-
Sam Mendès : « ok les gars, je ne sais pas ce que c’est un consumer insight mais donnez-moi 350 millions de dollars. Avec ça je vous fais une pépite qui ravira tout le monde et paiera l’essence de vos yachts cette année ».
Et la lumière fut : on est époustouflés dès la scène d’ouverture. Véritable tour de force technique et spectacle grandiose. Tour de force technique car il s’agit d’un long plan séquence (plan couvrant toute une séquence sans coupure ni montage apparent) ayant mobilisé des moyens financiers immenses et plus de 1500 figurants. C’est une technique décidément à la mode puisque la maîtrise de celle-ci avait mis en lumière le génie d’Alejandro Gonzalez Inarritu récompensé de l’oscar du meilleur réalisateur pour son film Birdman en 2014. Moins souvent mentionné c’est aussi le merveilleux travail d’Emmanuel Lubezki (aussi présent sur le tournage de Gravity) avec sa steadicam qui avait permis de tourner Birdman en un seul plan séquence, prouesse rarement (ou jamais) vue dans la profession (et là vous comprenez que j’avais aussi préparé une critique pour Birdman mais que je ne l’ai jamais achevée…).

Mais revenons à notre brave Écossais : dans cette scène d’ouverture magistrale se déroulant en pleine fête des morts à Mexico on suit Bond à la poursuite d’un terroriste italien. Le héro est filmé de dos à la manière d’un jeu vidéo à la première personne. Cette scène d’ouverture donne le ton : ballet mortuaire, course poursuite, combat à mains nues dans un hélicoptère, le rythme est là. Elle montre les envies nouvelles de Mendès et de Craig pour Spectre : innover une nouvelle fois dans la mise en scène tout en effectuant un certain « retour aux sources » qui ravira les puristes. Avec comme inspiration la mort aux trousses (1959) d’Alfred Hitchcock, Mendès a voulu faire de Spectre un film d’action à l’ancienne : immersif et réaliste. Pour cela, exit le numérique (là aussi c’est tendance, cf
Star Wars 7), on retourne au cinéma old-school avec un film tourné en 35 mm. On retrouve également des scènes de courses poursuites en voitures grandioses et sans trucages (si’il y a une chose à ne pas manquer c’est la scène de course poursuite à Rome entre la Jaguar et l’Aston Martin DB 10 de Bond).
Aussi, on retrouve certains ingrédients cultes de la série qui semblaient avoir disparus dans les précédents volets et qui réapparaissent dans ce film. Notamment une petite pointe d’humour à l’anglaise : quand James Bond atterrit dans un canapé après une chute de 20 mètres suite à une explosion, et réajuste sereinement ses boutons de manchette. L’humour n’est pas absent et plus encore on trouve cette fois une certaine dérision très plaisante à entendre. Par exemple : on se souvient du fameux « qu’est ce que j’en ai à foutre » adressé au Barman qui demande à Bond dans Casino Royale s’il préfère son cocktail au shaker ou à la cuillère, et bien dans Spectre on retrouve également un face à face assez hilarant avec un Barman qui propose cette fois à Craig un cocktail bio sans alcool (je vous laisse deviner la réaction du personnage). Ainsi cette séquence montre comment le James Bond tourmenté « version Craig » qui enchaîne les vodka-martini se retrouve dans une situation à la limite du grotesque dans un bar « bio sans alcool ». Les codes qui donnaient une « tonalité grave et sombre » à la série des James Bond des années 2000 sont donc tournés en dérision.
Enfin, Sam Mendès
a déclaré : « 007 SPECTRE évoque en effet les classiques de la franchise à travers les véhicules, le ton, l’éclairage et même la coupe du costume de 007, mais je tenais également à renouer avec le glamour des destinations lointaines et exotiques des premiers James Bond, et le pousser à l’extrême. »
Et bien c’est chose faite des cimes enneigées autrichiennes au Maroc, on voyage dans ce film d’action immersif qui sait être dramatique dans la lignée de la saga de Daniel Craig mais aussi drôle et divertissant quand il le faut. Bref on ne s’ennuie pas.
2) « Daniel Craig est rouillé »
Certes Daniel Craig prend quelques rides et perd des cheveux, en revanche son allure, son énergie et ses yeux, ne dépérissent pas avec l’âge et les breuvages qu’ils consomment parfois comme 007.
Craig déclarait d’ailleurs dans le GQ de Novembre 2015 « le seul vrai point commun que j’ai avec Bond c’est l’alcool. Le pub c’est bien mieux que les réseaux sociaux pour se faire des amis ».
A 49 ans Pierce Brosnan dans Meurs un autre jour passait pour un vieux croulant. En effet ce « vieux beau » trop entretenu n’était plus crédible en homme d’action. Craig, à 47 ans dans cet opus, reste tout à fait convaincant avec l’âge. Sa crédibilité en James Bond il ne la tient pas d’un teint hâlé et d’une coupe à l’anglaise comme Pierce Brosnan mais plutôt il la doit à son allure.
En effet l’allure de Bond est plus que jamais mise en avant dans cet opus. Il est souvent filmé avec des plans à la première personne décortiquant sa démarche (son roulement d’épaule, son menton relevé plein de fierté et ses pas assurés) et des scènes qui ressemblent parfois à des défilés de mode en plein air. On notera au passage que jamais un Bond n’aura autant changé de tenue : choix de mise en scène pour mettre en valeur l’acteur ou stratégie marketing pour financer ce projet pharaonique, nous allons analyser cela à présent justement.
3) « Spectre est un spot publicitaire géant »
Oui, il est indéniable que James Bond suscite toutes les convoitises auprès des marques. Avant c’était surtout des marques de luxe (Aston Martin, les montres de luxe comme Rolex et Omega) qui se battaient pour apparaître à l’écran. Mais à présent ce sont toutes les marques qui tentent de se faire une place sur celui-ci : Heineken, la vodka Belvédère, la Fiat 500. Et même des pays comme le Mexique se prêtent au jeu. Le gouvernement mexicain se serait même assuré qu’une bonne image de son pays soit donnée en demandant une modification à la dernière minute du scénario de Spectre en échange de la coquette somme de 14 millions d’euros selon le site Tax Analyst(information révélée à la suite d’une fuite).
La pratique des placements de produits (et de pays) n’est bien sûr pas inédite dans les James Bond, ni dans les autres productions d’ailleurs (on se souvient du succès des lunettes de « Men in Black »dans les années 90 ). Mais pour Spectre on doit être proche des records avec
21 placements de produits bien visibles, peut être un peu trop visibles me direz vous…
On comprend bien l’intérêt pour les producteurs qui ont pu financer les 350 millions d’euros alloués à Spectre grâce à ses partenariats juteux (pour vous donner une idée Heineken avait déboursé 45 millions d’euros pour que James se mette à la bière dans Skyfall). Néanmoins cela doit poser bien des contraintes à ceux qui « font le film » puisqu’ils doivent veiller à mettre en valeur chaque produit proportionnellement à l’investissement consenti.
Peut-on pour autant limiter Spectre à un spot publicitaire géant ? Certains diront que les marques viennent piquer la vedette aux acteurs par moment, en effet la montre Omega de Bond joue un rôle crucial dans le film et apparaît peut être plus à l’écran que Miss Moneypenny ! On notera aussi le côté totalement assumé et décomplexé de ces placements : Q (le fameux inventeur des gadgets de James Bond) en vient même à présenter la nouvelle Omega comme le ferait un horloger en insistant bien sur sa marque.
Mais dans le film d’autres marques et produits sont plutôt au service de la beauté et du spectacle. En effet quel plaisir pour le spectateur d’admirer les performances de l’Aston Martin DB 10 dérapant au bord du Tibre et de découvrir à chaque changement de décor une nouvelle pièce de la magnifique collection des costumes Tom Ford.
Ainsi les placements de produits ne viennent pas totalement dénaturer Spectre pour le transformer en spot publicitaire dépourvu de sens et d’émotions. Au contraire les placements de produits se mettent au service du spectacle et servent d’une certaine manière le réalisateur qui compose avec des accessoires déjà beaux et spectaculaires par essence.
4) « Un script vu et déjà vu »
 Oui, comme mentionné précédemment, on commence à être lassés des histoires de famille, des fantômes du passé, des anti-héros torturés en quête de rédemption. Mais laissons au moins le mérite à ce « 007 Spectre » de soulever une problématique intéressante : la question de la surveillance face aux libertés individuelles et ses dérives possibles. Mendès tente ainsi une nouvelle fois de s’en tenir à un principe qu’il évoque dans un entretien pour le journal Telerama « Il doit y avoir une façon de combiner le divertissement et la présence, discrète mais perceptible, d’un discours, un point de vue articulé sur le monde dans lequel nous vivons. ».
Oui, comme mentionné précédemment, on commence à être lassés des histoires de famille, des fantômes du passé, des anti-héros torturés en quête de rédemption. Mais laissons au moins le mérite à ce « 007 Spectre » de soulever une problématique intéressante : la question de la surveillance face aux libertés individuelles et ses dérives possibles. Mendès tente ainsi une nouvelle fois de s’en tenir à un principe qu’il évoque dans un entretien pour le journal Telerama « Il doit y avoir une façon de combiner le divertissement et la présence, discrète mais perceptible, d’un discours, un point de vue articulé sur le monde dans lequel nous vivons. ».
D’aucuns ont regretté le choix de la facilité effectué par l’équipe de Spectre pour le casting :Christoph Waltz dans la peau du méchant (comme dans Inglourious Basterds ) et Monica Bellucci dans le rôle de la veuve d’un mafieu Italien. Personnellement ça ne me pose aucun problème. Dans la mesure où ils savent si bien jouer ces rôles pourquoi se passer d’eux ?
5) « une Monica Bellucci flétrie »
Que nenni (oui j’ai osé placer cette expression)! Elle fait une apparition plutôt brève dans le film, ce qui est regrettable car il ne lui faut pas plus de deux répliques dans un décor de rêve (villa romaine somptueuse) pour rayonner tout en tissant un brouillard mystérieux autour de sa personnalité. Elle joue très bien le rôle de « la James Bond girl classique » qui feint d’être inaccessible avant de s’offrir à Bond. Sam Mendès se permet même une nouvelle fois de jouer avec les codes traditionnels de la série avec ce personnage. Notamment, on est à la limite de la caricature machiste lorsqu’après un baiser et le fameux « mon nom est Bond, James Bond » puis une ellipse, on retrouve Monica en porte-jarretelles sur le lit sur un plan large d’une chambre somptueuse durant laquelle on ne manquera pas bien sûr d’admirer la décoration…

Elle est tout en contraste avec la bien nommée Léa Seydoux, (Madeleine Swann dans Spectre) elle aussi magnifique mais d’une autre manière. Madeleine incarne la James Bond girl nouvelle génération dans la lignée de Vesper Lynd jouée par la non moins somptueuse Eva Green dans Casino Royal. Fière, indépendante en apparence, son charme réside dans ce regard qui nous défie en même temps qu’il dégage une certaine fragilité. Sans attache, aventurière et pleine de ressource elle forme la paire parfaite avec Bond et donne une note de fraîcheur indéniable à la saga avec sa beauté si singulière et son jeu des plus naturels (en d’autres mots, elle ne sur-joue pas).
Voilà je vous ai exposé 5 critiques majeures du film entendues dans mon entourage auxquelles j’ai tenté de répondre (vous pouvez m’exposer les vôtres sous la même forme ou répondre aussi à ma vision du film). J’insiste encore : que vous ayez aimé ou non le film et ma critique n’hésitez pas à commenter, je serais ravi d’en discuter avec vous !
C’est tout pour moi, à bientôt pour la prochaine critique ciné !
Sébastien Magne
![[VU PAR] Paris, vue par une ex-Toulousaine](https://rdvc.fr/wp-content/uploads/sites/11/2015/11/20150130_154814-1.jpg)
par Admin TBS DSI | 21 novembre 2015 | Culture, TBS Press
Paumé à Paris
Guide Du Toulousain
Pour retrouver son chemin
Toulouse et Paris ne semblent fonctionner ni sur la même pendule, ni à la même heure (à la bonne heure, me direz-vous ? … Non, ça c’est Marseille, les gars) ! Et pour un Toulousain, le Parisien paraît incompréhensible –et inversement. Tandis que le Parisien est un râleur invétéré, le Toulousain fait figure de bon pote. Quand le Parisien semble tout le temps pressé, le Toulousain s’accorde un « quart d’heure » pour décompresser.
Oui, c’est vrai … Toulouse / Paris, c’est plus de 8 heures de train, plus de 6 heures de voiture, et plusieurs heures de décalage en terme de mode de vie. Et pourtant… Toulousain tu resteras, mais Toulousain, tu t’adapteras, aussi.
Alors d’abord, et parce que j’adore sortir les grands gros clichés, voici en images pourquoi un Toulousain perd son chemin à Paris…
Oui oui oui … tandis que Paris rime avec Pressé – Compressé (dans le métro) – je dirai même plus Con Pressé – Toulouse chante et respire le Retard – Flemmard – Fêtard – Soiffard.
Quand les Toulousains s’agglutinent dans les bars place saint Pierre pour s’aligner les pintes de bière en matant le match de rugby, les Parisiens guillerets s’assoient bien gentiment en terrasse pour siroter des cocktails ou des verres de blanc, rosé, ou rouge et jeter, de temps à autre, un œil vers la TV qui rediffuse le PSG.
Paumé à Paris ?
Voici mes bonnes adresses
Tu ne retrouves pas la bière cheap et le traditionnel “collé-serré” du foyer ?
Retiens bien cette adresse, Au Taquet !
« Et bien quoi, au taquet ? Balance le doss, je suis au taquet oui … »
Au TAQUET te dis-je, 19, rue Bleue, Paris 9. C’est le bar cheap de Paris, à 2 euros le demi, 2.50 euros la bière et 4 euros le cocktail en Happy Hour (HH pour les intimes). Et les HH, c’est all night long dans ce bar où tu ne vois plus le bar avec son habituelle surabondance de petits parisiens fauchés.
Si tu te demandes comme moi « Mais où est passée la nature ? Où se sont cachés les arbres ? »
Je te répondrais : « ne désespère pas ». Il y a aussi des coins de verdure à Paris j’ai nommé « les parcs ». Si tu aimes le Luxembourg, alors passe ton chemin, je ne peux vraiment rien pour toi : tu es citadin. En revanche, si la nature dans ce qu’elle a de sauvage et d’indompté te plait … alors suis-moi jusque le Parc des Buttes Chaumont, mon parc préféré à Paris. Il a ce petit côté « wild » que je ne saurais trouver ailleurs, ni dans les structures futuristes et les grandes pelouses de La Villette, ni dans les parcelles végétales du Jardin des Fleurs, ni dans les allées feuillues des Tuileries. Les Buttes Chaumont, c’est l’association de la colline, de la falaise et du ruisseau. Mais aussi du joggeur, de la famille et du promeneur du dimanche. Là-bas tu pourras te ressourcer, prendre un grand bol d’air et de silence avant de replonger dans les affres de l’agitation, du bruit et de la pollution.
Le rugby te manque terriblement ?
Il n’y a malheureusement pas de solutions. Sauf si tu es une fille, et que par « rugby » tu entends davantage « rugbymen », autre synonyme de « beau mec musclé, de quoi me rincer l’œil ». Auquel cas je te conseille vivement de prendre abonnement chez NEONESS. Neoness, c’est une salle de fitness et de musculation avec les tarifs les plus bas sur Paris (si si …) et une accessibilité défiant toutes les autres salles.
Neoness, c’est un plateau de cardio et un plateau de musculation pour 15 EUROS / MOIS pour un forfait SIMPLYNESS (accès heures creuses) et 25 EUROS / MOIS pour un forfait FREENESS (accès à toute heure) +2 EUROS / MOIS en prélèvement mensuel sans engagement.
Neoness c’est aussi de nombreuses salles disponibles sur Paris (une dizaine) et une possibilité de te rendre, muni du pass, dans n’importe quelle salle.
Neoness c’est, enfin, des beaux mecs (et de très jolis filles aussi), jeunes, dynamiques, qui viennent se défouler en soirée avec une dure journée de travail. Moi, je dis ça … je dis rien !
Si tu te souviens avec mélancolie du Canal de Brienne et du Canal du Midi
Alors je te conseille vivement, très vivement, une de mes balades favorites : remonter le canal Saint-Martin jusque Canal de l’Ourcq et La Villette. Il y a certes beaucoup moins d’arbres qu’à Toulouse, mais c’est tout de même une balade reposante … à fleur de flots. Le canal est un lieu familial en journée, et festif le soir. Les jeunes viennent prendre l’apéro ou boire binouzes ou vinasses à bas prix entre deux œuvres de street art. Pétanque et jeux, pédalo le printemps, Paris Plage en été.
Nostalgique du petit déjeuner Cosy entre Amies ?
Paris a mis le « brunch » au goût du jour. Le samedi et le dimanche matin, de nombreux Parisiens sortent pour aller déjeuner dehors, sous le soleil matinal d’un week end automnal. Et en matière de brunch, à Paris, tout se fait.
S’il y a une adresse à retenir, je dirais « rue des Martyrs ». Cette rue qui monte jusque Montmartre et descends jusque Notre-Dame-de-Lorette, est une concentration de petits cafés et restaurants, salons de thé … et un quartier très animé le dimanche pour « bruncher ». Quelques exemples :
Pour la meilleure copine, ou le petit copain, original et « healthy », fait maison
Pour la famille, pour bien manger, beaucoup, bon, et traditionnel (atmosphère chaleureuse avec les meubles en bois).
Pour les hipsters ou les Parisiens un peu classe mais un peu melon. Un peu cher aussi.
Pour les addicts des desserts anglo-saxons ou les apprentis du BIO
Tu as laissé ton chat à Toulouse, et nos amis les animaux te manquent ?
Tu pourras te réconforter avec le Café des Chats. Le Café des chats, c’est un restaurant avec dedans une quinzaine de chats adoptés pour le plus grand plaisir des clients. Ils sont ici chez eux, et investissent les chaises, les dessous de table, le piano et les fauteuils en cuir. Ils viennent jouer avec les clients et cherchent parfois la caresse, mais la plupart du temps, ils passent avec indifférence, sauf quand arrive ton assiette. Deux établissements sur Paris, à Bastille et dans le Marais. Un service très sympathique. C’est un peu cher (mais correct pour Paris, compter environ 15 euros / plat) et les plats ne sont pas fous (encore une fois, correct) pour y manger un repas. En revanche, leurs desserts –leur chocolat et leur cheese cake en particulier- valent le détour !
Si tu veux retrouver la quiétude des bords de Garonne
Gros spot sur la Seine et ses lumières brouillées se reflétant sur les bleus et bruns des flots. Sur Quai d’Orléans, au bord de l’eau et face à Notre-Dame, les cygnes viennent rendre visite et les flots lèchent la rive dans un flux et reflux mimant le chant de l’océan. Dans ce clair-obscur improvisé, la Seine murmure et parfois, éclaire les visages à coup de vedettes et de croisières touristiques.
« Partager
Un cigare et un ciel
Habiter
Un fragment de trottoir
Murmurer
Nos silences et nos peines
Aux pavés
Fumer tous nos déboires »
Si tu désespères de ne pas manger copieusement
Je te recommande chez Gladines, boulevard Saint Germain, Paris 5 (ou d’autres sur Paris). Chez Gladines, c’est un peu la cuisine du sud-ouest (cuisine Basque pour être plus exacte) qui se fait la malle ici à Paris. Outre les prix qui sont très corrects, les plats sont goûteux et copieux. Entre 8 et 10 euros pour une grosse (ENORME) salade pour les petits joueurs. Compter 14 à 16 euros environ pour des plats de viandes, accompagnés de leur pommes dorés ils sont vraiment tasty. Le tout dans une ambiance sixties in the USA, avec les murs rétro tapissés de visuels de Marylin.
Si tu ne sais plus où faire tourner ta roue
Si comme moi tu as adopté le vélo, et que tu désespères de pédaler dans Paris : et bien sache que tu n’es pas seul ! Faire du vélo tout en étant en sécurité relève du quasi miracle dans la capitale. Le meilleur moyen de limiter le danger est de connaitre le terrain, car il existe bien des zones agréables pour une balade tranquille à vélo (mais il faut les connaitre). Le boulevard de Rochechouart jusqu’à Pigalle est très sympathique : séparés des piétons du terre-plein central, et des voitures, les vélos ont leur voie tout le long du boulevard, et de quoi se rincer l’œil puisqu’ils peuvent passer par de grandes salles de concert et spectacles : Moulin Rouge, La Boule Noire, Le Chat Noir, La Cigale, Le Trianon. Il y a aussi la balade du Canal de l’Ourcq jusqu’à La Villette et bien au-delà encore, hors des murs de Paris. Enfin, les quais sont une valeur sûre, mais il faut connaitre les pistes cyclables qui ne sont pas toujours immédiatement visibles.
Si tu ne retrouves pas ton dessert toulousain préféré, le Banoffee
Adopte les alternatives : le cheese cake, ou le macaron se trouvent bien plus aisément dans la capitale ! Je te conseille le cheese cake (j’en ai testé beaucoup) de chez Supernature si tu l’aimes léger, de chez French American Bakery si tu l’aimes traditionnel, de chez Rachel’s si tu cherches des saveurs originales.
Côté macaron, je suis une inconditionnelle de l’ISPAHAN (Rose-Framboise-Litchi) de chez Pierre Hermé. Tandis que La Durée fait des saveurs classiques (chocolat, fraise, vanille, pistache… oui, mais encore ?), Pierre Hermé innove avec ses Menthe-Fraise ou Fruit de la passion – Orange – Cheese cream.
Mais si tu insistes vraiment … voici la seule et unique adresse où j’ai pu dégoter un Banoffee Cake : Biocoop DADA rue du Paradis. EN l’occurrence, cette rue porte bien son nom. Ce magasin Bio est une petite perle à lui tout seul, avec une sélection de produits super bons et bios (un peu cher) et très diversifiés, des pains originaux (céréales, seigle, son, aux fruits et noix), et surtout, des pâtisseries comme on n’en trouve pas ailleurs (gâteau pavot citron, gâteau au potiron…) dont le fameux Banoffee.
Si tu aimes faire ton marché et te gaver de produits frais
Tu peux dans ce cas venir faire ton marché dans le 10e arrondissement, rue du Faubourg Saint-Denis juste derrière la porte Saint-Denis. Cette rue concentre à elle seule les enseignes citadines classiques : Carrefour City, Monoprix, Franprix – mais aussi du low cost avec Lidl – et enfin et surtout du primeur où acheter mille et une sorte de fruits et légumes frais différents – du boucher, du poissonnier, du fromager, de l’épicerie fine avec Julhès qui est mon petit coup de cœur (vins et spiritueux, sauces, thés, épices, confitures, sirops …). Si tu as soif de produits étranges et du monde, il y a beaucoup de petits magasins tenus par des indiens, tu peux donc découvrir de nouveaux produits et goûter aux saveurs venues d’ailleurs (de toute façon dans ma rue, tu voyages rien qu’au visuel … on ne se croirait pas à Paris, ça change des Champs Elysées !).
par Admin TBS DSI | 22 octobre 2015 | Cinéma, Culture, TBS Press
Guillermo Del Torro. Cinéaste mexicain dont l’univers fantastique aura été mis au service de nombreuses productions dont il n’a pas été lui-même le réalisateur (Le Hobbit) mais dont on pourrait deviner l’influence. Nombreux sont ceux qui se souviennent encore de « l’Orphelinat », film d’horreur ayant dissuadé plusieurs personnes de sortir de leur lit en pleine nuit pour n’importe quel raison.
L’arrivée de cette affiche évocatrice aurait pu laisser penser qu’un nouveau pas sur le chemin de l’épouvante va être fait. Les amateurs du genre vont être décontenancés. En bien ou en mal. Et ce pour plusieurs raisons.
Tout simplement parce qu’il ne s’agit pas d’un film d’horreur. On aurait pu vous laisser penser que les fantômes, ces êtres aux silhouettes et à la démarche si reconnaissable sont le clou du spectacle et les gardiens des clés de l’horreur que contient ce film. S’il s’avère qu’ils ont un autre rôle à jouer, force est de constater aussi qu’ils ne sont pas les plus à craindre dans ce manoir anglais où tout va se jouer…
Amateur de grands frissons, passez votre chemin ! Les scènes de peur et d’effroi ne deviennent que trop évidentes et attendues et vos yeux aguerris auront vu bien pire. Ce n’est pas que le talent de M. Del Torro s’est fané, cela est sans doute dû au fait que le but de ce film n’est vraiment pas de nous faire peur.
Non décidément, ce n’est pas la peur qui domine ce récit très ancré dans la tradition du Romantisme noir et des récits gothiques d’une Angleterre à l’avant-garde de la Révolution industrielle. En réalité nous sommes bien au contraire fascinés par les personnages que nous voyons évoluer sous nos yeux. Il faut dire que le trio de tête brille par la façon dont ils se sont imprégnés de leur personnage. Qu’il s’agisse de Tom Hiddlerton ou de Jessica Chastain, ces deux sombres figures ont un physique taillé pour leur rôles ; un hommage devra être rendu à tous ceux qui les ont transformés en des personnages tout droit sorti de romans de Julien Green ou des films d’Hitchcock. Jessica Chastain, visage de damnée, regard sinistre ; cela restera en vous bien après votre sortie de salle. Il ne faudrait pas oublier Mia Wasikowska dont le rôle est loin de la cantonner à la pauvre blonde sans défense ballotée dans l’intrigue comme une enfant sans caractère dans un train fantôme. Il sera pour une fois plutôt évident de s’identifier à un personnage principal de film d’horreur.
Fourmillant d’idées sorti d’un cerveau un peu dérangé tout de même (de l’argile rouge, une vision singulière des papillons…Entre autre !) ce film frappe surtout par son immense qualité esthétique. Des fantômes au manoir en passant par les costumes et l’environnement alentour, tout est fait pour que ce film devienne un cas d’école pour les jeunes réalisateurs, et au vu de nombreux plans de caméras, pour les peintres et les photographes.
Allez le voir pour vivre une expérience visuelle avant tout mais certainement pas pour l’originalité du thème ou la peur qu’il puisse créer. Les amateurs du scénario d’« Inception » en prendront pour leurs frais, les surprises ne sont pas au rendez-vous. Mais vous garderez cette image d’un vieux manoir hanté par les ombres du passé, consumé par la neige au-dessus et l’argile pourpre d’en-dessous. Vous serez témoin d’un domaine taché irrémédiablement par un crime odieux que vous auriez pu vous épargner de vivre si vous réfléchissiez davantage aux avertissements que des êtres chers vous ont laissés… « Beware of Crimson Peak !»
 |
| Jessica Chastain, comme vous ne l’avez jamais imaginé |
Antoine Lezat
par Sébastien MAGNE | 14 juillet 2015 | Culture, Politique, TBS Press
Un 14 Juillet pas comme les autres
Le 11 Janvier 2015, la France a été secouée par une grande tragédie avec les attentats de Charlie Hebdo. S’en est suivi un mouvement d’unité nationale sans précédent qui a redonné de l’espoir à un pays qu’on a tenté d’apeurer, de diviser en faisant croire à ses citoyens que le multiculturalisme et les valeurs de la République française comme la liberté n’étaient pas ou plus compatibles. Le 11 Juillet 2015, Manuel Valls tweetait: « 6 mois après le 11 janvier, toujours Charlie » comme pour rappeler aux Français que personne ne devait oublier ce qui avait poussé les gens à descendre dans les rues comme le firent d’autres le 14 Juillet 1789.

J’ai été très ému par ce feu d’artifice du 14 juillet cette année qui selon moi portait un message bien plus fort que les années précédentes alors que nous sommes plongés en pleine période de doutes, de peurs et de manque de confiance en l’avenir de notre pays. Et je vais ici tenter de vous expliquer quels ont été les principaux messages que j’ai perçu dans cette démonstration pyrotechnique et musicale:

Déjà charmé par une belle soirée musicale en compagnie de l’Orchestre National de France , j’ai été également séduit par un feu d’artifice magnifique tiré depuis la tour Eiffel au dessus et vers la ville des Lumières! Ce show nous le devons au Groupe F, le plus grand artificier du monde, qui a notamment réalisé les spectacles de la Clôture de la Coupe du Monde 1998. Tiens donc, la coupe du monde, cela prend un sens tout particulier ici, n’était-ce pas suite à la victoire des bleus qui étaient alors « nos bleus » que nous avions tous ensemble, citoyens et classe politique, célébré le multiculturalisme, la force de notre nation métissée qui avait battu le Brésil, grande nation d’un métissage « heureux » où le mélange des cultures a fait naitre une puissance créatrice qui se retrouve dans son football, ses musiques et danses! On peut donc saluer ici le choix de solliciter à nouveau ces artistes dans cette période où l’altérité est en danger.

J’ai perçu plusieurs tableaux, il ne s’agira pas là de décortiquer un feu d’artifices mais de vous en montrer le message politique:
Dans une première partie, la tour Eiffel était illuminée avec des couleurs nobles, le doré prédominait, les lumières donnaient à celle-ci un aspect majestueux. Des feux jaillissaient dans toutes les directions, sur un air de Vivaldi. Là je vis la France des Lumières, la France majestueuse, qui rayonnait dans le monde entier comme ces feux qui semblaient se diriger dans toutes les directions et se déverser vers tous les points cardinaux.
Puis il y eut une transition: tout à coup, les lumières s’assombrirent et la douce voix d’Adèle retentit au dessus des toits de Paris. « Skyfall », titre suffisamment évocateur pour nous rappeler que la France cette année a vécu des heures sombres mais que nous pouvons et nous devons encore lutter ensemble contre le terrorisme, contre les stigmatisateurs, les déclinistes qui divisent, apeurent et ne croient plus en la tolérance, l’altérité, l’ouverture d’esprit qui firent la grandeur de la France. « Let the sky fall, When it crumbles, We will stand tall, Face it all together » (Laisse le ciel tomber, quand il s’effondre, on est encore grand, ensemble on fait face à tout), le message est clair et beau à la fois. Une musique grand public qui délivre un message universel, quoi de mieux comme transition. Mais comment lutter alors face à ce ciel qui s’effondre, face à cette France sur le déclin comme la décrivent certains?
C’est la deuxième partie du feu d’artifice qui veut nous montrer des sources d’espoir:
Via un jeu de lumière projeté sur la tour Eiffel, je vis des personnages qui traversaient de gauche à droite la tour, puis une fois arrivés à l’extrémité droite de celle-ci, toquaient comme s’ils voulaient passer une porte. C’est donc ici la France comme terre d’accueil qui était figurée.
Là changement de décor, on se retrouva alors plongés dans une ambiance « multiculturelle », d’abord des musiques aux sonorités africaines, asiatiques, orientales, puis des rythmes antillais endiablés qui via un jeu de lumière amusant faisait remuer « le popotin » de Mme la Tour Eiffel! Ce tour du monde musical se clôtura par une samba brésilienne. Peut être était-ce là un rappel de notre belle victoire face au Brésil en 1998, ou cela évoquait-il ce vers quoi notre pays devait tendre: la célébration du métissage qui est un modèle au Brésil.
Comme pour appuyer encore ce message, le final fut accompagné d’une Marseillaise revisitée avec une instrumentation originale aux empreintes africaines, asiatiques, orientales comme pour montrer que la Marseillaise demeurait un symbole inaliénable de notre nation mais aussi que chacun pouvait la chanter à sa manière (du moment qu’on la chante tout va bien)!
Et alors suite à « cette scène », la tour Eiffel s’illumine à nouveau, la France est forte, elle brille de milles feux, des feux qui forment des cercles, des brins semblables à ceux de l’ADN comme pour mieux figurer l’unité. C’est l’happy ending, une musique épique retentit, une musique Hollywoodienne, la bande originale d’ET composée par John Williams, quel meilleur symbole pour célébrer ensemble l’altérité et l’amour de l’autre au delà des différences.
Sébastien Magne
par Admin TBS DSI | 22 mars 2015 | Culture, TBS Press, Vie de l'école
La mousse est la chose la plus légère du monde. Même l’éther, quintessence parmi les essences, ne peut rivaliser face à cette substance bullesque. Chaude ou froide, bouillante ou frigorifiante, la mousse mousse dans tous les cas. Qu’elle sorte d’un goulot, d’un tube ou d’un verre, elle rafraîchit, rebondit, mystifie les êtres inanimés.
Lorsque la mousse est moussaka, elle nourrit, redonne force aux Spartiates, qui, une fois sustentés, courent facilement un marathon en apnée. La mousse apparaît dans toutes les étapes de sa préparation en moussaka. Une fois les aubergines cueillies, de la mousse odorante et goûteuse jaillit de la fraîche blessure. Puis, de la mousse apparaît à la commissure des nervures des feuilles une fois frites dans une poêle tefal. C’est encore la mousse qui apparaît dans la bouche de l’ingurgitant gargantuesque de cette moussaka chaude et moelleuse, qu’il tient en apesanteur devant lui. Ainsi la mousse apparaît et disparaît tout au long du processus.
Sur le pont d’un navire, les voiles massives claquent au vent, et la coque fend l’eau soumise, projetant là encore de la mousse laiteuse et fragile sur les versants. Joyeuse, elle bondit et se mue de masse sans vie à une tourbillonnante matière qui virevolte dans les airs avant de disparaître et de réapparaître un peu plus loin, juste à l’endroit de contact de la coque et de la mer. Depuis la hune, l’œil vif et perçant des moussaillons considèrent la mousse comme la seule chose qui les unit au monde. Insignifiante mais essentielle, elle permet aux marins de se rendre compte que le bateau court sur les flots et prévient les marins de la folie.
La mousse est le souffle magique qui fait se mouvoir les visages. C’est elle qui donne à une personne son âme, ses expressions, ses mimiques et son genre. Frissonnant les cheveux, faisant s’onduler les doux poils soyeux de la barbiche, la mousse donne le caractère aux trait. Elle façonne les expressions, fait tourbillonner les idées à l’intérieur du cerveau. La mousse transporte, elle fait s’émoustiller l’humain. Masse compacte, jaillissante, joyeuse, la mousse surprend et assure la cohésion entre psychique et physique.
Nonobstant ce constat positif et heureux, la mousse est une matière également malicieuse et parfois destructrice. Voici la mousse sortant du canon de pistolet. Provoquant la mort, elle fait corps avec la fumée. La mousse est ici noire et grimaçante. On retrouve son passage dans les résidus noirs et poudreux une fois la fusillade terminée. La mousse est responsable de nombreux duels, et de la mise en terre de quantité de mousquetaires.
Malgré tout, rien n’est plus pur que la mousse. Sortant d’un tuyau fait de chair pour se retrouver dans une cave, elle aussi, faite de chair, elle s’immisce dans tous les interstices et se répand à gauche ou à droite, cela dépend. Elle commence alors son périple dans un canal resserré, long et plein de dangers. Arrivée à son but, elle percute un ovale resplendissant et merveilleux. Une fois insérée dans cet ovale, la vie commence et de la mousse réapparaît aux bordures de la cave abondante 9 mois plus tard.
La mousse est donc la sixessence universelle et invisible. Changeante, n’apparaissant que par intermittence et toujours avec discrétion, elle donne la vie, présente la mort, mais, avant tout, fait tourner la roue de l’existence et met en place la motricité de la Nature. C’est la mousse qui donne le la de la vie, qui fait tout vivre et donne l’impulsion à la vie. Belle est la mousse, d’où la volonté de certaines personnes de se faire mousser.
Les Orgi’Arts
Antoine Lezat

 Oui, comme mentionné précédemment, on commence à être lassés des histoires de famille, des fantômes du passé, des anti-héros torturés en quête de rédemption. Mais laissons au moins le mérite à ce « 007 Spectre » de soulever une problématique intéressante : la question de la surveillance face aux libertés individuelles et ses dérives possibles. Mendès tente ainsi une nouvelle fois de s’en tenir à un principe qu’il évoque dans un entretien pour le journal Telerama « Il doit y avoir une façon de combiner le divertissement et la présence, discrète mais perceptible, d’un discours, un point de vue articulé sur le monde dans lequel nous vivons. ».
Oui, comme mentionné précédemment, on commence à être lassés des histoires de famille, des fantômes du passé, des anti-héros torturés en quête de rédemption. Mais laissons au moins le mérite à ce « 007 Spectre » de soulever une problématique intéressante : la question de la surveillance face aux libertés individuelles et ses dérives possibles. Mendès tente ainsi une nouvelle fois de s’en tenir à un principe qu’il évoque dans un entretien pour le journal Telerama « Il doit y avoir une façon de combiner le divertissement et la présence, discrète mais perceptible, d’un discours, un point de vue articulé sur le monde dans lequel nous vivons. ». Elle est tout en contraste avec la bien nommée Léa Seydoux, (Madeleine Swann dans Spectre) elle aussi magnifique mais d’une autre manière. Madeleine incarne la James Bond girl nouvelle génération dans la lignée de Vesper Lynd jouée par la non moins somptueuse Eva Green dans Casino Royal. Fière, indépendante en apparence, son charme réside dans ce regard qui nous défie en même temps qu’il dégage une certaine fragilité. Sans attache, aventurière et pleine de ressource elle forme la paire parfaite avec Bond et donne une note de fraîcheur indéniable à la saga avec sa beauté si singulière et son jeu des plus naturels (en d’autres mots, elle ne sur-joue pas).
Elle est tout en contraste avec la bien nommée Léa Seydoux, (Madeleine Swann dans Spectre) elle aussi magnifique mais d’une autre manière. Madeleine incarne la James Bond girl nouvelle génération dans la lignée de Vesper Lynd jouée par la non moins somptueuse Eva Green dans Casino Royal. Fière, indépendante en apparence, son charme réside dans ce regard qui nous défie en même temps qu’il dégage une certaine fragilité. Sans attache, aventurière et pleine de ressource elle forme la paire parfaite avec Bond et donne une note de fraîcheur indéniable à la saga avec sa beauté si singulière et son jeu des plus naturels (en d’autres mots, elle ne sur-joue pas).







![[VU PAR] Paris, vue par une ex-Toulousaine](https://rdvc.fr/wp-content/uploads/sites/11/2015/11/20150130_154814-1.jpg)







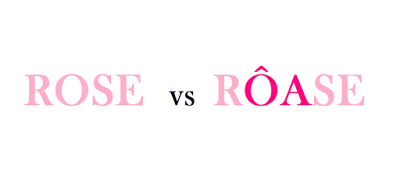






Commentaires récents