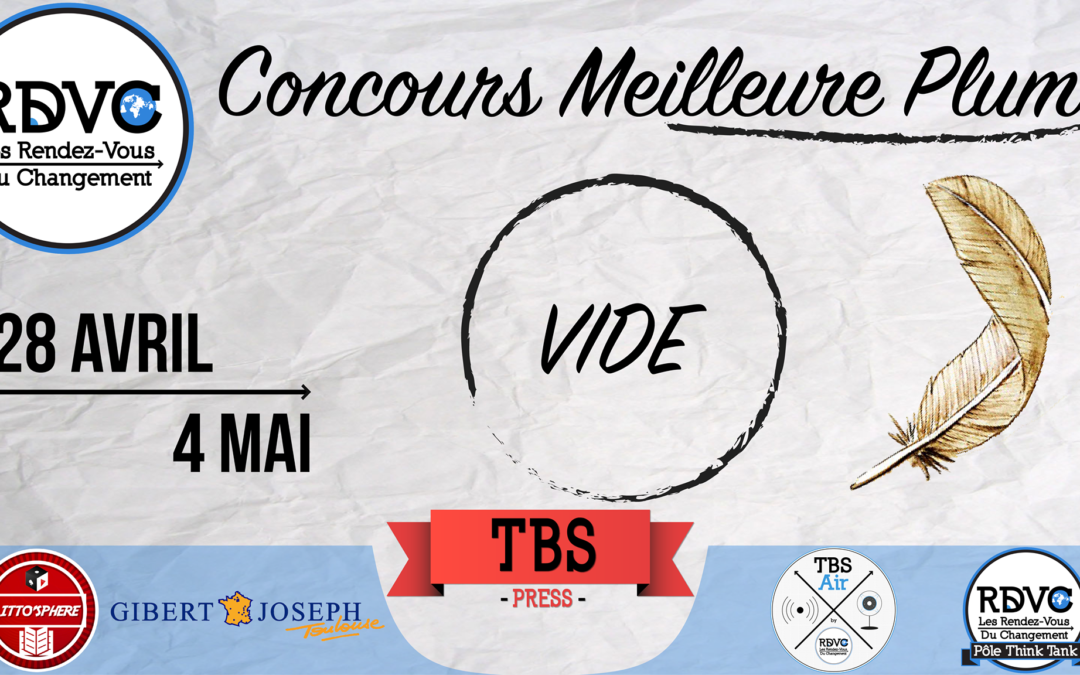
par tbspress | 3 mai 2017 | Concours de la meilleure plume
Le vide
Ça faisait surement des mois que j’y vivais. Combien je n’en sais trop rien, le temps fuit dès qu’on y met un pied. Mon cancer m’avait imposé un nouveau cadre, blanc et stérilisé. L’hôpital était devenu mon quotidien, mon repère, mon entourage. Et là-bas plus l’on est cassé, plus l’on nous aime. Moi ça tombait bien j’étais devenue chauve et déprimée. Alors au moins à l’hôpital on m’aimait bien.
Mes journées se ressemblaient excessivement. J’appelais l’infirmière à mon réveil, davantage pour sa compagnie que pour m’aider à avaler la pilule. Car à défaut d’être en bonne santé, j’avais le temps. Le temps de me réfugier dans la littérature et d’oublier mes maux. Il y avait aussi quelques personnes à qui j’aimais parler à l’hôpital. Des copains de fortune avec qui je pouvais refaire le monde faute de retrouver le mien. Je n’étais ni heureuse ni malheureuse. Je vivais, et c’était tout. Mais j’avais peur que tout s’arrête, peur de disparaître.
Ça faisait surement des mois que j’y vivais. Combien je n’en sais trop rien, le temps fuit dès qu’on y met un pied. Et un beau jour j’ai eu le malheur de guérir. Pendant des mois j’avais ressenti la peur du vide. Maintenant il était temps de vivre ma peur. C’était paradoxale, je l’avais toujours associé à la mort.
Ça faisait surement des mois que j’y vivais. Combien je n’en sais trop rien, le temps fuit dès qu’on y met un pied. Et derrière lui, le vide.
Vide chien
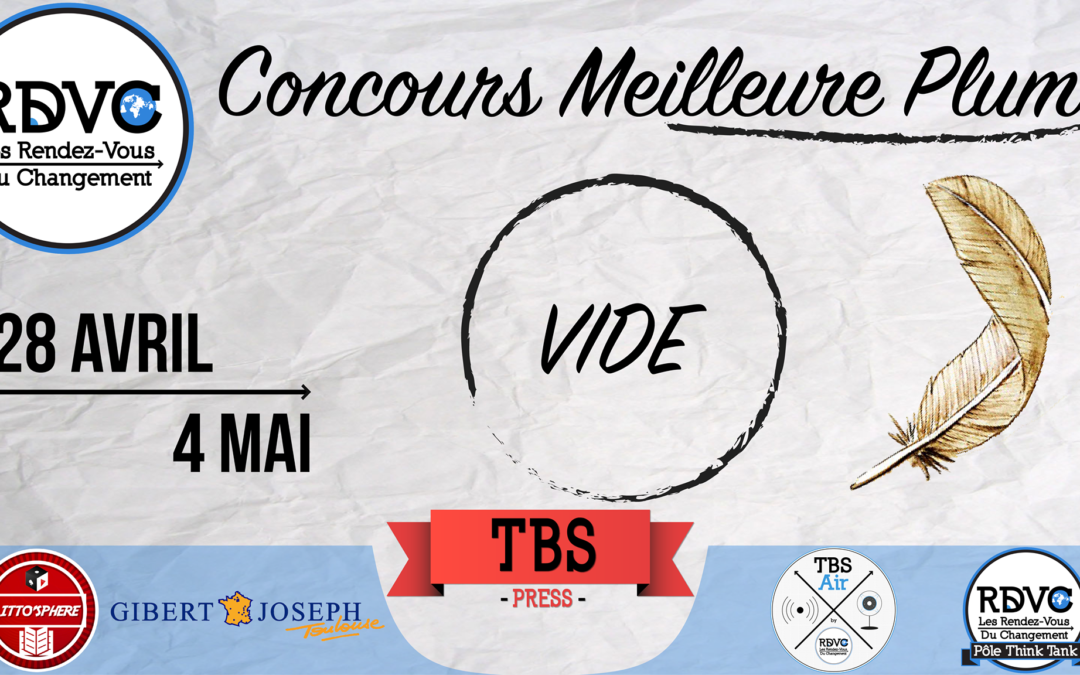
par tbspress | 30 avril 2017 | Concours de la meilleure plume, TBS Press
Blanc sali et sols oranges, grands couloirs et ascenseurs. Baies vitrées donnant sur l’extérieur, extérieur qui t’est interdit, pour ton bien, pour le leur. Sur la couverture d’or et d’argent, ton radeau de survie, tu reposes, si frêle dans cet immense lit. L’ombre de la longue perche inerte, ta compagne d’existence, filtre à travers les rideaux, cachant la minuscule ouverture qui te sert de fenêtre.
Un habitué se tient dans l’encadrement de la porte. Mince et droit, silencieux, presque digne, il nous observe souvent. Il lui arrive de te rendre visite en notre absence.
Ces derniers temps pourtant, il est là tous les jours.
Il t’a vu me confier que tu te sentais seule, inutile, que tu souhaiterais disparaître parfois.
Il était là ce matin où tu as déclaré que tu voulais rentrer.
Tu refuses de guérir, après tout à quoi bon.
Sur ce matelas si large et jonché d’édredons, tes grands cils résignés et ton menton têtu appuient un air boudeur.
Tu le contemples un peu, tu l’évoques à mi- mot.
Il nous effraie secrètement, mais avec les mois vous vous êtes rapprochés. Tu t’es prise d’amitié pour son regard sévère, sa présence un peu austère, l’atmosphère si spéciale qu’il fait planer sur ce petit endroit.
J’admets que même pour moi il devient familier.
L’horloge nous a surpris. Les lumières se font rares, la pénombre vacillante forme un curieux contraste avec ton vieux miroir, comme un manège funèbre sur la tenture des murs. Il me faut te quitter.
Quand je sors de la pièce, fendant automates blancs et pèlerins sans visages qui s’ignorent volontiers, il reste à mes côtés. Il se place derrière moi, tel un ami discret, promeneur inquiétant, et prend un air étrange entre cynisme et joie.
Soudain, il esquisse un sourire, et on comprend pourquoi. C’est mon jour aujourd’hui, je croise un autre cœur, un regard étranger, de ces regards voilés qui puent la solitude et surtout la souffrance.
Le passant l’aperçoit. Cet homme, mon suiveur, il le connait aussi. Ses pupilles se glacent. Ses paupières ombragées se tournant furtivement, il baisse lentement le front et passe son chemin.
Un froid poisseux me happe, me fige de l’intérieur, se répand amèrement à l’ensemble de mon corps. Car comme à chaque fois, l‘intrus m’escorte toujours, se rapproche, m’étouffe, envahit mon espace.
Dans cet univers immaculé, au milieu de toutes ces lassitudes qui s’étreignent si souvent qu’elles en forment un ballet, il trouve mieux sa place et se fait plus présent.
Il m‘inonde les yeux et me donne la nausée.
Je sais qu’en ce moment il veille à ton chevet, entre l’ampoule faiblarde et les roses fanées.
S’il te plait petite âme, ne te laisse pas tenter. Je sens la place qu’il prend, et, tous les jours plus fort, qu’il cherche à t’emporter.
Mais tu le connais bien, tu dois lui résister.
Cette ombre c’est le vide, et s’il en est qu’il apaise, il peut aussi tuer.
L.V.B.
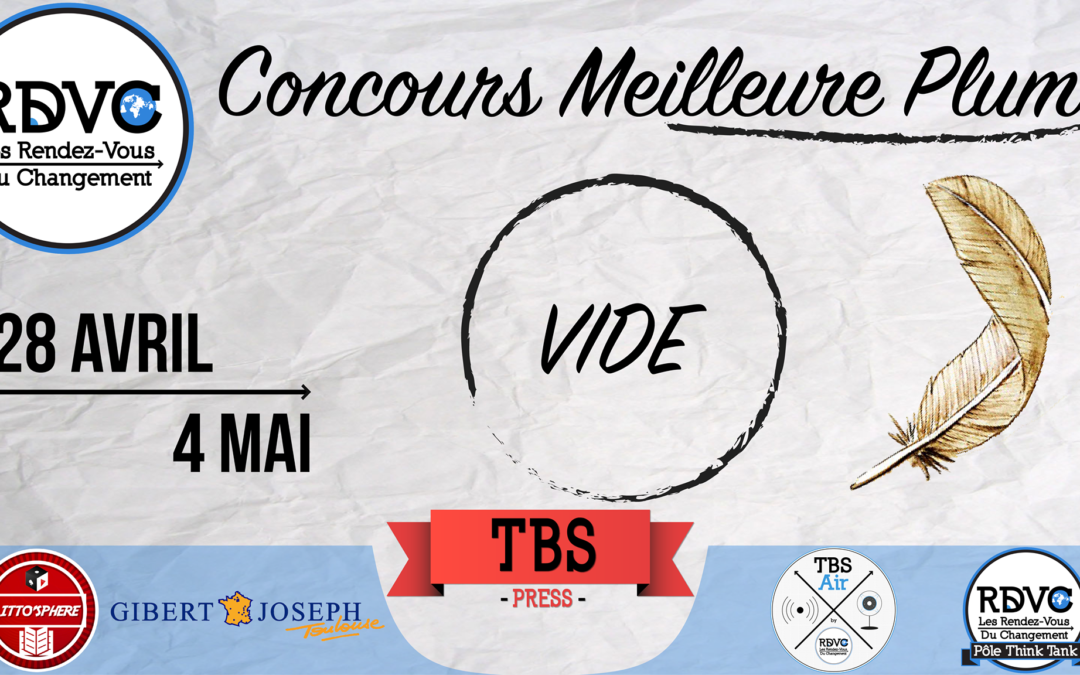
par tbspress | 30 avril 2017 | Concours de la meilleure plume, TBS Press
Je suis tentée de ne rien écrire pour le laisser s’exprimer. S’il pouvait s’affranchir
du mutisme dans lequel il est plongé, il userait pour sûr d’un discours s’étalant sur l’éternité bien que sans réelle consistance. L’audience serait prise d’un vertige à sa vue et le prendrait probablement en horreur. Mais, hypocrisie oblige, tout le monde chercherait à la combler ; après tout, on ne peut lui enlever qu’il est hypnotique. Les plus téméraires ou les plus malheureux s’en approcheraient pour mieux le questionner. Suspendus aux lèvres dont il est dépourvu, certains se laisseraient happer, soudés à « l’insondable » comme il aime à se faire appeler. D’autres, une majorité, soyez en sûrs, condamneraient la vacuité de ses propos et s’en détourneraient. Au besoin, ils iraient à son abord, à défaut d’être de son bord, pour se convaincre que leur vie est faite de sens plus qu’elle n’en est dépourvue.
Npaehsica
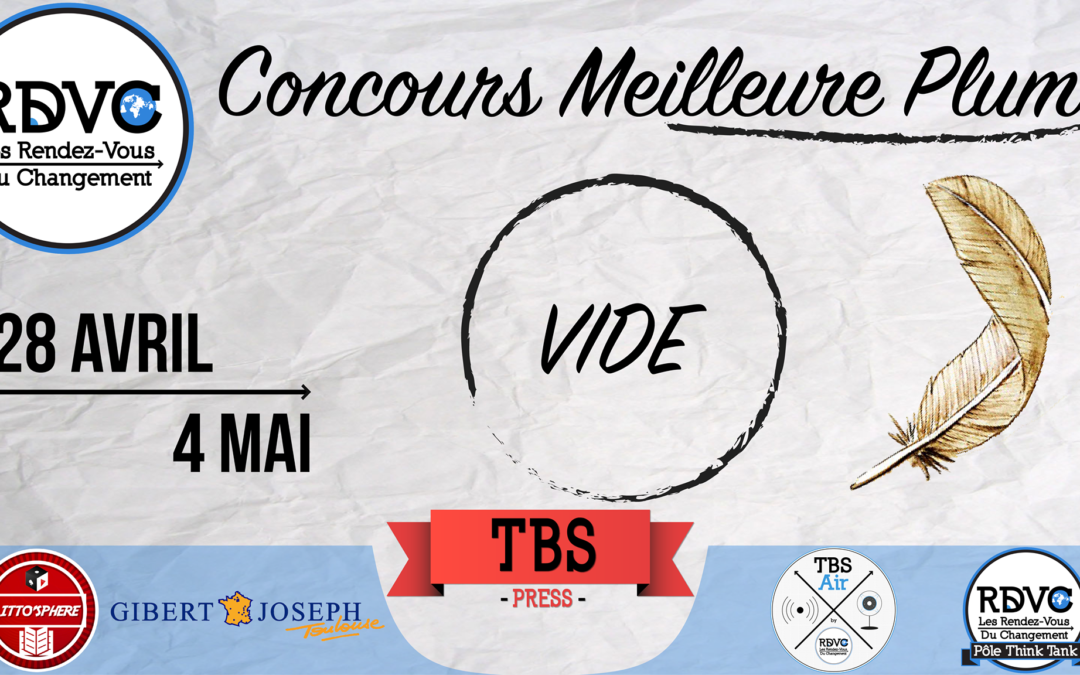
par tbspress | 30 avril 2017 | Concours de la meilleure plume, TBS Press
Le fauteuil est vide. Dehors le soleil semble s’être éteint et les nuages brouillent le ciel. Les murs sont tristes. Même les oiseaux ne chantent plus. Et je reste assise seule pendant des heures face à ce fauteuil vide. Plus personne ne s’y assoit désormais. Peut-être ont-ils peur qu’il soit hanté ? Je ne sais pas… Moi-même, je n’y touche pas.
Je fais des vas-et-viens dans les couloirs de la maison. Je tourne en rond. Je me lève chercher quelque chose puis j’oublie. Je me retrouve errant dans une pièce sans plus savoir ce que je suis venue y faire. Les murs pleurent. Ce sont les photos qu’ils portent qui leur racontent de trop tristes histoires. Je ne les regarde pas. Je fais des allers-venues, je ne suis plus bien nulle part. Et toujours, quand je reviens au salon, ce fauteuil vide qui me fait face.
La maison est vide. J’ai tout donné, vite, comme on fait avec un pansement qu’on arrache. Je comble l’espace en brassant de l’air, je déplace sans cesse le peu qui reste, j’arpente les pièces sans but. Je ne tiens plus en place. J’ai l’impression d’attendre que le courant d’air s’immisce en moi pour y étouffer le vide qui m’habite. Mais rien n’y fait, tout est imprégné. Ça sent toi, où que je sois. Les draps, les chaises, les murs, je te retrouve même dans les casseroles que je nettoie. Je les nettoie seulement, car cela fait des mois que je ne mange pas. On m’inonde de gâteaux et de restes de gratin, on me gave de plats préparés, de soupes trop sucrées, mais le frigidaire n’a jamais été si vide et la poubelle si pleine. Je me contente de rester assise pendant des heures et je contemple ce qu’il me reste de toi, ce fauteuil qui est toi, où je te revois, où je t’entends presque me parler de la guerre et des enfants, de nos belles années, d’autrefois.
Parfois, je te cherche. Une porte qui grince, un bruit de pas, et je t’attends. Sauf que tu ne viens pas. Je guette comme un loup aux aguets, comme si le destin s’était joué de moi et que tu allais tout à coup réapparaître. Mais ce n’est jamais le cas. On vient me rendre visite, on met de l’huile sur les gonds, on recolle le parquet qui se soulève et je ne t’entends plus. Des fois, l’idée me vient de le racler avec une spatule pour qu’il se soulève encore, de laisser une fenêtre ouverte, même en plein hiver, dans la seule attente que le vent fasse claquer la porte comme si c’était toi. Les enfants se moquent de moi, ils me disent de ne pas y prêter attention, d’oublier. De toute façon, ils ne parlent jamais de toi. Mais moi, je ne t’oublie pas. Je pense à toi à chaque inspiration, à chaque geste. Tu es partout, fondu en moi.
Je tourne en rond parce qu’il n’y a nulle part où je ne te sens pas. Je détourne le regard des photos accrochées aux murs mais je ne les enlève pas car j’ai besoin que tu sois encore là. Pour moi, pour les enfants, pour les plus jeunes. Pour t’accorder encore un peu de vie, un délai par procuration. C’est tout ce que je peux désormais t’offrir, un regard sur ce que nous devenons ici, perdus depuis que tu n’es plus là. Une vaine tentative pour que tu entendes encore leur voix. Mais je ne peux plus les affronter, elles ne me rappellent que trop combien tu étais vrai. Et puis il y a tes yeux, tes grands yeux sombres qui paraissent me fixer, et cette terrible lueur qui y brille comme si tu allais t’animer. C’est trop pour moi. Tellement plus que je ne peux en supporter.
Tu es un manque constant. Une absence permanente, quasiment devenue présence. Tout me rappelle toi et pourtant tu n’es plus là. Le temps est long, les lieux sont vides, l’ennui est grand. Je tourne en rond et, quand je n’en ai plus la force, je m’installe devant ce qu’il me reste de toi, devant ce fauteuil qui sent toi, ce fauteuil sur lequel personne ne s’assoie, sacralisé comme ces tabous qu’on n’ouvre pas. Je me perds dans ces fibres de tissus encore imprégnées de ton odeur et de ta voix, mais rien n’y fait, car tu n’es plus là et j’ai beau attendre, ça ne te ramène pas.
Otis
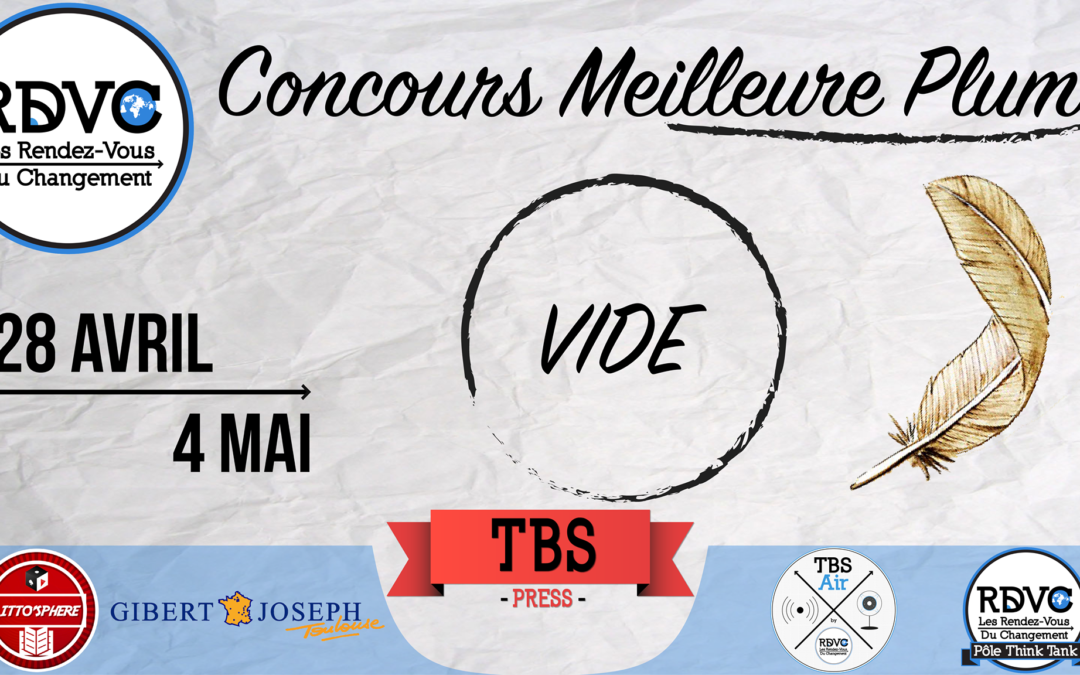
par tbspress | 30 avril 2017 | Concours de la meilleure plume, TBS Press
LE VIDE
Subjuguée par l’immobile, le regard vers le ciel, je scrute les étoiles une à une dans l’obscurité profonde de l’immensité. Toutes ces constellations lumineuses et rigoureuses offrent à mon esprit un champ infini d’interrogations. Que peut-il y avoir de l’autre côté de ce mur noir, à la fois si abrupte et impassible, et à la fois si grandiose et espiègle ? Parfois, je me sens si fatiguée, avachie comme dans un vieux canapé usé, affaissé sous le poids du monde, ce monde si lourd, si sourd, qui tourne, tourne, sans jamais s’arrêter, dans cet espace infini, à la fois si vide et beaucoup trop plein, de haine, de peur, de tristesse et d’infamie. J’interroge le ciel en criant de toutes mes forces, espérant recevoir une réponse à mes questions. Mais tout ce qui revient à moi tel un boomerang solitaire, est mon écho qui résonne comme une bille dans un bocal de verre. Ce son me rappelle combien je ne suis rien, juste un grain de sable dans un désert sans fin, une goutte d’eau dans une baignoire sans fond. Je me rends compte que ce vide n’existe pas uniquement autour de moi. Il est aussi en moi. Cette sensation latente qui rend l’esprit impuissant et le cœur dépouillé, asséché, épuisé. Et quand mon corps n’a plus le souffle pour avancer, n’a plus le goût pour grandir et vieillir, alors le vide s’installe et perdure. Il absorbe toute trace d’énergie restante qui pourrait encore faire marcher mes jambes, et pose ses valises chargées de plomb sur mon estomac. Alors le temps s’arrête. Ou peut-être le temps n’a-t-il jamais existé. Après tout, si l’espace qui m’entoure n’a ni début ni fin, plus rien n’a d’importance. Nous courons sans cesse après le temps, le regard suspendu aux aiguilles de la montre, qui tourne, tourne, sans jamais s’arrêter. Elle virevolte au rythme du monde dans lequel elle est née, un tempo effréné qui ne connaît pas de répit et se mord la queue à l’infini. Et mes yeux essaient difficilement de suivre la course folle des chiffres qui défilent, mais ils ne font qu’un tour et s’épuisent. Ils n’ont plus la force de regarder au-delà, ou peut-être n’ont-ils tout simplement pas envie de voir ce qui s’y cache. Cet espace sans barrière qui m’entoure me fait peur. Il est à la fois tout et rien. A la fois plein de merveilles et de monstruosités, et si vide de sens.
Aujourd’hui, devant ce rempart étoilé, je choisis de prendre une direction, mais où me mènera-t-elle ? L’incertitude du lendemain et de la destination m’angoisse et me rend vivante à la fois. C’est elle qui éveille en moi cette ardeur, cette envie de vaincre et de rompre le silence du vide, l’écho de mes pensées qui me revient à la gueule comme une gifle sourde et cassante. Je ne veux plus me poser de questions, juste marcher vers mon destin, sur cette Terre que je n’ai pas choisie, mais qui m’a accueillie. J’ai décidé de ne pas me retourner, non plus de regarder loin devant. J’ai simplement décidé de baisser la tête et de m’assurer que mes pieds touchent encore le sol. Et mon esprit ? Il est déjà loin.
Première plume
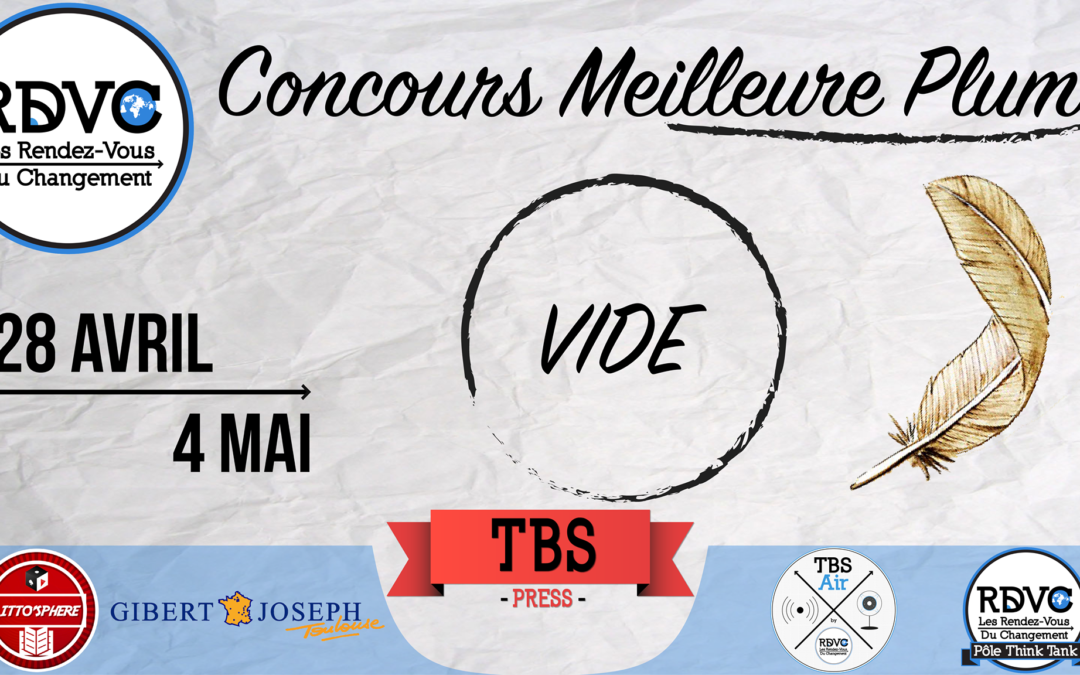

Commentaires récents