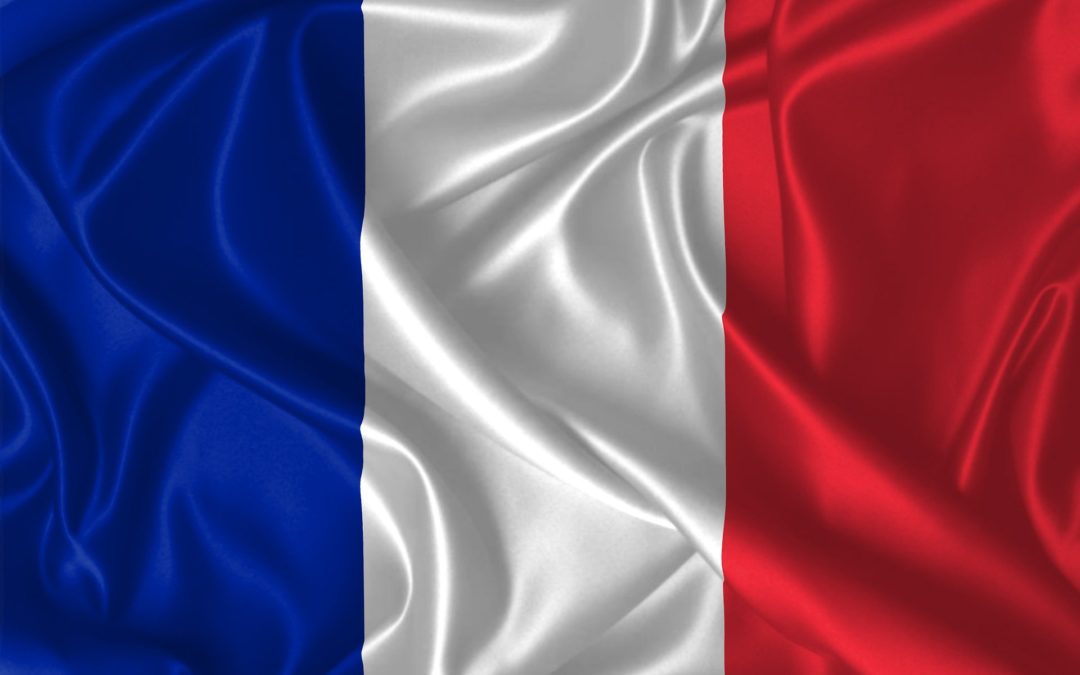
par jbentolopes | 8 avril 2022 | RDVC en parle, TBS Press
*Pour en savoir plus sur chaque candidat, vous pouvez lire plus en détails leurs programmes sur leurs sites officiels de campagne.




Les sites de campagnes :
Par Jessica LOPES BENTO

par jbentolopes | 27 mars 2022 | TBS Press
L’ADEME dévoile en 2017 que le volume annuel de consommation par personne est aujourd’hui trois fois plus élevé qu’en 1960.
Écoresponsabilité : contexte, notion et avantages
Un peu d’histoire
Faisons un bond dans les années 1980 en Italie. En réaction à l’implantation d’un McDonald’s en plein cœur de Rome en 1986, un groupe de gourmets, mené par Carlo Petrini, s’oppose à la diffusion de la « junk food », de la standardisation et de l’hyper-industrialisation alimentaire. C’est l’avènement du mouvement Slow Food. Ce dernier propose de renouer avec l’alimentation locale et de comprendre les conditions de production des divers aliments pour redonner sens au plaisir gustatif tout en respectant l’environnement.
Qu’est-ce que l’écoresponsabilité ?
En 1994, le Parlement européen s’est saisi de la question de la responsabilité environnementale, avec une approche visant la réparation du dommage environnemental. Ainsi est apparu en 2003 une proposition du principe du pollueur – payeur, même si celui-ci était déjà présent dans l’OCDE à partir de 1972. Par la suite, ce principe a été intégré en droit international de l’environnement. Il est notamment défini comme le fait d’internaliser les coûts de protection de l’environnement, compte tenu de l’idée que c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, en ayant en vue l’intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement.
De manière générale, l’écoresponsabilité invite l’ensemble des entreprises, et des citoyens, à réfléchir à l’impact de leurs activités sur l’environnement (construction des bureaux, gestion des déchets, gestion de l’énergie, utilisation d’eau, déplacements, numériques) et à y intégrer les enjeux du développement durable.
La démarche écoresponsable commence par identifier le périmètre d’action et évaluer son empreinte carbone afin de choisir ce qui mérite d’être traité en priorité.
Dans un deuxième temps, il faut imaginer et proposer des solutions pour réduire les impacts négatifs sur l’environnement.
Enfin, il est important de former ses collaborateurs et d’instaurer un temps de discussion afin d’échanger sur les bonnes pratiques à adopter pour diminuer son bilan carbone.
En tant qu’entreprise, intégrer les principes du développement durable dans votre activité est une opportunité. Cela permet de réduire certains coûts, d’attirer de nouveaux clients dans la mesure où les consommateurs ont des attentes de plus en plus fortes envers les entreprises, et, de nouer de bonnes relations au niveau local (avec les fournisseurs et les consommateurs). De plus, travailler dans un restaurant qui fait sens pour l’environnement est une source de motivation pour les collaborateurs !
Comment s’informer en tant que consommateur ?
Le label
Pour permettre aux entreprises d’officialiser leur engagement en matière d’écoresponsabilité, il existe différents labels. En voici quelques-uns :
Tout d’abord, la marque NF Environnement permet de distinguer des produits ou services plus respectueux de l’environnement que les équivalents classiques. Ses critères garantissent l’aptitude à l’usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie. Elle concerne à la fois le produit et son emballage.
Le label MSC (Marine Stewardship Council) récompense les pêcheries dont la gestion et les pratiques sont reconnues comme étant écologiquement responsables. Ce label certifie que le produit issu de la mer provient d’une pêcherie durable, bien gérée et ne contribue pas au grave problème de surpêche.
Le label GOTS (Global Organic Textil Standard) se réfère aux produits en coton, laine, soie et chanvre. Il permet de certifier l’origine biologique des fibres et le respect de l’environnement et de l’être humain, dans les processus de fabrication. Il assure par exemple qu’au moins 70% des fibres naturelles utilisées pour la fabrication des vêtements sont d’origines naturelles.
Le label est-il toujours fiable ?
Il faut toutefois se méfier de certains labels puisqu’ils ne sont pas toujours certifiés par un organisme accrédité et indépendant. Un label peut par exemple provenir d’un organisme privé. Les exigences auxquelles les produits ou les entreprises labellisés doivent répondre sont donc moins encadrées que celles qui sont demandées pour obtenir une certification.
Par exemple, la certification B Corp permet à une entreprise de certifier qu’elle respecte des normes élevées de performance vérifiée, de responsabilité et de transparence sur des facteurs allant des avantages sociaux aux employés, aux pratiques de la chaîne d’approvisionnement et aux matériaux d’entrée. Danone et Nature & Découvertes ont obtenu la certification B Corp.
Et pour mon entreprise ?
Devenir une entreprise à mission
Une majorité des français considèrent qu’une entreprise doit être utile pour la société dans son ensemble. La loi a donc introduit en 2019 la qualité de société à mission permettant à une entreprise de déclarer sa « raison d’être » envers plusieurs objectifs sociaux et environnementaux.
Pour devenir une entreprise à mission, une société doit définir, en plus de ses engagements économiques, des engagements sociaux et environnementaux et baser sa stratégie dessus. Contrairement au statut d’entreprise écoresponsable, le statut d’entreprise à mission est clairement défini puisque les missions doivent être mentionnées dans les statuts et aussi dans la base de données des entreprises de l’INSEE.
Les étapes pour y parvenir
- Élaboration et définition de la raison d’être de l’entreprise ;
- Déterminer des objectifs environnementaux et sociaux ;
- Appliquer un mode de gouvernance et de gestion qui répond à ces objectifs ;
- Modifier les statuts juridiques de l’entreprise (vote des associés, publication d’une annonce légale, enregistrement de ces modifications au Registre du Commerce et des Sociétés, publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales) ;
- Nominer un comité de mission comprenant au moins un salarié de l’entreprise ;
- Contrôler au moins tous les deux ans par un organisme indépendant agréé.
Par Alise DURAND

par jbentolopes | 19 mars 2022 | TBS Press
Dimanche 14 mars 2021, une bombe explose au sein du microcosme des très puissants patrons du CAC 40. La tête du chantre de la RSE vient de tomber.
Le conseil d’administration du groupe Danone a voté le départ immédiat de son charismatique et médiatique Président Directeur Général, Emmanuel Faber.
Depuis des mois celui qu’on surnomme « Le Moine-Soldat » est dans le viseur des actionnaires qui le jugent responsable des mauvaises performances économiques du géant agroalimentaire face à ses concurrents, comme Nestlé ou Unilever.
A l’initiative de ce renvoi, on trouve deux fonds activistes : Bluebell Compagnie et Artisan Partners. Entrés dans le capital de Danone courant 2020, ils sont minoritaires mais pourtant font la pluie et le beau temps au CAC40. Les fonds activistes, grâce à leur autorité d’acteur financier expérimenté, s’imposent dans la prise de décision des directions générales et proposent une stratégie déjà appliquée et prouvée pour améliorer les performances financières de l’entreprise, ce qui convainc généralement les autres actionnaires, qui se rallient à leur vision.
C’est lorsqu’il y a un désaccord de fond entre la direction générale et les fonds activistes que ces derniers vont tenter de la faire tomber.
C’est ce qu’il s’est passé dans le cas de Danone en 2021. Les deux fonds depuis leur entrée dans le capital n’ont pas cessé de critiquer les performances financières du Groupe, jusqu’à réclamer la tête de son PDG, Emmanuel Faber.
Car aujourd’hui on mesure la performance d’une entreprise à l’aune de celle de ses concurrentes. Méthode très discutable car la performance d’aujourd’hui ne garantit pas celle de demain. Par exemple un investissement de long terme fait baisser le chiffre d’affaires du moment alors qu’il assure l’avenir de l’entreprise. En d’autres termes une « sous-performance » peut être un signe de viabilité à long terme.
L’affaire Danone est l’exemple parfait du problème de la Corporate Governance dans l’économie.
Aujourd’hui la notion d’entreprise se voit réduite à une organisation marchande destinée à faire du profit : le caractère lucratif de l’entreprise est même le seul critère discriminant que retient l’INSEE pour comptabiliser le nombre d’entreprises en France.
Jusque dans les années 70 l’intérêt de l’entreprise était censé entraîner l’intérêt de la société. Comme l’illustrait le slogan « What Is good For General Motors Is good For America ».
Mais depuis les années 80 la logique s’est inversée, à la place des intérêts de l’entreprise les dirigeants se sont mis à privilégier les intérêts des actionnaires, contraints par une nouvelle doctrine appelée la Corporate Governance (corporate désigne en anglais non pas l’entreprise mais la société anonyme). Cette doctrine fait systématiquement prévaloir la société anonyme, donc l’actionnariat, sur l’entreprise.
La doctrine de la Corporate governance s’est diffusée dans le monde à travers la réglementation : rapport Cadbury en 1922 en Angleterre, rapport de l’American Law Institute en 1994 aux Etats Unis, rapports Vienot en 1995 et 1999 en France, rapport de l’OCDE en 1999 dans l’Union Européenne ou de façon plus insidieuse encore dans les codes de bonne gouvernance imposés aux dirigeants de grandes entreprises.
Les principes de la shareholder value se sont peu à peu légitimés au cours du 20e siècle, aidés par une conjoncture particulière et la montée en puissance du néolibéralisme.
Friedman affirmait dans Capitalisme et Liberté le dirigeant d’entreprise n’a « qu’une seule responsabilité sociale, vis-à-vis de son actionnaire : utiliser ses ressources et s’engager dans des activités destinées à accroître ses profits ».
Idée entérinée par les économistes Armen Alchian et Harold Demsetz en 1972 dans leur théorie de la firme, qui affirment que le meilleur moyen d’avoir une direction efficiente est de la faire nommer par les actionnaires, car leurs intérêts financiers y sont directement liés.
Conséquence en chiffre de cette nouvelle doctrine, la valeur actionnariale a primé sur les investissements productifs. En France, les dividendes versés aux actionnaires ont pratiquement doublé en 10 ans (2009-2019), alors que les inégalités de revenus des ménages ne cessaient d’augmenter.
Comment restaurer l’entreprise face à la société anonyme ?
-
Par l’autogestion et la participation
A l’instar des lois allemandes sur la co-détermination, évoquant dès 1920 le devoir de production commun au-delà de l’opposition des intérêts entre salariés et actionnaires, un conseil de surveillance est mis en place dans lequel les salariés occupent une partie des sièges, voire la moitié dans les grandes entreprises, pour contrôler la gestion. De nombreuses études, comme celle du rapport Biedenkopf en Allemagne en 1951 montre qu’en pratique la co-détermination ne nuit pas aux performances des entreprises.
Car elle part du principe que l’entreprise est une organisation économique profondément encastrée dans les rouages de la société. A la fois dépendante d’elle et rétro agissant en permanence sur elle. Cette fois-ci au lieu de se questionner sur la place et le poids décisionnaire des salariés, l’accent est mis sur la mission de l’entreprise et ses responsabilités à l’égard de son environnement au sens large.
La démarche RSE s’est développée avec des instruments extra-judiciaires : critères d’évaluation, agences de notation, normes ISO. Cependant on ne peut que constater les limites des démarches de RSE. Tant que les actionnaires ont la possibilité de révoquer les dirigeants à tout moment ou que l’entreprise peut être rachetée comme dans le cas de Ben & Jerry’s, le souci que peuvent avoir les dirigeants de ménager un certain équilibre restera dérisoire.
-
Par la théorie des stakeholder (parties prenantes)
Remplacer le mandat par l’habilitation :
Les dirigeants sont habilités par les salariés à exercer un pouvoir de direction afin de piloter les opérations dans l’intérêt de l’entreprise ; et non mandatés par les actionnaires d’accroître leurs dividendes.
Avec la théorie des stakeholders, ce ne sont pas seulement aux contributeurs directs, salariés, actionnaires, banquiers, d’avoir un pouvoir décisionnaire mais aussi aux parties affectées par l’activité de l’entreprise, consommateurs, riverains, voire O.N.G. ou syndicats.
Cette théorie plaide généralement pour qu’une grande latitude soit laissée aux dirigeants tout en considérant que les parties prenantes pourront faire valoir leurs attentes auprès des managers.
Cependant pour toutes les sociétés côtées, il n’est pas possible de s’affranchir des préceptes de la « Corporate Governance ».
Mais le législateur peut mettre de nouveaux statuts à côté de la société anonyme.
Comment concrètement empêcher que l’objectif du profit à court terme ne continue à assujettir les dirigeants et leur stratégie ? Comment restaurer l’autorité du dirigeant, essentiellement sa capacité à construire des objectifs d’entreprise qui ne concordent pas toujours avec l’intérêt à court terme des actionnaires ?
Aujourd’hui certaines entreprises parviennent à combiner des objectifs sociétaux avec des exigences de rentabilité financière, mais en faisant cela les dirigeants actuels courent des risques et peuvent être accusés de manquer à leurs devoirs (fiduciary duties) vis-à-vis des actionnaires.
Ils peuvent invoquer la « Business Judgment Rule » pour faire accepter leur décision, avec comme argument des effets potentiels à long terme sur les intérêts des actionnaires cependant cette règle les protège peu surtout en situation d’OPA.
Alors comment donner vraiment plus de pouvoirs aux dirigeants ? Les économistes Blanche Segrestin et Armand Hatchuel proposent d’introduire une nouvelle option juridique la « société à objet social étendu » ou SOSE. Cette norme introduit dans l’objet social de l’entreprise le développement à long terme de capacité d’innovation du collectif, le développement des compétences des salariés et de leur employabilité, le respect des politiques de solidarité ou des règles pour gérer des éventuelles restructurations et la minimisation des effets des activités sur l’environnement.
Encore plus important les dirigeants d’une société avec un statut de SOSE ne pourraient plus être révocables ad nutum par les actionnaires mais sur « juste motif », c’est-à-dire s’ils contreviennent aux objets pour lesquelles ils sont missionnés par les statuts.
L’État de Californie a déjà voté une loi similaire, le 9 octobre 2011, le gouverneur Jerry Brown a ratifié la création d’un nouveau type de société la « flexible purpose corporation ». Cette nouvelle société permet de « faire le bien tout en étant conforme » « making good while doing well » en autorisant les dirigeants à poursuivre des objectifs autres que la valeur actionnariale.
En définitive le libéralisme économique et le capitalisme se définissent par la liberté d’entreprendre, et la libre concurrence, mais rien dans leurs principes ne détermine les formes de l’action collective pour produire de la valeur et des profits. Les règles de gestion d’entreprise ne sont ni naturelles ni invariantes, ce sont plutôt des outils d’organisation, qui peuvent évoluer avec l’état des connaissances et des normes sociales en vigueur.
Aujourd’hui le droit devrait évoluer pour dissiper la confusion entre société anonyme et entreprise, et mettre un terme à l’une des plus endémique des crises contemporaines, celle de l’entreprise dont on a négligé la capacité à réguler le capitalisme.
L’entreprise doit surtout répondre aux enjeux économiques et sociaux contemporains de la compétitivité et de l’innovation. S’il y a un siècle elle était déjà née de l’impératif d’inventivité technique, les investissements en innovation et en création ne peuvent plus passer actuellement après les versements des dividendes aux actionnaires. Dans un monde où le niveau d’éducation, de connexion, et de communication ne cesse de croître et où les besoins en développement humain s’étendent et le désir d’égalité s’intensifie, l’innovation est plus que jamais le moteur de la création de richesse.
Il est urgent de réformer l’Entreprise pour qu’elle redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une dynamique de création collective et un vecteur de progrès économiques et sociaux.
Par Emma LAVABRE

par jbentolopes | 13 mars 2022 | TBS Press
En septembre 2017, à l’occasion d’une conférence avec des étudiants portant sur les nouvelles technologies, le président russe Vladimir Poutine prononçait cette phrase : “Le pays qui deviendra leader en intelligence artificielle sera le maître du monde”. De fait, l’intelligence artificielle est vouée à devenir un outil de domination géopolitique majeur dans les années à venir pour les pays qui souhaitent affirmer leur puissance. C’est d’ailleurs ce qui amène les Etats à s’affronter sur un nouveau terrain géopolitique : le cyberespace, un espace sans frontières, libre et anonyme, où une multitude d’informations s’échangent et qui peut également devenir le théâtre de conflits entre différents acteurs. Les militaires qualifient même le cyberespace de “cinquième dimension”, autrement dit de cinquième champ de bataille, après la terre, la mer, l’air et l’espace. Le risque de cyberguerre est donc réel et les menaces au sein du cyberespace se multiplient. De fait, il est nécessaire que les Etats agissent pour faire face à ces menaces.
L’émergence d’un nouveau terrain géopolitique et de nouveaux acteurs
Le cyberespace est un lieu d’information créé par l’interconnexion à l’échelle mondiale des réseaux de télécommunications, permis grâce à Internet. Le cyberespace est donc un produit dérivé d’Internet, qui est lui-même un produit dérivé d’une invention militaire. En effet, Internet est né de la création “d’Arpanet”, un système de communication mis en service par le ministère américain de la Défense en 1969, dont le but était de permettre à l’armée américaine de maintenir un moyen de communication capable de résister à une éventuelle attaque nucléaire. Internet est ensuite devenue dans les années 1990-2000, le réseau de télécommunications mondial que tout le monde connaît aujourd’hui avec près de 4,95 milliards d’internautes en janvier 2022, soit pratiquement 60% de la population mondiale.
Si le cyberespace est l’objet d’affrontements entre puissances depuis des décennies, de nouveaux acteurs émergent et contrôlent également cet espace avec des intérêts divergents : on y retrouve les multinationales ainsi que les acteurs issus des “zones grises” du web, qui sont la face cachée d’internet, représentée par le “dark web”.
- Les acteurs des “zones grises” sont des pirates informatiques (des “hackers”), des groupes de hackers comme Anonymous ou encore des groupes criminels et terroristes et dont leur but est de défendre leurs intérêts économiques et politiques. Par exemple, l’organisation terroriste Daech a eu recours au dark web pour recruter notamment des djihadistes européens afin de rejoindre la Syrie et l’Irak entre 2014 et 2018.
- Les Etats peuvent développer leur cyberpuissance par le biais de leurs multinationales, acteurs-clés du cyberespace et véritable outil de leur softpower. Les sièges sociaux des principales multinationales se trouvent dans la Silicon Valley en Californie. Les États-Unis dominent assez largement dans ce domaine avec ses GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), ce qui s’explique par les importantes avancées dans le domaine de la R&D. Cependant, dans le contexte actuel de la guerre technologique sino-américaine, l’hégémonie numérique américaine est de plus en plus contestée par l’émergence des géants du numérique chinois, les BATX (Baidu, le “google chinois” – Alibaba, “l’amazon chinois” – Tencent, service internet et mobile chinois – Xiaomi, produits électroniques). Par exemple, la capitalisation boursière de Tencent a dépassé celle de Facebook en juillet 2020 en s’élevant à 664,50 milliards de dollars contre 656,15 milliards de dollars pour Facebook. De plus, l’entreprise de téléphonie chinoise, Huawei, a été accusée au début de l’année 2019 d’espionnage industriel par les Américains et la diffusion de la 5G par le bais des services de cette dernière fait régulièrement polémique. Par conséquent, le duel technologique sino-américain montre à quel point le cyberespace est devenu un enjeu géopolitique.
Néanmoins, malgré l’émergence de nombreux acteurs, cet espace reste restreint du fait de contraintes matérielles majeures et assurent, de fait, une domination des acteurs présents dans le cyberespace. En effet, ce sont notamment les câbles sous-marins qui assurent 99% des communications mondiales contre seulement 1% pour les satellites. De plus, 97% des communications entre l’Europe et l’Asie transitent par le réseau de câbles sous-marins provenant des États-Unis, acteur de premier rang donc dans le cyberespace. Les géants du numérique investissent également dans l’installation de ces câbles et sont donc des acteurs à part entière. Par exemple, Facebook ou encore Telstra (une entreprise australienne de télécommunication) ont investi dans l’installation du câble sous-marin Hong Kong-Americas reliant Hong Kong à la côte ouest américaine.
Les menaces au sein du cyberespace : un miroir des tensions internationales ?
Le cyberespace peut être source de conflit et de menaces. En effet, un État peut être soit l’auteur, soit la victime d’espionnage ou de cyberattaque.
Le cyberespionnage est l’une des menaces les plus courantes et dont le but est de collecter des informations sur un État en s’introduisant dans le système informatique du pays en question.
La révélation de l’affaire Pegasus en juillet 2021 par Forbidden Stories en est un très bon exemple. Il s’agit d’un logiciel espion créé par l’entreprise israélienne NSO Group, spécialisée dans la cybersurveillance et vendu par cette dernière à une cinquantaine de gouvernements, dont les Émirats arabes unis et le Maroc. Des chefs d’État, des journalistes ou encore des opposants politiques ont été espionnés par ce logiciel. De fait, cette affaire a provoqué une crise géopolitique impliquant des acteurs étatiques et privés. Le cyberespionnage constitue une véritable arme géopolitique : le logiciel Pegasus a notamment permis à Israël de continuer son rapprochement politique avec le Maroc et les Emirats arabes unis, déjà initié lors de la signature des accords d’Abraham du 15 septembre 2020.
Selon Shoshana Zuboff, professeure à Harvard Business School, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, une ère de l’écoute et du « capitalisme de surveillance ». En 2013, le lanceur d’alerte Edward Snowden avait déjà mis en lumière l’idée selon laquelle les services secrets américains et britanniques espionnaient les liaisons téléphoniques et informatiques de millions de personnes par le biais de câbles sous-marins, transitant entre l’Europe et les Etats-Unis. Il a également révélé la même année le programme de surveillance massif de la NSA (l’Agence nationale de la sécurité), nommé les “Five Eyes” et crée en 1995. Ce programme avait pour but de surveiller les données informatiques échangées à travers le monde. Des pays comme le Brésil ont rapidement réagi face à ces révélations en décidant de construire un câble sous-marin, l’année suivante, reliant directement le Brésil à l’Europe afin de ne plus passer par les Etats-Unis. De fait, ce qui se passe dans le cyberespace peut avoir un impact significatif sur les relations internationales.
Autre menace de grande ampleur : la subversion, qui est étroitement liée à l’espionnage, peut être un moyen d’influencer l’opinion publique nationale ou internationale en déstabilisant l’adversaire et constitue donc également une menace majeure au sein du cyberespace. Par exemple, la société britannique Cambridge Analytica, spécialisée dans l’analyse de données et d’influence de l’opinion sur Internet, a été accusée d’avoir influencé le vote des électeurs américains en faveur de Donald Trump, notamment par le biais de la désinformation sur Facebook, lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.
Les menaces dans le cyberespace sont récurrentes. Par conséquent, les conflits au sein du cyberespace sont tout sauf anodins. Une cyberattaque bien menée peut constituer une menace existentielle pour la sécurité d’un pays et peut même porter un coup fatal à l’économie d’un pays et in fine accroître les tensions internationales.
-
Les conséquences d’une cyberattaque : l’exemple estonien
En 2007, une vague de cyberattaques, attribuée à la Russie, a paralysé l’ensemble du réseau informatique de l’Estonie, membre de l’Union européenne. La plupart des hackers étaient russes et protestaient contre le déplacement d’un monument érigé en l’honneur des soldats soviétiques morts lors de la Seconde Guerre mondiale et qui ont contribué à la libération du pays en 1944. De fait, ces cyberattaques ont touché l’intégralité du système informatique estonien : sites Internet du gouvernement, banques, médias, ou encore opérateurs téléphoniques. Par conséquent, ces cyberattaques ont perturbé la vie institutionnelle et quotidienne de ce pays où notamment 95 % des opérations bancaires s’effectuent par voie électronique.
Le cas estonien montre la nécessité pour les Etats de construire une véritable coopération internationale dans le domaine de la cyberdéfense afin de sécuriser les systèmes informatiques et de riposter en cas d’attaques.
Entre souveraineté nationale et coopération internationale
Le cyberespace constitue un véritable terrain géopolitique en perpétuel mouvement. Face aux menaces grandissantes, les Etats doivent s’organiser afin d’établir ensemble une cyberdéfense capable d’y faire face.
-
L’émergence d’une gouvernance régionale et mondiale dans le domaine de la cyberdéfense…
A l’échelle européenne, des progrès notables en matière de coopération ont été réalisées. En 2004 est créé l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA) dont le but est notamment de promouvoir la coopération entre les Etats membres dans le domaine de la cybersécurité. Néanmoins, ces dernières années l’Union européenne et l’OTAN ont renforcé leur coopération et de nombreux Etats européens se placent sous le bouclier de l’OTAN, acteur majeur de la cybersécurité dans l’Union européenne.
A l’échelle mondiale, un Forum mondial sur la gouvernance de l’Internet (FGI) est créé en 2005, sous l’égide des Nations unies, et a lieu tous les ans afin de débattre sur l’ensemble des politiques publiques relatives à l’Internet et de garantir notamment la transparence, la stabilité ou encore la sécurité de l’Internet. De plus, en 2015, l’ONU a présenté un rapport détaillé sur les comportements a adopté dans le cyberespace et qui incite les Etats à coopérer et à venir en aide aux Etats victimes d’attaques.
A l’heure actuelle, il est plus juste de parler de cybersécurité plutôt que de cyberdéfense dans la mesure où les Etats emploient des moyens permettant de sécuriser les systèmes informatiques et les données sans pour autant mener des actions de défense à proprement parler pour se protéger d’une menace.
-
…entravée par un vide juridique et des Etats refusant tout abandon de leur souveraineté nationale
Les cyberattaques récurrentes ainsi que les liens étroits pouvant exister entre certains gouvernements et des cybercriminels rendent difficile la mise en place d’une coopération internationale dans le domaine de la cyberdéfense. De plus, il existe un vide juridique au sein du cyberespace : il est particulièrement difficile d’accuser avec certitude un acteur d’être responsable d’une cyberattaque. Le droit international ne stipule pas non plus que le droit des conflits s’applique aux conflits au sein du cyberespace car ce sont des conflits virtuels et donc non-physiques. De fait, ce vide juridique rend illégitime le principe même de défense au sein de cet espace.
En outre, avec des Etats souhaitant maintenir une certaine souveraineté numérique sur cet espace stratégique, la coopération risque d’être limitée. En effet, le cyberespace constitue un véritable enjeu de souveraineté et d’affirmation de puissance pour les États. Par exemple, les pays de l’Organisation de coopération de Shanghai, dont fait partie la Chine et la Russie, s’opposent fermement à la mise en place d’une cybercoopération mondiale. La majorité des cyberattaques dans le monde est attribuée à la Russie tandis que pour la Chine, l’enjeu du cyberespace est de taille : cet espace constitue un tremplin pour assoir sa puissance technologique à l’échelle mondiale mais elle permet également d’assoir la légitimité du Parti communiste chinois qui souhaite maintenir le contrôle sur sa population en appliquant notamment une stricte censure au sein du cyberespace.
Guerre russo-ukrainienne : un risque de cyber guerre ?
L’Ukraine est régulièrement victime de nombreuses cyberattaques, attribuées à la Russie, et la menace d’une cyberguerre plane sur le pays depuis l’invasion russe le 24 février dernier. En effet, l’Ukraine a recruté des hackers afin de créer une armée digitale, l’IT Army, comprenant près de 260 000 hackers, prête à mener des cyberattaques visant des infrastructures russes. De plus, le groupe Anonymous a annoncé être en guerre contre le gouvernement russe : ils ont déjà notamment mis hors service 1500 sites russes et biélorusses selon leurs affirmations. L’Union européenne se tient également aux côtés de l’Ukraine en cas de cyberattaques. Les Russes ont également attaqué les satellites de communication ukrainiens dans le but de leur couper tout accès à Internet, ce qui a amené le milliardaire américain Elon Musk à activer son service d’accès Internet par satellite au-dessus de l’Ukraine. De son côté, l’OTAN a annoncé en février dernier son intention de renforcer sa coopération avec l’Ukraine contre les cyberattaques. Les menaces se multiplient et nourrissent un sentiment d’inquiétude de la part des Occidentaux. La Russie aurait menacé, le 12 mars, de provoquer un crash de la Station Spatiale Internationale suite aux sanctions adressées à son encontre.
Des pays comme la Russie, refusant tout abandon de leur souveraineté numérique, constituent donc une réelle menace pour la cyberdéfense des Etats. Par exemple, quelques heures après l’annonce de sanctions japonaises à l’encontre de la Russie, un fournisseur de l’entreprise automobile Toyota a été touché par une cyberattaque le 1er mars, paralysant la chaîne de production pendant une journée. Même si rien ne permet d’affirmer avec certitude que la Russie en est responsable, cela montre la menace que représente un pays ne se conformant pas aux intérêts généraux mondiaux.
Quid de la France ?
De manière générale tous les pays, dont la France, sont en état d’alerte. Un responsable de l’OTAN a déclaré que si une cyberattaque visait un des pays membres de l’OTAN, l’article 5 de la charte de l’OTAN selon laquelle « une attaque contre un membre de l’alliance est considérée comme une attaque dirigée contre tous les alliés », pourrait être déclenché.
Avec l’approche de la présidentielle française, le risque de cyberattaque, d’ingérence de puissances étrangères et de désinformation sur les réseaux sociaux, augmentent également drastiquement.
La France n’est donc pas à l’abri d’une cyberattaque étant donné le contexte actuel. A une échelle plus individuelle, il est nécessaire d’être extrêmement vigilant face aux mails d’inconnus ou autres messages et publications sur les réseaux sociaux. Par exemple, certains mails peuvent inciter à soutenir le président ukrainien alors que derrière ce mail des virus peuvent être dissimulés dans des formulaires demandant des informations personnelles sur la personne. Passer par des messageries chiffrées ou encore activer la double authentification, en confirmant par SMS chaque connexion internet peuvent être des solutions pour se prémunir de ces éventuelles menaces.
Par Jessica LOPES BENTO

par jbentolopes | 5 mars 2022 | TBS Press
La valeur famille est la valeur la plus importante pour les jeunes de nos jours en France et plus spécifiquement en Occident. Bien que cette valeur ait évolué ces dernières années du fait du développement de nouvelles structures familiales comme les familles monoparentales, les familles recomposées et même les familles homoparentales, elle reste importante car une majorité de jeunes en France, près de trois quarts d’entre eux affirment qu’elle est prédominante dans leur quotidien. Mais comment la valeur famille est amenée à évoluer ? Les jeunes placent-ils désormais la valeur famille au centre de leurs préoccupations ou cela est-il amené à changer ?
Comment se construit la valeur familiale ?
La valeur famille s’établit à partir de la rencontre de deux individus relativement différents qui échangent et partagent leur système de valeurs au travers de leurs expériences et de leurs vécus au fil des années. A partir de ces échanges, ils choisissent souvent inconsciemment des valeurs communes qu’ils vont transmettre à leurs enfants. L’enfant de cette famille va donc être inculqué par les valeurs dans lesquelles il a grandi avant de devenir autonome et de définir ses propres valeurs qui sont issues de son environnement et de son vécu. En grandissant, l’enfant va souvent se diriger dans le domaine d’activité qu’exerce ses parents et va être initié aux activités auxquelles ils s’adonnent. Dans le même temps, il sera encouragé par ses derniers à poursuivre les mêmes études connaissant les rouages du domaine d’activité dans lequel ils exercent. Par la suite, le jeune va y trouver une forme d’épanouissement ou au contraire, il va décider de s’engager dans une voie opposée à celle de ses parents par opposition à eux.
La valeur famille de nos jours
Depuis plusieurs années, on constate une montée de l’individualisme dans notre société qui amènerait à ce que certaines valeurs comme la valeur de la famille se dissipent avec le temps. Nos institutions parmi lesquelles l’école ou la famille n’occupent plus le même rôle selon les individus et ces derniers choisiraient au contact de leurs différents groupes d’appartenances les valeurs qu’ils jugent les plus importantes. Ce jugement dépend et varie selon les générations, les niveaux d’éducations et la conception du modèle familial qui peut être très diverse selon l’origine et la culture des individus. Parallèlement, on constate qu’aujourd’hui, les jeunes contestent davantage l’autorité que les générations précédentes car leurs esprits critiques se développent grâce aux différents canaux de communication qu’ils ont à disposition ou bien leurs domaines d’études. Cela les ouvre à d’autres types de modèles familiaux, modifient les liens qu’ils entretiennent avec leurs propres familles et questionnent l’importance qu’ils accordent à la valeur de la famille.
Bien qu’il y ait eu des évolutions ces dernières années, on observe tout de même une forte stabilité de la valeur famille. En outre, les jeunes depuis la dernière crise sanitaire, accordent beaucoup plus d’importance sur leurs sentiments de bien-être, leurs qualités de vie. Sans doute ils se sont rendus compte à quel point leur famille était importante à leurs yeux et qu’il était important de profiter de chaque moment avec ses membres.
L’avenir de la valeur famille
Dans un premier temps, on peut déjà imaginer une stabilisation de la valeur famille. Les transformations concernant les formes de familles avec plus de monoparentalité par exemple n’auront pas ou peu de répercussions sur l’importance accordée à la valeur famille. Peu importe la structure dans laquelle le jeune grandit, il restera attaché aux différents membres l’ayant élevé. On peut supposer que cela est dû au fait que la famille dans laquelle un individu fait partie est une entité qui est imposée et qu’il en est par conséquent très difficile de s’en détacher. De ce fait, l’individu doit s’en accommoder et aider les membres qui composent cette famille.
On peut aussi supposer qu’Il y aura à l’avenir une dégradation de la valeur famille car les formes familiales seront complètement différentes qu’auparavant. Par conséquent, il y aura une tendance à la valorisation de la réussite individuelle qui entrainera une diminution de l’importance de cette valeur. Les actifs préféreront assurer la réussite d’une carrière individuelle au détriment de leur vie de famille. Cela aura des répercussions sur les relations qu’ils entretiennent avec les membres de famille qui s’atténueront au fil du temps ainsi qu’avec le partenaire de vie commune.
On peut enfin envisager une valorisation plus importante de la famille, avec une tendance qui placerait la famille au centre des préoccupations des ménages. Les actes d’unions comme le mariage redeviendront des actes symboliques et importants pour les individus et les choix de carrières que feront les actifs prendront comme principale préoccupation leur bien-être familial à défaut de la réussite professionnelle. Les individus privilégieront de se sédentariser et feront des choix de carrières davantage portés sur leur vie de famille. Les évolutions de carrières seront plus difficiles à obtenir au sein de leur domaine d’activité et aura peut-être dans ce cas-ci des répercussions sur son bien-être au travail pour un individu qui sera soucieux d’avoir potentiellement manqué une opportunité.
Par Rémy Lebastard
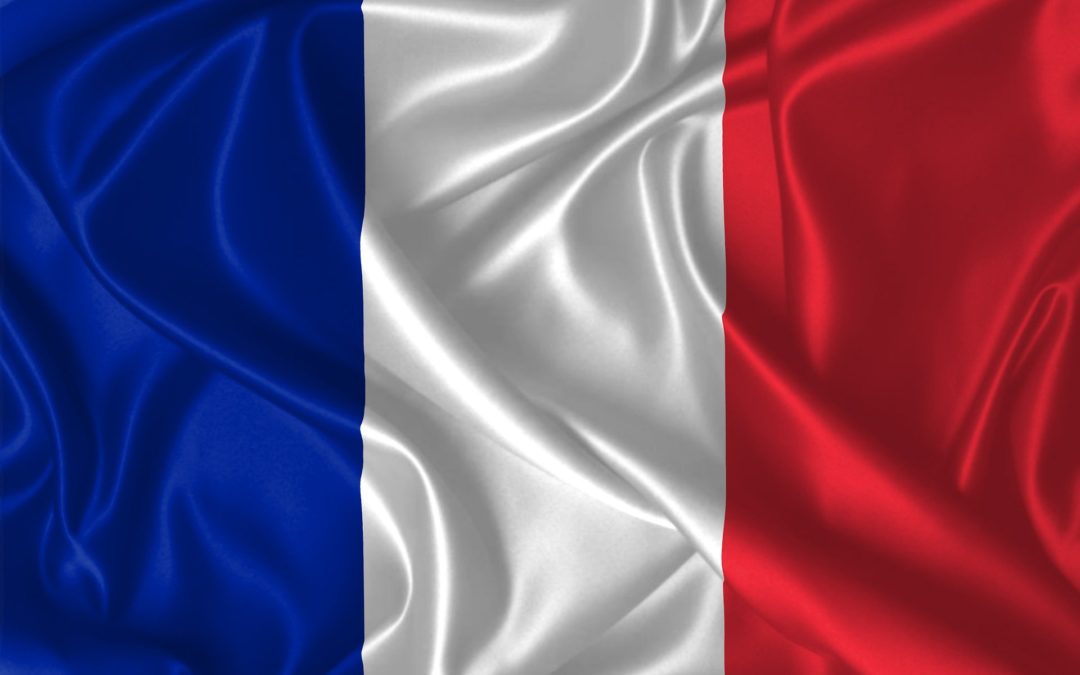









Commentaires récents