
par ecasado | 24 mars 2021 | RDVC EN PARLE n°2, Société, TBS Press
Dans le cadre du mois de la femme, Élea, Narjes et Marion ont eu l’honneur et le plaisir d’échanger avec Valérie Trierweiler, journaliste et femme engagée.
Le parcours de Valérie Trierweiler
Née à Angers dans une famille modeste, elle quitte sa ville natale pour une licence d’histoire à Nanterre. Elle développe sa passion pour l’histoire en Terminale avec son extraordinaire professeur Madame Boussard. Très curieuse, Valérie Trierweiler s’intéresse aussi à la littérature et voit la lecture comme une échappatoire. Parmi ses rendez-vous culturels immanquables, elle cite les émissions politiques L’heure de vérité et Apostrophe.
Dans son parcours scolaire, elle bifurque vers une maîtrise en information et communication puis effectue un master 2 en communication politique. A l’issue de ses études, elle réalise un stage en 1988, année d’élection présidentielle, dans une agence de communication de crise qui lui permet de rencontrer des personnes du milieu. A 23 ans elle intègre le journal Profession politique et rejoint Paris Match deux ans plus tard.
Quelle est la place de la femme dans le monde journalistique et surtout dans le journalisme politique ?
Une carrière journalistique en politique est plus simple pour une femme au démarrage mais son évolution est beaucoup plus complexe lorsqu’elle atteint le plafond de verre. On trouve beaucoup plus de femmes sur le terrain pour récolter des informations auprès des hommes interviewés que dans les postes de direction. La place des femmes dans le journalisme mériterait d’être davantage ouverte aux postes de direction.
Valérie Trierweiler entre d’abord reporter puis grand reporter chez Paris Match. Or ses articles politiques se sont avérés incompatibles avec sa relation avec François Hollande. Paris Match prend la décision de l’écarter de sa rubrique politique en toute logique pour qu’elle se consacre à des chroniques littéraires. Elle savait que ce choix allait s’imposer à elle et se trouvait tout aussi intéressée par le monde de la littérature.
En parallèle, elle travaille chez Direct 8 et anime des émissions politiques comme Le Grand 8, Politiquement parlant et Portrait de campagne. Pourquoi a-t-elle pu continuer ses activités politiques chez Direct 8 mais pas chez Paris Match ? L’animation d’émissions et la rédaction de chroniques sont deux choses différentes. L’écriture demande plus d’investissement personnel que l’animation. Une sorte d’écran se glisse entre l’animatrice et l’interviewé et impose plus de neutralité que la rédaction, les opinions politiques sont moins saillantes. L’écriture d’un article politique suppose d’y mettre une partie de soi.
Pourquoi a-t-elle conservé son activité professionnelle pendant qu’elle était à l’Élysée ? Cette particularité lui a-t-elle desservie ?
Elle a grandi avec l’idée qu’une femme devait être indépendante financièrement ; idée inculquée par sa mère qui la poussa à faire des études dans cette optique.
Elle garde son activité professionnelle lorsqu’elle intègre l’Élysée pour rester indépendante et pouvoir subvenir elle-même aux besoins de ses trois fils. Ce choix surprend et la place comme une première dame moderne. En effet, elle détonne parmi les premières dames puisqu’elle vient d’un milieu moins aisé et poursuit ainsi son activité professionnelle. Ce choix lui a-t-il porté préjudice ? En effet, l’élection de François Hollande a fermé les portes de la présentation d’émissions politiques à Valérie Trierweiler. Or elle a pu continuer d’animer des émissions documentaires ainsi qu’à rédiger ses chroniques littéraires pour Paris Match. Sa chronique a d’ailleurs été davantage mise en avant.
Elle nous raconte d’ailleurs une anecdote en rapport avec sa situation de première dame moderne. Alors qu’elle était première dame, elle se rend dans un magasin avec son fils pour lui acheter des baskets. Au moment de passer en caisse, le vendeur lui demande : « Allez-vous continuer de travailler ?”. Elle lui tend sa carte bancaire et lui dit : “Si je ne travaille pas, qui vous payera ces baskets ?”.
Pourquoi ne s’est-elle pas engagée en politique ?
Cette idée lui a parfois effleuré l’esprit or elle admet que le monde de la politique est cruel. Le politicien est sous le feu des critiques car le monde politique est devenu très difficile. Le moindre faux pas devient un énorme buzz et il ne reste plus que cela : il faut aujourd’hui énormément de courage pour s’engager.
Valérie Trierweiler est très engagée dans des associations. Pourquoi ces causes ?
Valérie Trierweiler a vécu une enfance modeste, elle a été aidée par de nombreuses personnes et souhaite aujourd’hui le rendre à ceux qui ont besoin d’être aidés même si elle confie avoir mis beaucoup de temps avant de s’engager.
Elle s’engage auprès de l’association “Secours populaire français” lorsqu’elle arrive à l’Élysée. Cette association agit en France et dans de nombreux pays étrangers. Il est important que la solidarité ne s’arrête pas aux frontières de la France. Elle est aussi marraine de l’association de raids sportifs luttant contre le cancer du sein “Les Fidèles”, tandis que du Refuge, une association soutenant les jeunes homosexuels chassés de leur foyer. Ses engagements suivent une logique femme/enfant. L’idée qu’un enfant naisse avec l’étiquette “0 chance” sur le front lui est insupportable. Pour elle, il est important d’aider un jeune à réussir sa vie et vivre ses rêves. Or certains enfants ne parviennent même pas à avoir des rêves. Elle raconte être allée à la mer avec des enfants qui ne l’avaient encore jamais vue dans le cadre d’une mission du Secours Populaire. Elle fut attendrie par les enfants qui se réjouissaient de la beauté du lieu. Cette association a ainsi permis de donner un peu de rêve à des enfants qui n’avaient encore jamais connu la beauté du littoral.
Que reste-t-il à faire pour l’égalité des chances ?
Beaucoup de choses ont été faites. Cela n’est cependant pas suffisant. Il est important de donner de son temps, de parrainer des enfants ou par exemple de donner des cours comme le propose le Secours Populaire. La transmission est un mot qui lui tient à cœur. Selon Valérie Trierweiler, il faut tendre la main aux enfants en leur proposant de découvrir la culture. Le but est d’ouvrir la voie aux nouvelles générations, de donner confiance aux parents et de montrer la beauté aux enfants. Elle encourage tous les jeunes à transmettre et à redonner à ceux qui en ont besoin comme elle a pu être aidée quand elle était jeune.
Enfin, il est important de casser les ghettos en donnant le même enseignement à tous, tout cela en répartissant mieux les différents enseignants.
Le conseil de Valérie Trierweiler pour les jeunes qui souhaitent s’engager dans des actions humanitaires / caritatives ?
« Aller vers là où on a envie d’aller, le faire au moment où on le sent et ne pas le faire parce que l’on se sent forcé de le faire » tel est le conseil que Valérie Trierweiler nous a donné. Elle considère n’avoir jamais vraiment fait d’humanitaire sur le terrain mais elle admire les jeunes gens qui se dévouent pour ces causes. Elle nous a notamment rappelé une anecdote d’une rencontre avec une jeune fille en mission humanitaire au Vietnam, qui avait pour but de soigner des enfants victimes de malformations à cause du napalm.
L’humanitaire est une richesse qui permet de découvrir le monde, car il est important de voir de quoi et comment vivent les autres. C’est à travers cette découverte que l’on s’enrichit.
Les femmes ont-elles quelque chose à jouer aujourd’hui ?
« Votre génération doit dépasser la culpabilité et le plafond de verre, ce que ma génération n’a pas su faire. »
La première chose à noter est le fait que la question du féminisme aujourd’hui ne devrait plus se poser. Les femmes doivent dépasser la culpabilité, le plafond de verre, la question de la gestion de leur temps et des priorités en tant que femme. Les femmes ne doivent pas agir et se comporter dans une logique de revanche envers les hommes, elles doivent agir en tant qu’égales. Les femmes « n’ont pas le temps de perdre du temps ». Elles vont donc à l’essentiel et ne font pas les choses de la même façon que les hommes, elles agissent de manière plus humaine. S’il y a une chose qu’il faut retenir c’est qu’ « aucun métier ne mérite que l’on sacrifie sa vie privée, ne pas oublier de vivre sa vie et sa vie de femme ». Il ne faut pas oublier l’amour ni la maternité, la vie passe vite.
La vie d’une femme est très concentrée sur une dizaine d’années puisque tout arrive en même temps comme la maternité, la vie amoureuse et professionnelle mais il ne faut pas se laisser submerger et privilégier une direction. La vie de femme n’est pas simple puisque tout se joue au même moment alors vivons pleinement notre vie de femme.
« Aller vers là où on a envie d’aller, le faire au moment où on le sent et ne pas le faire parce que l’on se sent forcé de le faire »
« Aucun métier ne mérite que l’on sacrifie sa vie privée, ne pas oublier de vivre sa vie et sa vie de femme »

par ecasado | 19 mars 2021 | Société, TBS Press
Cela n’aura échappé à personne, nous vivons dans un monde souvent dénué de morale ou de sens logique. Les réseaux sociaux en sont d’ailleurs les premiers indicateurs : ici commence la réflexion dont je vais vous faire part.
Je me baladais innocemment sur Instagram, lorsque je suis tombée sur le profil de l’enfant d’un dictateur décédé. (Je préserverai son anonymat afin de ne pas lui donner une visibilité non méritée, ni lui attirer les foudres des fidèles lect.rice.eur.s RDVC). J’ai donc regardé le contenu de cette personne jusqu’à apercevoir des photos de son père, tantôt en famille et d’autres fois lors d’un discours politique. Intriguée, je me suis penchée sur les descriptions de ces photos : « J’aimerais oublier ton absence pour un instant, j’aimerais chanter pour toi, lire pour toi, te câliner et te parler « , « Je t’aime », l’amour d’un.e enfant envers un parent, jusque-là tout peut sembler à peu près normal. J’ai ensuite lu « Joyeux anniversaire à toi, homme bon ». « Homme bon « . Voici les mots qui ont mis le feu aux poudres.
Aimer son papa n’a en soi rien de choquant.
Cette personne dont j’ai vu le profil souffre du deuil d’un parent, et exprime sa douleur au travers de photos souvenirs et de mots d’amour. Il s’agit d’un être humain, qui est aveuglé par sa subjectivité et son affection pour un proche.
Mais voilà, le premier problème est que les photos ne sont pas uniquement des photos familiales. Non. Cette personne a ressenti le besoin de poster également une photo politique, accompagnée d’une description édulcorée. Certes, l’homme politique et le père de famille devaient être deux hommes très différents. Mais confondre les deux en glorifiant le père sous la photo du dictateur est nettement discutable. Les deux facettes de sa personnalité ont fait de lui l’homme qu’il était ; ne montrer que la face arrangeante de ce monstre politique est alors très dérangeant.
Peut-on afficher publiquement son amour pour son père, lorsque ce dernier est un dictateur ?
L’enfant dont je vous parle a aujourd’hui une vingtaine d’années, et a suivi des cours dans une école parisienne prestigieuse. Inutile de préciser que les frais de scolarité ont été payés grâce aux détournements de richesses et aux trafics de son père, alors même que la population de son pays d’origine meurt de famine et d’oppression politique.
Je disais précédemment que notre cher despote était différent dans la sphère publique et dans la sphère privée : les deux milieux sont donc à nuancer n’est-ce pas ? Alors pourquoi diable son enfant rend public uniquement l’aspect privé de la vie de son père ?
Ne parler que du père de famille aimant et attentionné dans des descriptions publiques, parfois sous des photos politiques, sans jamais nuancer ni préciser les crimes contre l’humanité et les pratiques illégales de cet homme politique abject, revient à nier la gravité de ses actes. Pourtant, ils ont plongé un pays entier dans la crise et la violence. Ce dictateur ne se cachait pas de ses actes : « patrie, socialisme ou mort » était son slogan de campagne. Effacer publiquement l’homme politique pour ne montrer que le père aimant aux yeux du monde se rapproche d’un négationnisme immoral, et revient à écraser tout le peuple victime de ce tyran, désormais idéalisé sur la toile.
« Mais c’est l’enfant de ce dictateur, qui est en admiration de son père ! L’amour rend irrationnel, et parfois incapable de voir la part d’ombre dans nos êtres chers ! »
NON. Cet argument n’est pas recevable. S’il s’agissait d’un.e descendant.e d’Hitler ou de Mao Zedong, le monde entier serait outré. Pourquoi devrait-ce être différent pour ce dictateur américain ?
Son enfant a eu accès à des études supérieures prestigieuses, ainsi qu’à toutes les informations cachées par son Gouvernement d’origine, depuis la France. De plus, toute personne sensée sait distinguer le public du privé, la politique du familial.
Vous n’êtes pas d’accord ?
Prenons l’exemple de Juan Pablo Escobar Henao, fils du narcotrafiquant Pablo Escobar.
Si ce dernier explique avoir été bien éduqué, aimé et protégé par son géniteur, il n’en reste pas moins lucide sur les activités immorales et criminelles de ce dernier. Cet enfant de meurtrier aime son père, mais a toujours dénoncé publiquement les actes de celui qui a tué et vendu des drogues dangereuses à des milliers de personnes.
Si cet homme qui a perdu son père à 16 ans sait se tenir publiquement, pourquoi l’enfant du dictateur (qui a perdu son père à la même période de sa vie) ne peut faire de même ?
Nous ne parlons pas ici d’un parent ayant commis un simple délit, ni même un crime unique, mais bien d’un dictateur ayant commis des crimes contre toute sa Nation.
Vous pensez peut-être encore qu’il s’agit de sa liberté d’expression, que de glorifier son père en négligeant son inhumanité politique est son droit.
Mais « La liberté ne se reconnaît qu’à ses limites » – Louis Latzarus. Or les limites de la morale ont été outrepassées dans ces posts, qui cautionnent un politique peu soucieux des Droits de l’Homme.
Par respect pour les victimes de ce « »Président » » peu scrupuleux, son enfant devrait rendre ses comptes privés, ou bien choisir de mieux nuancer ces propos à minima.
« La liberté des uns finit où commence celle des autres » – John Stuart Mill.
Par Iris DEVILLIERE
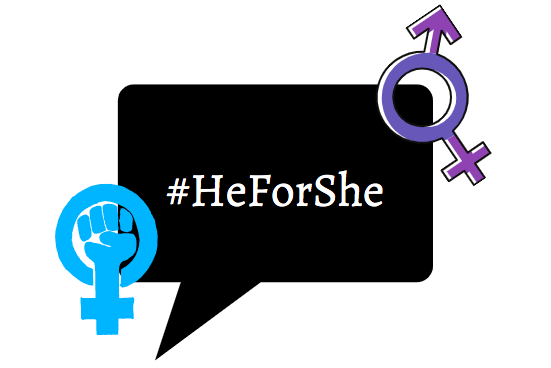
par ecasado | 12 mars 2021 | Société, TBS Press
Le mouvement #HeForShe a été créé en 2014 par l’ONU Femmes. C’est un mouvement qui se bat pour la solidarité des sexes, qui veut faire participer les hommes dans le combat de l’égalité des sexes. Ce mouvement est rendu populaire par Emma Watson, qui prononce un discours très médiatisé le 20 septembre 2014 à l’ONU. Il s’est ensuite répandu dans le monde entier. Intéressons-nous aux causes que défend le mouvement !
Que défend le mouvement #HeForShe ?
Initialement, quand on pense aux mouvements féministes, on imagine des femmes qui manifestent dans la rue. C’est justement contre cette image que veut s’engager le mouvement. En effet, #HeForShe s’adresse avant tout aux hommes et garçons pour qu’ils défendent eux-aussi l’égalité des sexes. A cause des nombreux actes de harcèlement sexuel ou violences sexistes dont on parle dans le monde, on a tendance à oublier qu’il existe aussi beaucoup d’hommes biens dans la société. En effet, avec les mouvements tels que #BalanceTonPorc ou #MeToo, très populaires sur les réseaux sociaux, on finit par voir les hommes comme étant nécessairement des animaux sexuels, qui ne respectent pas les femmes. Or, la réalité est bien différente. Oui, il existe des hommes qui ne respectent pas les femmes. Oui, il y a des hommes qui normalisent les violences sexuelles. Oui, tous ces hommes existent. Cependant, les hommes respectent aussi les femmes, les défendent et les soutiennent. La stratégie de #HeForShe repose sur trois piliers : l’éducation, le plaidoyer en faveur des politiques et la mobilisation des fonds. Ces programmes sont pilotés et contrôlés par l’ONU, qui s’assure de la bonne application du programme et de sa bonne interprétation.
Son intégration dans la société
Le mouvement a très vite gagné en popularité et a été étendu et appliqué dans la société : les universités, les écoles supérieures, même les entreprises s’y mettent. Renault a été la première à s’engager dans le mouvement #HeForShe. Le site internet du groupe déclare « Parce qu’il est des évidences comme l’égalité femme-homme qu’il semble bon et nécessaire de rappeler ; parce que l’école mixte devrait conduire à des cursus d’études mixtes à parité ; parce qu’il faudrait enfin arrêter d’avoir des métiers d’hommes et des métiers de femmes, des entreprises d’hommes et des entreprises de femmes ; parce que les stéréotypes ont la vie dure ; parce qu’il serait dommage de nous priver de la richesse que nous apportent le respect mutuel et l’écoute mutuelle… Mobilisez-vous sur le site He For She pour faire évoluer les mentalités et faire changer les comportements inappropriés ». Les autres ont été nombreuses à suivre : Schneider Electrics, AccorHotels, Sporsora et bien d’autres. Cependant, comme l’a déclaré Renault, l’égalité des sexes doit avant tout commencer à être enseigné dès le plus jeune âge et cela passe donc bien par l’éducation. L’école de commerce Kedge BS lance le projet en 2015 dans l’école, il en est de même pour Neoma BS en 2017, Skema en 2018, l’Essec en 2020 et ainsi de suite. Aujourd’hui, toutes les écoles ont des associations en lien avec l’égalité des sexes. A TBS, nous avons bien évidemment Prism, mais aussi l’ATC Equal’ID. On comprend donc bien que ce mouvement a été largement intégré par la société, aussi bien dans l’éducation que dans la vie professionnelle.
Les célébrités le reprennent
Comme beaucoup de mouvements, ceux-ci gagnent en visibilité grâce aux célébrités qui le soutiennent. Un des premiers exemples de cela a été Nespresso qui a tourné ses spots publicitaires avec George Clooney. C’est donc ce qu’a mis en place aussi l’ONU. En faisant d’Emma Watson l’ambassadrice du mouvement #HeForShe, l’ONU Femmes a gagné en visibilité. Quand on pense à #HeForShe, on voit tout de suite l’image de Emma Watson qui parle à la tribune de l’ONU. C’est cela qui fait la force du mouvement. Ensuite, d’autres célébrités l’ont repris, comme Harry Styles, le Prince Harry, Russell Crowe et tant d’autres. Il faut bien voir que c’est aussi là que l’ONU a frappé très fort : les hommes se sont sentis tellement touchés qu’ils ont eu le besoin de déclarer publiquement leur soutient à #HeForShe. En effet, on se doute que beaucoup de personnes soutiennent ce type de mouvements, mais que ce soutien est plus personnel, plus privé. Or, ces célébrités masculines ont éprouvé le besoin d’exprimer publiquement leur avis. Et ces dernières ont pris à coeur ce mouvement : aussi bien Harry Styles que le Prince Harry ont des réputations immaculées en ce qui concernent leurs relations avec les femmes. En effet, on se doute que certaines célébrités masculines ont sauté sur l’occasion pour pratiquer du « green washing » et redorer leur image, quelque peu souillée par des scandales sexuels. Ainsi, il ne faut pas associer un mouvement aux personnes qui le représentent, mais bien aux causes qu’il défend et soutient.
Pour conclure
« L’égalité des sexes libère non seulement les femmes, mais aussi les hommes soumis aux stéréotypes du genre », Emma Watson à l’ONU. Pour finir, souvenez-vous de cette phrase. L’égalité des sexes n’est pas une cause féministe. L’égalité des sexes est une cause fondamentale. L’égalité des sexes est un mouvement humain.
Par Elise Casado

par ecasado | 5 mars 2021 | Société, TBS Press
Le mois des droits de la femme est souvent l’occasion pour rappeler que nous avons fait de grands progrès en tant que civilisation, surtout durant le dernier siècle. Cette période est aussi souvent le moment de dénoncer nos fautes et les injustices, vraies ou fausses, dans la lutte éternelle pour l’égalité des chances de la moitié de notre population.
Aujourd’hui, je voudrais attirer votre attention sur les femmes qui n’ont pas la même chance que nous, parce que l’on semble parler très peu d’elles et, quand on le fait, on se concentre trop sur la politique et non pas assez sur le sujet important : le bien-être de ces jeunes femmes.
Je voudrais surtout profiter de cette occasion pour mettre en avant la réalité d’une femme, courageuse et intelligente. Son histoire porte sur sa vie au sein d’une famille de confession musulmane. Elle habite en Égypte et le voile a marqué sa vie.
Mais plus important encore, son histoire témoigne que porter le voile, que ce soit en Égypte, aux Etats-Unis ou même en France, n’est pas aussi simple ; et que les femmes voilées méritent beaucoup plus qu’un simple : « Elles font ce qu’elles veulent ».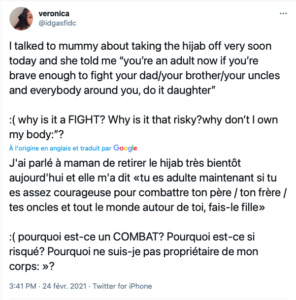
Cette femme s’appelle donc Veronica. J’ai commencé à la suivre sur Twitter il y a un peu plus d’un an. C’est une étudiante d’une université en Égypte qui rêve de déménager aux États-Unis pour pouvoir jouir de la liberté de dire à haute voix ce qu’elle pense sur la religion, sur l’islam, sur le féminisme, sur la façon dont on lui a enlevé sa liberté, et pour pouvoir finalement enlever son voile, aujourd’hui symbole de sa soumission.

Grâce à Internet, elle n’a que cette possibilité pour s’exprimer et pour faire comprendre au monde la réalité de certaines filles de l’autre côté du monde libre. On est habitués – nous, en Occident – à avoir une certaine liberté que l’on prend trop souvent pour acquise.
Mais pour elle, c’est une chose pour laquelle elle lutte tous les jours avec bravoure, depuis un compte anonyme sur Twitter, où elle raconte son histoire. Et pourquoi un compte anonyme ? Parce qu’elle se ferait agresser autrement, par son père, par ses oncles, par ses cousins.
Dans un pays qui n’est pas laïque, qui ne respecte pas les droits de l’homme, qui rend la vie impossible pour ceux qui veulent laisser l’islam ou changer de religion vers le christianisme, elle est toute seule.
Aucune institution gouvernementale ne lui assure de la protection. Et même s’il existait une telle institution, il serait impossible de la protéger des gens qui habitent dans la chambre à côté.
Le 25 février dernier elle publie le tweet suivant : « J’ai parlé avec maman parce que je veux enlever le voile et elle m’a répondu : “Tu es une adulte maintenant et si tu as le courage de faire face à ton père/frères/oncles, fais-le, ma fille”. »

Un homme bien intentionné lui répond dans un autre tweet : « Vous êtes une adulte et si les hommes ne sont pas d’accord avec vous, rappelez-leur qu’il n’y a aucune obligation par rapport à la religion ». Sa réponse : « On ne va pas tout simplement ne pas être d’accord avec moi ; on va possiblement me tuer ».
C’est quand la dernière fois que vous avez vécu un tel danger pour enlever un morceau de toile ? Quelques lignes plus loin, elle ajoute : « Pourquoi est-ce une bataille ? Pourquoi est-ce tellement risqué ? Pourquoi ne suis-je pas propriétaire de mon corps ? »
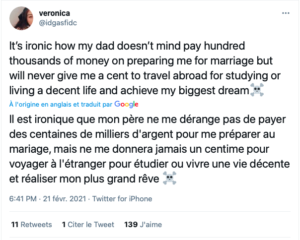
Dans un autre tweet, elle nous raconte que la mère en est aussi victime. Violée par son beau-père le jour de son mariage, elle a été obligée de se marier avec le père de Veronica. Aujourd’hui les deux sont divorcés, mais le père contrôle toujours la vie des deux, de la mère et de la fille.
Que pouvons-nous faire depuis la France, libre encore, à part d’en parler et de rappeler au monde que toutes les femmes n’ont pas les droits fondamentaux ? Au moins, pouvons-nous essayer de mieux protéger les filles et femmes que nous pouvons atteindre, celles qui habitent dans notre pays.
Il faut aussi se rappeler que cette histoire se passe en Égypte et non pas, par exemple, en Arabie Saoudite. Veronica n’est pas obligée légalement à porter le voile. L’islam est la religion officielle de l’Égypte, certes, mais il n’y a pas de loi Sharia là-bas.

Veronica subit le voile non pas à cause de l’État égyptien, mais à cause de son père. Si ce n’est pas à cause de l’État, si, contrairement à d’autres pays, la police ne va pas l’emprisonner pour enlever son voile, si elle a légalement le droit de changer et même d’abandonner sa religion, si elle est obligée de se soumettre par des hommes abusifs qui dorment dans la chambre à côté, ne croyez-vous pas que ça peut arriver à toute fille indépendamment du pays où elle vit ?
Le pays n’est pas son bourreau, ce sont les membres de sa famille ; et rien ne nous dit qu’une telle famille ne peut exister dans un autre pays, même en France. Très longtemps le débat public en France s’est focalisé sur l’interdiction du voile. Est-ce que les femmes voilées sont forcées par leurs maris et leurs pères ?

Si on posait la question à Veronica en personne, elle ne nous dirait certainement pas la vérité, par peur d’être maltraitée par son père, même si – tout comme en France – aucune loi dans son pays n’oblige les femmes à se voiler.
On semble oublier que, tout comme personne ne devrait forcer une femme à se voiler, aucune personne ne peut lui interdire le voile une fois qu’elle a choisi de le porter.
Éloignons-nous du débat de l’interdiction du voile et parlons de ce qui est vraiment important : la vie de ces jeunes filles qui, comme Veronica, souffrent et qui se battent tous les jours contre les idéologies de leurs parents. Parce que cela ne dépend pas du pays, mais de la famille dont elles font partie.

Qui nous dit que toutes les femmes voilées, ces oubliées du mois de la femme, dont on célèbre le courage de porter le voile, ont le droit de faire le choix chez elles ? Qui nous dit que, même si elles ne sont pas en danger physique, leurs familles ne seraient pas déçues si elles enlevaient ce morceau de toile ? Si votre mère vous disait que si vous enlevez un morceau de toile, elle se mettrait à pleurer, l’enlèveriez-vous ?
Ces jeunes femmes voilées sont les oubliées du mois de la femme. Justement parce que nous sommes trop rapides à célébrer leur courage de se voiler devant tout le monde. Bien sûr que cela demande du courage de choisir de se voiler, mais cela en demande aussi – et encore plus – de se voiler pour d’autres circonstances.
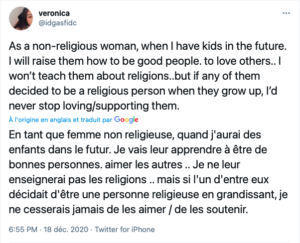
Ce mois des droits de la femme, pensons à ces femmes qui, en Égypte comme en France, n’ont pas tout à fait le dernier mot sur leurs propres corps. Parce que nous ne pourrons jamais les aider si nous n’acceptons pas qu’elles existent. Si vous êtes une femme voilée par choix, sachez que personne n’a le droit de vous l’interdire.
Mais si vous l’êtes pour une autre raison, j’espère que cet article aidera les autres à comprendre que, parfois, ce n’est pas aussi simple ; et que nous savons que vous êtes probablement en train de mener une bataille interne dont seuls les héros des plus grandes épopées seraient dignes. N’oublions donc pas que, souvent, « elles ne font pas ce qu’elles veulent ».
Par Alejandro Avila Ortiz

par ecasado | 5 février 2021 | Société, TBS Press
En regardant sur un calendrier relatant les évènements quotidiens, j’ai découvert qu’à pratiquement chaque jour de l’année était associé un événement, en faisant alors une journée internationale. Mais entre les journées dédiées à la maladie de Parkinson ou l’éducation viennent s’ajouter des journées mondiales dont la légitimité est grandement discutable. Et de fait, aujourd’hui, le 5 février est la journée mondiale du Nutella. Comment ce produit, qui suscite autant de plaisir gustatif que d’indignation, peut-il avoir une journée qui lui est dédiée ?
Comment apparaissent les journées mondiales et par qui sont-elles décidées ?
Une initiative des institutions
Sont majoritairement à l’initiative de ce projet, l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation Mondiale de la Santé et les Organisations Non Gouvernementales. Lors d’une Assemblée à l’ONU, sont décidées par consensus des journées au niveau internationales, dans le but d’ « aborder des aspects essentiels de la vie humaine, des enjeux importants du monde ou de l’histoire et à sensibiliser le public” comme l’explique l’institution. Ainsi, les Nations Unies ont établi une liste d’environ 140 journées mondiales dont en voici la liste pour le mois de février :
| 2 Février |
Journée mondiale des zones humides |
| 4 Février |
Journée mondiale contre le cancer |
| 6 Février |
Journée internationale de tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines |
| 8 Février |
Journée mondiale sans téléphone portable |
| 10 Février |
Journée internationale des légumineuses |
| 11 Février |
Journée internationale des femmes de science |
| 12 Février |
Journée Darwin |
| 13 Février |
Journée mondiale de la radio |
| 14 Février |
Journée internationale de sensibilisation aux cardiopathies congénitales |
| 15 Février |
Journée mondiale contre le cancer chez l’enfant |
| 20 Février |
Journée mondiale de la justice sociale |
| 21 Février |
Journée internationale de la langue maternelle |
| 27 Février |
Journée mondiale des ONG |
| 28 ou 29 Février |
Journée mondiale des maladies rares. |
(Regroupe les journées mondiales établies par l’ensemble des organisations mais pas les journées mondiales non officielles)
Si l’on peut s’interroger sur la pertinence de certaines journées et la raison de leur mise en place, sur leur site internet les Nations Unies mentionnent “ Certains thèmes, comme l’aide humanitaire, la jeunesse ou les réfugiés, semblent évidents au regard des questions qui dominent l’actualité et le champ d’action des Nations Unies. D’autres sujets peuvent paraître pour le moins curieux, mais attirent en réalité notre attention sur un enjeu important du monde ou un aspect essentiel de la vie humaine. La journée des toilettes met en lumière les conséquences du manque d’assainissement pour près des deux tiers des habitants de la planète. La journée des abeilles souligne à quel point la production agricole mondiale est dépendante de ces pollinisateurs de plus en plus menacés par les activités humaines. D’autres journées nous amènent également à tirer les leçons des atrocités du passé ou à célébrer ceux qui ont tant lutté pour notre avenir. “
Sont donc détaillées sur ce même site web ces journées mondiales dont la date n’a pas été déterminée au hasard : par exemple, la première journée a vu le jour en 1950 suite à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948. La journée mondiale des Droits de l’Homme est donc célébrée depuis 1950 le 10 décembre de chaque année. Cependant, ces dernières années, sont apparues d’autres journées mondiales, parfois plus contestables les unes que les autres.
Journées mondiales “non-officielles”
L’instauration des journées mondiales n’est pas restreinte aux organisations puisque les associations, groupes de pression, entreprises et particuliers peuvent également créer la leur. Il suffit en effet de trouver un sujet intéressant qui peut rassembler des personnes et de déposer un nom auprès de l’Institut National de la propriété Intellectuelle. Mais cette dernière étape n’est même pas obligatoire. Il faut cependant, comme tout projet, avoir de quoi financer cette journée, en faire la communication pour susciter de l’intérêt et trouver des partenaires pour améliorer sa visibilité afin de porter son projet. C’est ainsi que sont apparues, au fil du temps, plus de 400 journées mondiales, dont incontestablement plusieurs tombent le même jour.
Ainsi sont rentrées dans notre quotidien, et notamment par la médiatisation de certaines journées, la journée mondiale du Blue Monday (jour le plus déprimant de l’année le 18 janvier) ou la journée mondiale sans téléphone mobile (6 février).
Le 5 février, journée mondiale du Nutella
Revenons donc à la journée mondiale du Nutella, et sur l’occasion de se remémorer l’histoire de cette pâte à tartiner, apparue à la fin des années 1940 par Pietro Ferrero. Après la Seconde Guerre mondiale, ce pâtissier-chocolatier originaire d’Italie, alors que le chocolat se fait rare, décide de créer une pâte à tartiner à laquelle l’on pourrait ajouter d’autres ingrédients, tout en gardant un goût chocolaté. Elle doit aussi pouvoir permettre “aux enfants de manger du chocolat sur du pain plus facilement au lieu d’attendre qu’il fonde”. Le succès fut tel qu’en 1946 fut créée l’entreprise Ferrero, dont nous connaissons aujourd’hui la majorité des produits. Quant à l’appellation du produit, d’abord passée par les noms “Supercrema” puis “Tartinoise” lors de son arrivée en France, elle portera ensuite le nom qu’on lui connaît aujourd’hui provenant de “Nut” (noisette en anglais) et “ella” rappelant l’Italie, pays d’origine du produit.
A l’origine de cette journée mondiale est une bloggeuse américaine, Sara Ross, qui, en février 2007, décide de populariser et de dédier une journée au produit qu’elle aime tant. Si le groupe Ferrero n’est pas à l’origine de la journée mondiale de son produit phare, sa créatrice a décidé de retransmettre quelques années plus tard la gestion de cette journée à la marque qui mentionne sur son site internet spécialement créé pour l’occasion (www.nutelladay.com), des moyens de fêter comme il se doit cette journée.
Cependant, si comme l’explique Le Monde “quelque 75 000 tonnes de Nutella sont consommées chaque année dans l’Hexagone” en 2012 faisant ainsi de la France le premier consommateur de Nutella, la journée mondiale de la pâte à tartiner à la composition néfaste autant pour l’environnement que la santé est évidemment contestée. De la lécithine de soja qui pourrait “augmenter le risque de troubles hormonaux, de cancer du sein ou de problèmes de thyroïde” (selon un reportage diffusé sur France 5 sur le soja), 57 grammes de sucre pour 100 grammes de produits favorisant l’obésité et le diabète, et du lait écrémé en poudre aux bienfaits nutritionnels nuls. Et cela sans oublier l’huile de palme, le produit phare de cette recette avec peu d’ingrédients et aucun conservateur pourtant accusé d’augmenter le risque des maladies vasculaires et responsable d’une bonne partie de la déforestation de l’environnement.
Alors dans un élan de conscience collective de nombreuses personnes se sont attelées à la conception de leur pâte à tartiner maison, sans huile de palme et sans (ou moins de) sucre, mais la fameuse pâte à tartiner reste toutefois difficile à égaler et donc à remplacer. Par ailleurs, les journées mondiales pouvant librement être créées, et perpétuées par leur popularité, la journée de la pâte à tartiner tant vénérée est engagée pour perdurer plusieurs années.
Les journées sont-elles supprimables ?
Oui les journées mises en place par l’ONU font à nouveau l’objet d’une discussion et leur suppression est votée à la majorité. En ce qui concerne les journées non officielles, elles ne sont pas établies donc ne peuvent pas être supprimées, puisque théoriquement pas actées. Elles ne peuvent qu’être contestées, et l’on peut espérer que, puisqu’elles doivent leur existence à l’engouement général d’un grand nombre de personnes, la probabilité qu’une journée non officielle vienne porter atteinte à une valeur française par exemple demeure faible. Pour ceux que cette journée rend perplexe et ne comprennent pas forcément qu’elle a pu être popularisée, sachez qu’il existe une journée mondiale du sushi (18 Juin), du Kiss a Ginger Day (12 Janvier), de la quenouille (7 janvier) de la bataille d’oreiller (4 Avril), du coloriage, du jardinage nu, de la serviette (25 mai), du tricot, de la poupée ou de Star Wars (4 mai).
Alors s’il vous vient l’envie de créer la vôtre, lancez-vous, et profitez-en pour y réfléchir autour d’une tartine de Nutella, c’est la journée !
Par Léa MENARD

par ecasado | 8 janvier 2021 | Société, TBS Press
Miss France est LE concours de beauté par excellence, l’événement que les français.e.s attendent tou.s.tes tous les ans. Créé en 1920, ce concours repose sur la sélection de 15 Miss régionales qui prétendent à devenir LA Miss nationale, LA plus belle femme de l’année. L’heureuse élue aura pour rôle de représenter le pays à échelle internationale, ce pour dorer l’image de la France et participer à des actions humanitaires. Si ce concours revendique la mise en avant de jeunes femmes aussi belles qu’intelligentes, n’est-il pas en réalité axé purement sur le physique et des critères subjectifs de beauté ?
1. Des critères de sélection dépassés
Les Miss régionales doivent respecter des critères très précis auxquels aucune ne peut se soustraire. Il faut entre autres :
- Avoir un âge compris entre 18 et 24 ans à la date du 1er novembre de l’année en cours ;
- Être célibataire ;
- Mesurer au minimum 1,70 m ;
Il ne faut pas, entre autres :
- Avoir posé partiellement ou totalement dénudée ou promouvoir des activités érotiques ;
- Être tatouée (sauf tatouage discret) et/ou percée ;
- Être mariée, pacsée, divorcée ou veuve ;
- Avoir des enfants ;
Le concours prône donc un canon de beauté arriéré, puisqu’être grande et mince n’est aujourd’hui plus la silhouette à la mode. Les femmes callipyges aux courbes prononcées sont énormément mises en avant, de même que des silhouettes inhumaines accessibles uniquement par le biais de la chirurgie ou de Photoshop (Kylie Jenner et Kim Kardashian peuvent en témoigner). Ce modèle de beauté unique vendu par Miss France n’est donc plus compatible avec la société actuelle, dans laquelle le corps idéal est à l’opposé de celui des miss. La grande taille est également un critère cocasse, puisque notre société met plutôt en avant les femmes de taille inférieure à 1,70m. Le fait de ne pas pouvoir être tatouée et/ou percée est également discutable, puisque cela ne change en rien la beauté objective d’une personne.
Le statut familial et marital imposé peut aussi être remis en cause. En effet, avoir des enfants peut être un frein pour une Miss France qui voyage beaucoup et est souvent peu disponible ; ce critère peut donc être entendu, bien que chacune devrait être libre de sa décision. Néanmoins, le fait d’être célibataire et de n’avoir jamais été mariée est un critère totalement déplacé. Il rappelle les groupes de K POP où les chant.eurs.euses sont des produits de consommation, des objets de fantasmes dont l’image doit rester vierge et que le public doit avoir l’impression de contrôler. Les Miss sont des femmes adultes, et devraient pouvoir décider si leur relation leur permet d’être disponibles ou non pour le Titre.
Quant au rejet des Miss ayant pris des photos dénudées ou ayant une image sexualisée, il s’agit d’un critère totalement hypocrite. On impose à ces femmes d’être pures et propres de tout caractère sexuel dans une société qui met en avant l’hypersexualisation des corps, et particulièrement des femmes. C’est alors une bonne chose, voire un acte féministe me direz-vous, que de combattre cette image de « femme-objet » ? Que nenni ! Il est demandé aux Miss de se trémousser en bikini sur scène, et de prendre des photos « féminines », sans aucune trace d’humanité comme la cellulite ou les vergetures qui ne sont pas digne des corps de nos Miss.
Finalement, les critères de sélection problématiques que nous avons cités véhiculent une image idéalisée dangereuse de la femme. Nos Miss sont des objets de fantasmes et reflètent une réalité des corps peu répandue. Le danger est alors que les téléspectatrices cherchent à leur ressembler, ce qui affecte négativement leur bien-être psychologique ainsi que leur santé : être grande et mince au point d’être un « poids plume » n’est pas adapté à toutes les morphologies, ni à tous les rythmes de vie ! Quant à l’âge, il est dommage de considérer qu’au-delà de 24 ans la beauté s’étiole.
2. Miss France ne reflète pas la femme française « moyenne »
« Miss France », ou la représentante par excellence de la Femme française. Grandes, élancées, très minces : ces magnifiques jeunes femmes concourent pour devenir l’emblème de la féminité à la française. Les prétendantes au titre doivent mesurer 1,70m minimum, et sont toujours très minces : aucune ne dépasse la taille 36. Puisqu’elles espèrent être l’image et le visage de toutes leurs compatriotes, nous pourrions nous attendre à ce qu’elles incarnent le profil majoritaire des femmes françaises, à défaut de représenter la diversité des morphologies : mais il n’en est rien.
En France, seules 21,4 % des femmes mesurent plus d’1,70m, tandis que 7,8% s’habillent en taille 36 ou moins (données d’une étude clickndress de 2016). La grande majorité des femmes françaises font une taille 40 ou plus, et mesurent moins d’1,65m. Pourquoi donc sélectionner des profils totalement éloignés de ce que sont vraiment les femmes françaises ?
Supprimer la diversité des profils et choisir des critères rares parmi la population sont deux pratiques paradoxales au vu de l’intitulé du concours. Au moins l’un de ces deux modes de sélection devrait être supprimé (si ce n’est les deux) pour rester cohérents. Certes « Miss France » doit refléter l’image de la plus belle femme de France, et non pas forcément l’image de la française moyenne. Toutefois, si le mode de sélection est biaisé au point de reposer sur des critères aux antipodes de la population représentée, la dissonance entre le titre et ce qu’il est supposé représenter devient trop grande pour être acceptable.
Pourrait-on choisir de faire gagner le concours de la Vache de l’année par un yack, sous prétexte que l’animal est plus impressionnant ? Bien que ces bovidés se ressemblent, cette pratique ne serait pas acceptée au Salon de l’Agriculture. Alors pourquoi faire représenter les françaises uniquement par des femmes hors du commun de notre population ?
3. Un concours qui ne met pas en avant les candidates à leur juste valeur
Sylvie Tellier a récemment affirmé que Miss France est avant tout un concours de beauté, mais qu’il a évolué afin de présenter des femmes cultivées et intelligentes au-delà de leur plastique de rêve. Certes, les miss sont sélectionnées à l’aide d’un QCM de Culture Générale composé de 40 questions : en-deçà de 20 réponses justes, elles ne sont pas sélectionnées. Ce sont donc des femmes aux têtes remplies.
Pourtant le jour du concours, leurs discours se ressemblent tous : leurs aspirations humanistes et altruistes sont toujours les mêmes, la construction des textes est peu originale. Ces jeunes femmes sont belles et certainement brillantes ! Il est réellement dommage de ne pas plus mettre en avant leur personnalité et leur intellect, qui sont actuellement dans l’ombre des sourires de façade et des défilés.
Conclusion
L’organisation actuelle du concours véhicule des mœurs d’un ancien temps. Les critères purement subjectifs sont vendus comme un idéal absolu et excluent toute autre forme de beauté que celle revendiquée par l’institution Miss France. Il faudrait ouvrir les horizons du concours en diversifiant les profils, pour qu’il soit plus représentatif des beautés diverses de nos Françaises.
De surcroît, les Miss sont présentées comme des objets de fantasme voués corps et âme aux téléspectateurs. Leurs corps sont parfaits, mais éloignés de la réalité : la cellulite, les rondeurs ou les vergetures sont absentes des photos et des défilés, alors même qu’elles sont présente sur l’immense majorité des peaux, femmes et hommes confondus.
Le fonctionnement actuel du concours est un frein à la progression des mentalités, dans ce monde encore patriarcal et binaire. Le public de Miss France représente d’ailleurs à perfection le problème du concours et des modes de pensées sur lesquels il repose : deux Miss Provence en ont particulièrement fait les frais. Julia Courtès avait d’abord été insultée et haïe en 2015, pour la seule raison d’avoir une forte poitrine. Cette année, c’est April Benayoum qui a été lynchée sur les réseaux sociaux du fait d’être juive, de se maquiller et d’avoir des origines étrangères. Le public de Miss France est divisé en deux : ceux qui ferment les yeux sur le problème et ceux qui ont l’hypocrisie et la lâcheté de haïr des femmes qu’ils / elles n’auront ou n’égaleront jamais.
Le concours Miss France serait donc à réformer drastiquement, si ce n’est à supprimer, car il entretient des discriminations et des modes de pensées dangereux qui tirent notre société vers le bas. Les candidates ne sont absolument pas les personnes à blâmer : vouloir se sentir belle n’est pas un crime, encore moins lorsque la société nous met constamment en compétition avec les autres femmes. En revanche, les organisateurs de ce concours devraient avoir honte de mettre encore en avant des critères aussi archaïques à la télévision.
Par Iris Devillière



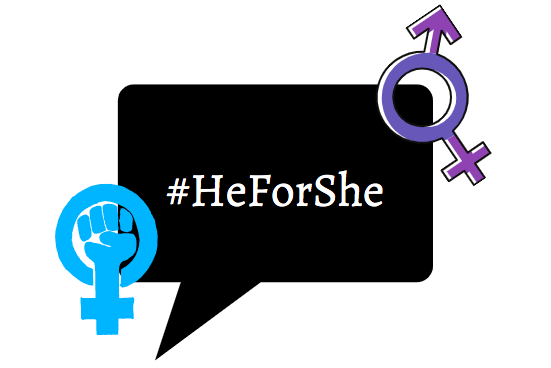

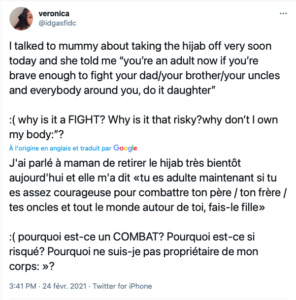


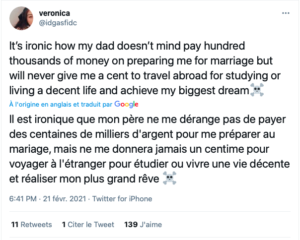



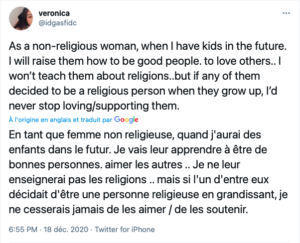


Commentaires récents