
par thinktank | 14 décembre 2017 | TBS Press, Think Tank Averroes
Table des matières
1) L’apport académique des écoles de commerce : un constat navrant
A) 1er paradoxe : Comment des élèves à la fois bons et studieux deviennent-ils aussi indolents ?
B) 2e paradoxe : Comment des profs Bac+9 enseignent des cours de niveau collège à des étudiants Bac+3/5 pourtant « salués » pour leurs performances académiques
C) 3e paradoxe : Ordinateurs, PDF, Powerpoint et autres merveilles modernes au service de la décadence de l’esprit, ou comment les progrès technologiques modernes nous ont fait régresser dans l’apprentissage.
2) A qui la faute ? Des raisons fausses ou partielles :
3) Rappel sur les particularités de l’enseignement en école de commerce et leurs quelques réussites
4) Une ébauche de solution
A) Les fausses croyances dont il faut se débarrasser
B) De la bonne utilisation des nouvelles technologies
C) Revenir aux classiques 9
D) Arrêter avec la manie de mettre des professeurs étrangers et des cours en anglais partout
E) L’enseignement des soft skills, une belle réussite
F) De l’importance de la notation dans le processus d’apprentissage : augmenter l’exigence et la régularité des examens
G) Structurer de manière plus pragmatique les emplois du temps :
5) Résumé et programme
A) Rappel
B) Le programme :
C) Réponse à 2 critiques : l’infantilisation des étudiants et le manque d’accompagnement dans l’apprentissage
Conclusion :
4) Une ébauche de solution
On a précédemment fixé 4 objectifs d’apprentissage à l’école de commerce :
- des connaissances et des savoir-faire, première porte d’entrée dans le monde du travail
- une capacité à se former soi-même constamment et efficacement
- la capacité à partir de connaissances pour créer de la richesse
- un certain savoir-être (les soft skills)
Comme on l’a dit, les écoles de commerce se débrouillent remarquablement bien (en comparaison avec la fac notamment) pour nous transmettre la capacité à partir de connaissances pour créer de la richesse ainsi que pour la transmission d’un certain savoir être bénéfique sur les relations de travail et le réseau mais aussi et surtout sur la « capacité d’action » qu’elle donne à ses étudiants.
Les difficultés des écoles de commerce se situent surtout sur la transmission de réels savoirs et savoir-faire ainsi que sur la transmission d’une réelle capacité à « apprendre à apprendre » c’est-à-dire à s’adapter constamment aux nouveaux savoirs et savoir-faire nécessaires en entreprise.
Il s’agit donc de proposer des solutions permettant d’améliorer les points 1 et 2 sans nuire à la transmission des points 3 et 4. Autrement dit un retour aux méthodes et à la quantité de travail en prépa n’aurait aucun sens. Mais il est à fait possible de combiner un apprentissage poussé des savoirs et savoir-faire nécessaires en entreprise au développement des soft-skills et à la « mise en action » des étudiants. Cela commence par une définition claire des savoirs et savoir-faire à acquérir.
A) Les fausses croyances dont il faut se débarrasser
Ayant défini les savoirs et savoir-faire à maîtriser (voir page 16) il s’agit maintenant d’aller à l’encontre de quelques fausse croyances (de l’administration mais aussi des étudiants) qui polluent l’apprentissage en école de commerce
1/ Après 2 ans de prépa les étudiants n’ont ni l’envie ni la capacité de travailler longtemps et avec intensité afin de maitriser les disciplines enseignées en école de commerce.
Comme on l’a expliqué précédemment ceci est faux. Il est certain que sans motivation intellectuelle (apprentissage approfondie des disciplines) ou pratique (exigence au niveau de la notation) les étudiants ne travailleront pas. Mettez de la profondeur aux cours ainsi qu’un niveau d’exigence supérieur et les étudiants, par volonté ou plus probablement par nécessité, se remettront très vite à cravacher.
2/ Si on relève le niveau d’exigence aux examens le nombre de rattrapages et de redoublements explosera, les étudiants se rebifferont et l’image de l’école pâtira.
Ayons un minimum foi en ces étudiants qui, sans être toujours brillants, ont été suffisamment scolaires pour avoir en moyenne 16 au bac et réussir le concours de TBS. Autrement dit augmentez la difficulté en prévenant les étudiants et en leur donnant accès à des examens type et ils travailleront suffisamment pour avoir la moyenne.
3/ Il y a proportionnalité entre le nombre d’heures de cours et la quantité des connaissances transmises.
C’est une absurdité. Il n’est nul besoin de longues démonstrations pour affirmer sans risque d’erreur qu’un étudiant sera plus efficace en travaillant seul à fond 2h à la bibliothèque qu’en étant sur [OFFICIEL] Admis 2017 Toulouse Business School 8 heures durant en cours de compta à essayer de gratter tous les shotguns possibles lors des campagnes.
Ce qui compte ce n’est pas l’importance des moyens mis en œuvre mais le résultat obtenu.
Pourquoi payer une fortune des profs à donner des cours extrêmement basiques à des étudiants ayant la gueule de bois et traînant tout le cours durant sur facebook alors qu’en donnant un bouquin de référence à chaque étudiant et en mettant un examen de début de semestre suffisamment exigeant on obtient les mêmes résultats ?
Rappelons que nous avons ici non pas des collégiens mais des BAC+3 qui ont a priori les capacités minimums requises pour apprendre par eux-mêmes à travers des bouquins de référence et qui n’ont pas besoin d’être pris par la main par un prof.
4/ On attend d’une école de commerce qu’elle fournisse un large ensemble de cours donnés par des professeurs reconnus.
C’est ARCHI FAUX. Ce n’est pas l’effort ni les moyens investis qui comptent, c’est le résultat. Comme dans n’importe quelle entreprise ou n’importe quel sport. Les écoles de commerce ne sélectionnent pas leurs étudiants en fonction de l’effort fourni en prépa mais bien en fonction du niveau atteint aux concours.
De même, ce qui compte réellement n’est pas le nombre d’heures de cours ou de projets que l’étudiant aura réalisé en école de commerce mais bien son niveau et son employabilité à la fin de son cursus en école.
En conséquence si au lieu de 20h de cours l’étudiant atteint le même niveau en 5h de travail personnel avec un ouvrage de référence et un exam à la fin (pour la motivation…) alors il n’y a aucune raison d’organiser ces 20 heures de cours, il suffit simplement de fournir un ouvrage de référence à l’étudiant et de le motiver correctement à travers un examen relevé.
B) De la bonne utilisation des nouvelles technologies
Comme on l’a dit la prise de note par ordinateur ainsi que l’utilisation de powerpoint en tant que support de cours est d’une extrême absurdité. Pour autant les nouvelles technologies peuvent à la fois grandement améliorer l’apprentissage des étudiants et réduire les coûts pour les écoles de commerce. Comment ?
Comme dit précédemment il y a un certain nombre de compétences techniques que les étudiants se doivent de maîtriser tels que Excel, Microsoft Word, Powerpoint, Photoshop, VBA mais aussi la comptabilité, quelques indicateurs financiers clés, les processus RH les plus importants, les règles de droits de base en RH ou création d’entreprise etc.
Quelle sont les points communs de toutes ces compétences ?
- Ce sont des compétences fermées dans le sens où l’ensemble des connaissances et des processus à maîtriser est limité, il n’y a pas de subjectivité et d’analyse à avoir mais seulement des situations de type Vrai/Faux, il n’y a pas de place à l’imagination et la créativité puisque qu’il s’agit simplement de reproduire une connaissance/un processus inventé par d’autres
- Pour acquérir ces compétences il ne faut pas être doté d’une grande intelligence, il faut par contre s’entrainer et répéter énormément afin de mémoriser et de reproduire avec exactitude le résultat demandé
En conséquence de ces deux points, un cours totalement identique, qui permette en plus aux étudiants d’aller à leur rythme est ici l’idéal.
Pas besoin d’enseignants, il suffit simplement aux écoles de fournir des cours en ligne à leurs étudiants sur le modèle des MOOCS (formation en ligne ouverte à tous), avec à la fin une certification pour le CV et un examen ardu afin de s’assurer du sérieux des étudiants.
On aurait ainsi des cours en lignes en Excel, Microsoft Word, VBA, photoshop, compta, calcul de coûts, montage vidéo etc.
Les avantages sont nombreux :
- L’économie du salaire des professeurs et leur reconnaissance pour ne pas leur avoir infligé un énième cours extrêmement basique et ennuyeux à donner.
- La possibilité pour les étudiants de se former à leur rythme, en évitant d’avoir dans le même cours 2 types d’étudiants qui perdent leur temps : l’expert connaissant déjà tout et le galérien totalement à la ramasse.
- La capacité pour les étudiants de savoir exactement quelles sont les connaissances à maîtriser et où ils en sont (le suivi personnalisé en beaucoup plus facile dans un cours en ligne que dans un cours traditionnel !!!)
Ces cours en ligne peuvent en réalité s’appliquer même aux disciplines nécessitant une vraie réflexion et créativité. En effet dans toute discipline il y a une part de connaissances fondamentales à maîtriser parfaitement avant de pouvoir réellement rentrer dans l’analyse, la créativité, l’interprétation, l’approfondissement etc. C’est cette base qui doit s’acquérir par les cours en ligne afin de libérer le professeur de cette tâche ingrate, de s’assurer d’un niveau homogène des étudiants en début de cours, et de permettre au professeur de se concentrer sur sa plus-value, c’est-à-dire sur l’enseignement qui ne peut être externalisé par la machine.
Ainsi :
- L’ensemble des définitions, connaissances et processus de base à maîtriser ainsi que l’assurance de leur maîtrise (à travers QCM) doivent passer par les moocs.
- Les cas pratiques et la mise en relation/perspective de ces connaissances peuvent se faire avec le professeur.
C) Revenir aux classiques
Il s’agit simplement de retrouver les bonnes formules d’antan qui garantissent l’efficacité dans l’apprentissage. Autrement dit
- Pas d’ordinateurs en cours sauf lorsque c’est indispensable (cours sur excel par exemple) et prise de note manuelle.
- Pas de powerpoints immondes mais au contraire des lectures de références ainsi qu’un professeur qui donne son cours de manière orale et structurée en insistant plus sur les raisonnements que sur les formules toutes faites.
- La répétition, encore et toujours, qui, couplée mais non remplacée par la compréhension, est le seul moyen d’apprendre.
D) Arrêter avec la manie de mettre des professeurs étrangers et des cours en anglais partout
Il s’agit de différencier ici 2 cas :
- Le cas où l’enseignement est pratique et ne demande aucune analyse fine. Ici, que le cours soit en anglais, en Allemand ou en turc importe peu puisqu’il n’y a finalement rien de très compliqué ni subtile à comprendre. Il faut cependant avoir un professeur maîtrisant un minimum la langue. Je me souviens à cet égard de ce professeur de comptabilité d’origine italienne qui parlait couramment l’espagnol et l’italien, un peu le Français mais dont l’Anglais été terriblement mauvais. Nous eûmes ainsi la chance d’avoir un cours de comptabilité dans une langue totalement saugrenue, mélange d’Italien, d’Espagnol, de Français avec de temps en temps quelques sonorités anglaises, langue seulement connue de lui dont nous ne comprenions rien. La conséquence fut que tout le monde échoua aux examens et que l’administration remonta les notes de chacun de 5 points. Lorsque l’on sait qu’il faut avoir 8 pour valider cela montre l’étendue des connaissances à avoir pour valider…
- Le cas où l’enseignement nécessite de comprendre des subtilités qui ne peuvent être énoncées et comprises qu’à partir d’une langue maternelle bien maîtrisée. Alors l’usage de l’Anglais est ici désastreux car sa maîtrise souvent moyenne oblige à une utilisation hasardeuse et imprécise des mots chez le professeur et limite la compréhension des étudiants eux-mêmes limités par leur niveau en anglais.
En bref, utilisons l’anglais pour communiquer et apprendre/transmettre des connaissances basiques et répétitives, mais gardons le Français pour tout le reste.
E) L’enseignement des soft skills, une belle réussite
On ne cesse de nous répéter que toutes les compétences techniques que nous acquérons maintenant seront obsolètes dans 20 ans alors que les soft skills (communication, qualités interpersonnelles et intrapersonnelles, leadership, capacité d’adaptation etc.) resteront toute notre vie et feront la différence dans notre carrière. Ce serait en conséquence ce qui devrait nous être enseigné en priorité en école de commerce. Ce n’est que partiellement vrai.
D’une part une petite partie seulement des hardskills que nous apprenons vont réellement devenir obsolètes (notamment ceux directement liés à la technologie à l’exemple d’un langage informatique), pour le reste le risque est surtout de ne les utiliser que pour notre premier emploi et de ne pas en avoir besoin ensuite.
D’autre part de nombreux hardskills sont « transversaux » et nous servirons plus ou moins directement dans l’ensemble des métiers que nous exercerons. C’est le cas de disciplines comme la finance, le contrôle de gestion, le marketing qui nous permettront d’avoir une vue globale de l’entreprise dans laquelle nous seront et de prendre des décisions optimales dans le département où nous travaillerons, mais aussi de compétences comme word/excel/powerpoint que tout le monde se doit de maîtriser qu’importe le métier exercé.
Mais passons et reconnaissons l’impact que peuvent avec les soft skills dans nos carrières. L’école de commerce insistant à ce point là-dessus on doit légitimement s’attendre à recevoir un enseignement de qualité dans ce domaine. C’est plutôt le cas.
Différencions 2 choses, l’enseignement théorique de la mise en pratique. Dans les deux cas il faut reconnaître quelques qualités à TBS.
Au niveau de l’enseignement théorique :
Nous avons des cours s’intéressant tant aux comportements de groupes (Cours de L3 intitulé Comportement et organisation) qu’aux comportements individuels, que ce soit les nôtres ou ceux des autres (Cours de M2 intitulé « How to convince » et cours de L3 « Sales and négociation »). A cela s’ajoute le Bilan personnel censé nous permettre de faire une introspection afin de mieux nous orienter et de connaître nos forces et faiblesses, ou du moins nos zones de confort et d’inconfort.
Au niveau de la mise en pratique :
Dans chacun de ces cours, des exercices de mise en pratique sont réalisés avec les feedbacks du professeur. De plus les nombreux projets de groupe et projets associatifs sont autant de moments où nous sommes dans l’obligation, plus ou moins consciemment et avec plus ou moins de réussite, d’utiliser nos soft skills.
Indubitablement, c’est la grande différence entre la fac et les écoles de commerce et c’est selon moi une des plus grandes valeurs ajoutées des écoles de commerce.
Le seul reproche que l’on pourrait émettre serait que les enseignements sur les soft skills soient trop superficiels et que les mises en pratique à réelle valeur ajoutée (c’est-à-dire les mises en pratique volontaires et avec la possibilité d’un avis externe et d’une certaine réflexivité) soient insuffisantes.
Ceci est vrai, cependant la réelle maîtrise tant théorique que pratique nécessite des années d’études et de pratique, ce qui n’est pas l’objectif d’une école de commerce. De plus et à l’image du sport, il faut reconnaître que les compétences interpersonnelles (relation avec les autres) et intrapersonnelles (connaissance de soi, capacité à obtenir le meilleur de soi) peuvent s’apprendre mais sont en grande partie innées. J’entends par inné le fait que la plus grande partie de ces compétences s’acquiert inconsciemment et involontairement lors de la petite enfance (par le développement de sa personnalité mais aussi par la socialisation primaire dépendante du milieu dans lequel on évolue). De plus, il y a selon moi assez peu de corrélation entre la connaissance théorique et la maîtrise pratique. C’est l’histoire du psychologue conjugal empêtré dans un divorce destructeur avec sa femme ou de cet ami que l’on a tous qui n’a aucune connaissance s’approchant de près ou de loin à la psychologie, la sociologie et autres, mais qui semble toujours être en pleine maîtrise de ses moyens et sait se faire apprécier par tous en toute occasion.
F) De l’importance de la notation dans le processus d’apprentissage : augmenter l’exigence et la régularité des examens
C’est probablement le passage le plus important de tout l’article.
Le rôle classant des examens est connu de tous. L’examen permet aux écoles comme aux entreprises de sélectionner leurs étudiants et travailleurs avec l’assurance qu’ils maîtrisent un certain nombre de compétences.
Mais l’importance de l’examen dans le processus d’apprentissage est souvent sous-estimée. L’examen joue pourtant un rôle fondamental car il permet :
- De définir les standards que doivent atteindre les étudiants et de leur permettre de voir ce qu’ils maîtrisent et ce qu’ils doivent encore travailler (ce deuxième point dépend de la qualité du système de notation utilisé).
- De « forcer » les étudiants à travailler afin de réussir les examens. La régularité du travail des étudiants est donc corrélée à la régularité des examens. Un étudiant de prépa révisera tous les jours dans l’optique du DS de la semaine alors qu’un étudiant à la fac ou en école de commerce flânera 3 mois et bossera 1 semaine avant les examens.
Or en école de commerce les examens ne sont absolument pas utilisés de manière à améliorer le processus d’apprentissage des étudiants. En effet :
- Le niveau requis est minable et les étudiants n’ont point besoin de maîtriser les disciplines étudiées pour réussir les examens. Je me souviens à cet égard de cet étudiant en Master 1 qui n’assista à AUCUN cours en « Business Plan » et en « Information et décision » ni même ne les étudia par lui-même. Pas une seule fois. Le matin de l’épreuve, à 5h30 plus précisément, il avisa qu’il serait peut-être temps de s’y mettre. Il découvrit donc ces deux matières 3 heures avant les examens, les survola 2 heures durant, et eut 13 en information et décision 16,5 en Business Plan. Ce jeune homme n’étant point un génie, force est de reconnaître le manque criant d’exigence de l’école. Ce même étudiant, faisant preuve d’une désinvolture confinant à l’effronterie, eut même le culot de passer l’examen d’information financière (matière supposément technique) en n’ayant ni assisté au moindre cours, ni même ouvert le moindre PDF. C’est-à-dire en ayant littéralement zéro connaissance. Il obtînt 8. Résultat certes assez minable mais cependant suffisant pour valider la matière.
- Une fois les matières validées, la maîtrise de celles-ci n’est plus jamais exigée (à travers un examen). Or, afin de réellement ancrer une information dans la mémoire de long terme il est nécessaire de passer par une phase de répétition espacée dans le temps. Le manque d’exigence des examens et leur caractère unique pousse les étudiants à s’y mettre la veille. Il en découle qu’ils auront tout oublié le lendemain. Il faudrait en vérité avoir plusieurs examens intermédiaires ainsi qu’un examen final à la fin du tronc commun (en fin de M1) comprenant l’ensemble des disciplines étudiées afin de maximiser le nombre de répétitions espacées et donc la mémorisation.
- Les examens intermédiaires (quand il y en a) arrivent après une bonne partie des cours alors qu’ils devraient arriver avant, et ceci pour une raison évidente : les étudiants n’écouteront rien en cours avant les exams, ce qui est une perte de temps, mais au-delà, le professeur perdra lui-même son temps à enseigner des connaissances basiques alors que la lecture d’un livre de référence aurait suffi (on parle d’étudiants Bac+3, pas de collégiens, ayons foi en leur capacité à apprendre par eux-mêmes dans un livre). Un examen AVANT les premiers cours sur la maîtrise de connaissances clairement identifiées, qui nécessitent un apprentissage conséquent mais finalement peu compliqué, permettrait aux étudiants d’arriver en maîtrisant les bases et au professeur d’apporter sa réelle plus-value. Ce serait un gain tant pour les étudiants que pour l’école.
G) Structurer de manière plus pragmatique les emplois du temps :
Autant parler franchement, il existe certaines périodes de la scolarité où la productivité des étudiants est nulle : Intégration, lendemain d’OB, de WEI, de semineige, et surtout les campagnes.
Rappelons 3 évidences :
- Un cerveau en manque chronique de sommeil et encore à moitié alcoolisé est incapable d’apprendre.
- Les étudiants sont presque systématiquement en manque chronique de sommeil et à moitié alcoolisés lors des périodes précitées.
- Les politiques répressives ne fonctionnent pas. Trop nombreux sont les étudiants qui n’en ont simplement plus rien à faire de leurs absences. Pour les autres et comme dit précédemment leur productivité approche le néant.
En conséquence il s’agit d’être pragmatique, de bien différencier ces deux types de périodes (apprentissage studieux et vie associative/étudiante), de les séparer dans le calendrier et d’en augmenter l’intensité.
5) Résumé et programme
A) Rappel
De nombreux points ont été abordés, je me permettrai de rappeler ici les plus importants
- Comme nous le savons tous, la réelle valeur ajoutée des écoles de commerce ne se situe pas dans les cours académiques qu’elles dispensent mais dans la valeur de leur diplôme, le réseau qu’elles permettent d’acquérir ainsi que dans leur capacité à transmettre un ensemble de soft skills propice à la l’élargissement du champ d’action de leurs étudiants ainsi qu’à leur réussite professionnelle.
L’enseignement académique, s’il ne fait pas partie des « Facteurs clé de succès » principaux des écoles de commerce reste cependant important. Dans certains secteurs (en banque et en M&A notamment) les entretiens de stage (et on sait l’importance des premiers stages dans ce secteur) sélectionnent en grande partie sur les compétences techniques. Plus généralement on peut dire que si les « soft skills » font souvent la différence, les « hard skills » n’en restent pas moins indispensables. Car certains métiers requièrent des connaissances très précises (en audit par exemple) mais aussi car l’ensemble des métiers (ceci est particulièrement vrai pour les entrepreneurs) requièrent d’avoir un vernis technique sur l’ensemble des disciplines de gestion qui soit suffisamment poussé pour que l’on puisse prendre des décisions optimales pour l’ensemble d’une société et pas seulement pour l’un de ses départements. Finalement on pourrait légitimement demander un enseignement de qualité pour lui-même.
Or la grande tare de l’école de commerce est justement académique, elle réside dans son incapacité à transmettre de réelles connaissances à ses étudiants, connaissances dont on a montré l’importance en entreprise.
- Cet échec réside d’abord dans la croyance en un certain nombre d’idées fausses :
- Après 2 ans de prépa les étudiants n’ont ni l’envie ni la capacité de travailler longtemps et avec intensité afin de maîtriser les disciplines enseignées en école de commerce
- Si on relève le niveau d’exigence aux examens, le nombre de rattrapages et de redoublements explosera, les étudiants se rebifferont et l’image de l’école en sera affectée.
- Il y a proportionnalité entre le nombre d’heures de cours et la quantité des connaissances transmises.
- On attend d’une école de commerce qu’elle fournisse un large ensemble de cours donnés par des professeurs reconnus.
- L’apprentissage doit aujourd’hui se faire de manière digitale, avec cette merveille de la modernité qu’est l’ordinateur
- Les conséquences de ces idées fausses sont tragiques :
- Une absence absolue d’exigence aux examens.
- Des cours extrêmement superficiels et un niveau atteint par les étudiants qui, par rapport au nombre d’heures de cours dispensées, est lui-même extrêmement bas.
- Un désintérêt total de la part des étudiants.
- Il s’agit donc de se remettre dans le droit chemin en rappelant quelques vérités :
- 2 ans de prépa ne justifient ni n’explique une telle inertie des étudiants. Ceux-ci, par curiosité intellectuelle ou plus probablement par nécessité pratique n’auront aucun mal à se remettre au travail.
- Une grande partie des étudiants en école ont fait prépa et ont eu à atteindre un niveau d’exigence autrement plus élevé. Quelque fois brillants, du moins bons élèves, il est peu probable qu’ils ne s’alignent pas sur de nouvelles exigences plus élevées.
- Ce serait une erreur d’attendre de l’école un certain nombre d’heures de cours. Ce qui compte c’est le résultat, c’est-à-dire le niveau des étudiants et leur valeur sur le marché du travail à la sortie. Rien d’autre.
- C’est la science et la vérification empirique qui doivent nous indiquer dans quelle mesure les outils informatiques d’aujourd’hui peuvent améliorer l’apprentissage des étudiants. Une utilisation systématique de l’ordinateur en cours est à cet égard totalement absurde.
B) Le programme :
Réaffirmons l’objectif de ce programme. Il ne s’agit pas de revenir à un apprentissage académique comme en prépa. Les écoles forment de futurs managers, non des universitaires. Il s’agit par contre, tout en préservant les avantages compétitifs des écoles (mise en action des étudiants à travers la vie associative et les différents projets de groupe, développement des soft skills, vie étudiante forte et réseau etc), d’élever les compétences théoriques (disciplines de gestion) et pratiques (excel, VBA, photoshop…) de leurs étudiants.
De l’importance des mentalités.
Nous ne reviendrons pas sur l’importance de la mentalité sur la performance tant celle-ci est évidente, en sport comme dans les études. Nous dirons simplement ici qu’il s’agit d’aller à l’encontre des fausses croyances citées plus haut pour en affirmer des nouvelles plus propices à l’apprentissage efficace des étudiants. Il faut notamment arrêter de dire que les étudiants sont épuisés après la prépa et incapable de se remettre au boulot, ainsi que de répéter que les connaissances théoriques et compétences pratiques en école ne comptent pas vraiment puisque seuls comptent les stages et les soft skills. Si celles-ci sont loin d’être suffisantes elles n’en restent pas moins indispensables.
Rappelons aussi une vérité fondamentale : ce n’est pas la manière qui compte, c’est le résultat. Si imiter un pingouin pendant 3 ans au lieu d’aller en cours nous rendrait meilleurs alors il faudrait en toute logique imiter un pingouin pendant 3 ans. En conséquence les cours n’ont rien de nécessaire en soi. Ce qui compte réellement c’est l’ensemble des compétences acquises lors du passage en école de commerce. Si les cours ont une réelle valeur ajoutée alors ils se justifient, dans le cas contraire ils doivent disparaître.
Rappelons aussi le profil des étudiants d’école ainsi que les conséquences d’internet sur l’apprentissage.
Les étudiants, en majorité d’anciens préparationnaires, ont déjà plus ou moins acquis une certaine capacité de travail à haute intensité. Ils sont devenus « les maîtres du temps » selon Muriel Darmon. Ils ont les capacités de compréhension et d’endurance nécessaires pour travailler vite et dans l’urgence, ils savent, face à un empilement important d’informations, hiérarchiser les connaissances fondamentales de celles qui sont superflues. Par-dessus tout ils savent travailler par eux-mêmes. S’ils n’ont pas toutes ces qualités, alors qu’ils se pressent de les acquérir en école, car elles seront primordiales en entreprise.
Par conséquent les cours magistraux, qui n’ont de magistraux que leur appellation, sont particulièrement contre-productifs puisqu’ils imposent un rythme d’apprentissage bien plus lent que le rythme potentiel des étudiants et que l’utilisation massive des powerpoints empêche tout effort de synthèse, et donc de compréhension des étudiants (voir la partie sur l’aberration des powerpoints). Par-dessus le marché, leur superficialité ainsi que l’absence absolue d’exigence aux examens empêchent d’arriver à cette situation d’urgence et de grande productivité dans l’apprentissage qu’ont pu expérimenter les étudiants en prépa. Cette qualité est pourtant fondamentale dans le monde professionnel.
Pour finir internet a profondément modifié la transmission de connaissances. Les professeurs n’ont plus aucune utilité en tant que transmetteurs de connaissances pures puisque ces connaissances sont disponibles partout à profusion. Leur valeur ajoutée réside dans leur capacité à mettre en lien ces connaissances, à leur donner du sens et à transmettre aux étudiants cette capacité à trouver l’information et à lui donner du sens, voir pour les meilleurs, de transmettre aux étudiants ce talent rare qui consiste non pas à donner du sens à une information à travers un processus de compréhension lui-même appris (Ex : le PESTEL), mais la capacité à développer directement ses propres outils conceptuels, ses propres grilles de lectures lorsqu’il est confronté à une situation dans laquelle les grilles de lecture habituelles ne sont pas adaptées. Là encore le cours magistral est désavoué.
Or s’il y a bien de nombreux cas pratiques en cours en école de commerce, on constate que les cours magistraux (qui ne sont souvent qu’une lecture plus ou moins approfondie du powerpoint) sont bien trop nombreux, que les étudiants perdent leur temps sur facebook, puis, la veille des partiels, qu’ils apprennent en quelques heures 3 semaines de cours. Quelle perte de temps pour les deux partis !
Quelles sont les connaissances/compétences à maîtriser au sortir d’une école de commerce ?
Il s’agit ici d’évaluer l’ensemble des connaissances et savoir-faire nécessaires à la fois pour s’intégrer au mieux dans le marché du travail mais aussi tout au long de notre vie professionnelle. On nous dit aujourd’hui qu’avec les progrès technologiques constants et leurs conséquences sur le marché du travail toutes les compétences techniques que nous apprenons dans le moment présent sont amenées à disparaître, et qu’en conséquence il nous faut surtout investir sur notre « savoir-être », no soft skills qui feraient de plus la différence dans l’accès aux postes de direction. C’est bien évidemment totalement faux. Oui, les soft skills font souvent la différence dans les postes de direction, parce que tous les candidats maîtrisent déjà les hard skills. Les compétences techniques, si elles sont insuffisantes n’en restent pas moins indispensables. De plus lorsque l’on parle d’obsolescence programmée des connaissances/compétences il faut différencier :
- Les compétences non liées à la technologie et durables de celles amenées à disparaître: en finance, en contrôle de gestion, en droit (les grands principes ne changent pas) ou encore en technique de vente des évolutions auxquelles il faudra s’adapter apparaîtront mais le cœur de ces disciplines restera le même. En langage C+ rien n’est moins sûr. On voit ici que compétences des ingénieurs sont beaucoup plus à risques que les nôtres.
- Les compétences spécifiques à un corps de métier qui nous seront inutiles lorsque nous quitterons notre emploi de celles qui nous serviront dans l’ensemble de notre carrière. C’est ici très simple, plus on rentre dans les détails et dans la complexité d’une discipline, plus le risque est grand de ne plus en avoir besoin plus tard. Cependant il est absolument nécessaire d’avoir un vernis de connaissance dans l’ensemble des disciplines de gestion afin que l’on puisse, dans n’importe quel département d’une entreprise (ou lors de la création de la nôtre), prendre des décisions qui soient optimales pour l’ensemble de l’entreprise et pas seulement pour notre département. Cela nous donne au demeurant une rapidité d’adaptation et de compréhension beaucoup plus grande et absolument nécessaire pour monter les échelons. C’est, je pense, pour cette raison que le choix a été fait par TBS d’aborder l’ensemble des disciplines de gestion en L3 et lors du 1er semestre de M1. L’idée est bonne, mais les cours et les exigences sont tellement navrantes que le résultat n’est pas atteint. Nous recevons un vernis de connaissances qui se transforme en nano-couche alors qu’il faudrait avoir un enseignement poussé nous permettant, après l’œuvre du temps, d’avoir encore ce vernis de connaissance.
Une fois ces distinctions faites, nous pouvons maintenant définir les connaissances et compétences à maîtriser au sortir de l’école de commerce :
- L’ensemble des disciplines de gestion. L’objectif est ici moins de maîtriser à la perfection l’ensemble des connaissances et processus que d’en comprendre la logique et, le moment venu, de pouvoir réapprendre très rapidement les connaissances dont nous aurions besoin. Or pour maîtriser 10 il faut apprendre 100. Il est donc mieux d’apprendre pour chaque matière un nombre limité de concepts et de processus mais les maîtriser à fond que d’en avoir un vague exposé oublié le lendemain.
- Les compétences et savoir-faire pratiques nécessaires tout au long de notre carrière. En exagérant un brin, tout étudiant devrait ressortir de TBS en sachant faire les powerpoints et words d’escadrille, les templates excel de la JIM et les vidéos
- Des compétences spécifiques aux métiers dans lesquels nous voulons commencer notre carrière
- Les soft-skills
Ces compétences définies, à quoi devrait concrètement ressembler l’apprentissage en école de commerce ? Il s’agit :
- D’exposer en détail dans un document qui devra être la ligne directrice à la fois des étudiants et du corps enseignant, l’ensemble des connaissances et compétences communes qui devront être acquises au sortir de l’école.
- De supprimer l’ensemble des cours théorique et procéder de la manière suivante :
- Un cours introductif au démarrage d’un nouvel ensemble de cours permettant d’orienter l’étudiant dans son apprentissage.
- Puis 2 à 3 semaines maximum afin de permettre à l’étudiant, à travers la lecture d’ouvrages de références, de se former.
- Un nouveau cours fait seulement de questions/réponses.
- Un examen théorique exigeant quelques jours après.
- Suite à cet examen, le reste ne devrait être que cas pratiques, enquêtes de terrains et serious games afin de transformer ces savoirs théoriques en compétences pratiques.
- D’avoir en fin de Master 1 un grand examen théorique reprenant l’ensemble des disciplines étudiées lors des 2 premières années. La mémoire fonctionnant par répétition, cet examen a pour seul objectif d’ancrer fermement les connaissances étudiées lors des deux dernières années.
- De revenir à la prise de note papier et de mettre en place des MOOCS pour l’ensemble des disciplines où une partie du savoir nécessite beaucoup de réflexion technique et mécanique et peu de réflexion réellement difficile et créative (toutes les parties calculatoires en comptabilité, contrôle de gestion et finance par exemple, mais aussi pour l’ensemble des modules de Microsoft Office, Photoshop etc).
- D’avoir de très nombreux tests et examens ayant un certain degré d’exigence. Je le rappelle ce qui compte ce n’est pas le nombre d’heure ni la qualité de l’apprentissage mais bien le résultat. L’intérêt principal d’un examen, au-delà de la mise au travail qu’il produit, réside dans le fait qu’il indique à l’étudiant à la fois le niveau à atteindre et le niveau qu’il a actuellement. Pour que ces examens soient réellement bénéfiques il faut que les annales soient à la fois disponibles et détaillées, qu’elles soient le premier outil d’apprentissage des étudiants. Ce n’est pas en relisant le cours mais bien en faisant et refaisant les exercices Ecricome et EMLyon que l’on bossait les maths en prépa, c’est le même raisonnement ici.
- D’avoir une claire alternance entre les périodes de vie associative/festive et les périodes d’apprentissage. Inutile d’espérer quoi que ce soit de cerveaux éreintés par l’alcool et le manque de sommeil
C) Réponse à 2 critiques : l’infantilisation des étudiants et le manque d’accompagnement dans l’apprentissage
Deux reproches principaux pourraient émaner à la lecture de ce programme :
1er reproche : Les étudiants, dans leur apprentissage théorique, seraient livrés à eux-mêmes, ce qui nuirait à leur apprentissage.
On ne peut à la fois vouloir l’autonomisation des étudiants et choisir de les prendre par la main dans l’apprentissage. D’autre part le premier cours d’introduction, le cours de questions/réponses ainsi que les annales répondent parfaitement à la nécessité de guider les étudiants dans leur apprentissage. De plus l’autonomie est maximum lors des cas pratiques et serious games qui doivent constituer la majorité des cours. Finalement lorsqu’ils seront en entreprise ces futurs cadres devront se former par eux-mêmes, très souvent à partir d’ouvrages de référence et d’autres documentations. Autant qu’ils quittent l’école de commerce en sachant le faire.
2er reproche : Il y aurait du fait des nombreux tests et examens que l’on veut imposer à l’étudiant une contrainte ainsi qu’une infantilisation très forte exercée à son égard.
D’une part l’autonomie et la responsabilisation des étudiants doit se faire après lors de l’apprentissage pratique ( cas pratiques, serious games tels Artemis et Sesame, etc) qui je le rappelle doivent représenter la grande majorité des heures de cours.
D’autre part la contrainte est réelle, mais ce n’est pas une infantilisation. En effet deux vérités doivent ici être réaffirmées. D’une part la procrastination est humaine et touche tout le monde, de l’enfant au PDG d’une multinationale. Prétendre qu’arrivés en école de commerce les étudiants auraient définitivement réussi à s’en affranchir est un vœu pieux ainsi qu’un déni de réalité. La contrainte exercée par l’établissement est donc salutaire. D’autre part, la réelle liberté ne se réalise pas dans l’absence de contrainte qui n’est qu’asservissement à ses plus bas instincts, mais au contraire dans la détermination consciente des contraintes que l’on souhaite s’imposer. A cet égard, s’ils sont bien expliqués les nombreux tests et examens peuvent être considérés comme un choix volontaire et réfléchi d’étudiants sérieux voulant s’astreindre à un ensemble de contraintes fortes afin de réaliser leurs objectifs. Finalement, l’excellence ne s’obtient qu’à travers un travail acharné et rigoureux, et donc à travers une énorme autocontrainte, elle-même liberté comme choix de ses autocontraintes. Aussi je me permettrais de vous laisser ainsi ave cette magnifique citation d’Ernest Renan : « L’assiduité, le sérieux et l’application suppléent presqu’au génie et valent mille fois mieux que le talent »
Conclusion :
Et pour finir, sans autre justification nécessaire que la volonté d’échapper à une vie futile réduite à une affligeante quête de confort matériel, mettez-nous, de temps en temps, par-ci par-là, quelques cours et conférences déconnectés des nécessités financières et dont la seule raison d’être soit la quête du Beau, du Bien et du Vrai, qui, à défaut de toujours donner un sens profond à l’existence, lui donne une certaine valeur et en adoucit les contours.
Nam Delespierre
Retrouvez l’intégralité de l’article en format pdf à télécharger ici –> Du-meurtre-de-lintelligence-ou-de-lenseignement-en-école-de-commerce-article.pdf

par thinktank | 13 décembre 2017 | TBS Press, Think Tank Averroes
Navrante est la réalité académique des écoles de commerce et si l’envie ne manque pas de se répandre en un flot ininterrompu d’injures en tous genres face à ces établissements responsables de nos 30 000 euros d’endettement et 3 ans d’abêtissement, ce serait fort improductif et ne rendrait pas compte des qualités indéniables des écoles de commerce. Aussi me contenterais-je dans cet article de constater dans un premier temps la réalité académique navrante des écoles de commerce pour ensuite en montrer les causes et finalement proposer quelques esquisses de solutions.
Table des matières
1) L’apport académique des écoles de commerce : un constat navrant
A) 1er paradoxe : Comment des élèves à la fois bons et studieux deviennent-ils aussi indolents ?
B) 2e paradoxe : Comment des profs Bac+9 enseignent des cours de niveau collège à des étudiants Bac+3/5 pourtant « salués » pour leurs performances académiques
C) 3e paradoxe : Ordinateurs, PDF, Powerpoint et autres merveilles modernes au service de la décadence de l’esprit, ou comment les progrès technologiques modernes nous ont fait régresser dans l’apprentissage.
2) A qui la faute ? Des raisons fausses ou partielles :
3) Rappel sur les particularités de l’enseignement en école de commerce et leurs quelques réussites
4) Une ébauche de solution
A) Les fausses croyances dont il faut se débarrasser
B) De la bonne utilisation des nouvelles technologies
C) Revenir aux classiques 9
D) Arrêter avec la manie de mettre des professeurs étrangers et des cours en anglais partout
E) L’enseignement des soft skills, une belle réussite
F) De l’importance de la notation dans le processus d’apprentissage : augmenter l’exigence et la régularité des examens
G) Structurer de manière plus pragmatique les emplois du temps :
5) Résumé et programme
A) Rappel
B) Le programme :
C) Réponse à 2 critiques : l’infantilisation des étudiants et le manque d’accompagnement dans l’apprentissage
Conclusion :
1) L’apport académique des écoles de commerce : un constat navrant
A) 1er paradoxe : Comment des élèves à la fois bons et studieux deviennent-ils aussi indolents ?
Il n’est ici point besoin de prouver les conséquences de trois ans d’école de commerce sur l’intellect de ses étudiants tant ceux-ci sont bien connus des lecteurs de cet article :
Intérêt proche du néant pour les cours dispensés ; oubli de la grande majorité des connaissances acquises en prépa ; connaissances apprise en école extrêmement limitées (la plupart des connaissances réelles sont acquises en stage ou, à la rigueur, en asso) ; mémoire et agilité intellectuelle dont l’évolution est inversement proportionnelle à la rapidité d’ingurgitation d’un CU ; une capacité de concentration limitée au visionnage des GIFS de 9gag lors du cours de compta, et, pire que tout, une curiosité intellectuelle qui s’effrite et se réduit à un néant, ou plus précisément à savoir qui passera au JT du dernier OB (pardon, SAT).
Ce qui est surprenant ici est moins le constat que le fait que celui-ci s’applique à des élèves auparavant bons, studieux et habitués à disserter pendant 4 heures sur les apories telles que « Le crépuscule de la vérité ».
Rappelons que la moyenne au bac des étudiants de TBS est de 16, qu’elle est de plus de 18 à HEC, que ces étudiants ont passé 2 à 3 années à bûcher 8 à 10h par jour, qu’ils ont dû comprendre et mémoriser des choses autrement plus compliquées que l’analyse SWOT ou que le PESTEL.
C’est donc à la lumière de l’origine et du passé des étudiants d’école de commerce qu’il faut saluer à sa juste mesure le travail effectué par les écoles de commerce. Réduire à néant, parfois en quelque mois seulement, tout intérêt et capacité intellectuelle de ses étudiants autrefois sérieux et travailleurs relève de l’exploit !
B) 2e paradoxe : Comment des profs Bac+9 enseignent des cours de niveau collège à des étudiants Bac+3/5 pourtant « salués » pour leurs performances académiques
N’avons-nous pas tous eu droit à ce même discours élogieux de rentrée de classe où la directrice du programme Grande Ecole louait notre « excellence académique » ainsi que notre réussite dans un « concours exigeant et sélectif » nous permettant d’entrer à TBS ? Encore pourrait-on remettre en question le niveau académique des étudiants de TBS, mais le double phénomène de désintéressement des étudiants et de cours superficiels se retrouve dans toutes les écoles, et notamment à HEC ( https://www.contrecouranthec.fr/hec-apprendre-a-desapprendre/)
N’est-il pas non plus vrai que nous recevons des cours de professeurs qui ont tous un doctorat et sont des chercheurs reconnus pour leur expertise dans leur domaine ?
Réunissez de « bon étudiants » et des professeurs experts dans leur domaine et le résultat ne peut être qu’éclatant ! Et pourtant… Les professeurs et étudiants se trouvent dans une même misère faite de powerpoints dont les titres font office de cours et de PDF où la moitié des mots se retrouvent en gras. A force d’avoir des PDF qui ne sont que des résumés de résumés faits de mots clés soulignés, on se retrouve sans contenu, sans matière à réflexion et sans contexte. S’il faut lire 100 pour mémoriser 10, alors on se retrouve à lire 10 pour mémoriser 1. Et lorsque le cours n’est pas médiocre il paraît souvent totalement abscons et déconnecté de la réalité. Les cours d’économie en sont un bon exemple. Très mathématisés, ils peuvent (et encore le débat fait rage au sein même des enseignants en économie) servir à former des économistes sur le long terme, mais pour des étudiants d’école de commerce qui n’auront qu’un semestre de cours en économie les équations demandées paraissent bien trop théoriques par rapport à leurs besoins pratiques. A cet égard des conférences thématiques sur l’économie paraîtraient bien plus pertinentes.
Un cercle vicieux commence à s’instaurer : Les étudiants, face à des cours triviaux et une vie étudiante somme toute fort attrayante se désintéressent des cours, les professeurs se retrouvent face à des étudiants devenus mauvais et désintéressés et s’adaptent en réduisant encore leurs exigences, les cours devenant encore moins complexes et intéressants les étudiants s’en désintéressent d’autant plus et ainsi de suite.
On se retrouve alors avec des professeurs très qualifiés donnant des cours de niveau collège à des étudiants anciens préparationnaires.
C) 3e paradoxe : Ordinateurs, PDF, Powerpoint et autres merveilles modernes au service de la décadence de l’esprit, ou comment les progrès technologiques modernes nous ont fait régresser dans l’apprentissage.
Ne voyez point ici de jugements moralisateurs, idéologiques, rétrogrades diraient certains, sur les nouvelles technologies et l’utilisation qu’on en fait aujourd’hui. C’est la science elle-même qui montre les effets néfastes de ces nouvelles technologies sur notre intelligence et notre apprentissage.
De la supériorité de la prise de note écrite sur la prise de note par ordinateur
Dans une étude de 2014 intitulé « The Pen Is Mightier Than the Keyboard: Advantages of Longhand Over Laptop Note Taking » (trouvable sur google en PDF, voici ici un lien résumant l’article : http://beyondiq.blogspot.com.es/2016/03/the-pen-is-mightier-than-keyboard.html) les chercheurs comparent les performances d’étudiants prenant des notes sur ordinateur et à la main selon 2 critères : Des connaissances factuelles sur le sujet étudié et des connaissances conceptuelles qui témoignent de la compréhension du sujet étudié par l’étudiant.
Les résultats sont les mêmes concernant les connaissances factuelles, par contre les étudiants ayant pris des notes à la main montrent de bien meilleurs résultats concernant les connaissances conceptuelles. Une des raisons avancées est que les ordinateurs permettent une écriture beaucoup plus rapide et facilitent la simple recopie d’un cours alors que l’écriture à la main, plus lente, demande déjà un premier effort de synthétisation et donc d’appropriation des connaissances.
Autrement dit il est totalement aberrant de prendre des cours sur l’ordinateur.
Et encore, l’étude ne prend même pas en compte les distractions liées à internet qui sont de loin les plus dramatiques…
De l’aberration des powerpoints
On l’a dit précédemment c’est la nécessité de discriminer les informations importantes des informations non importantes dans la prise de note qui permet d’effectuer un processus d’appropriation et de compréhension de la connaissance. L’usage des powerpoints est alors doublement absurde :
⦁ D’une part les powerpoints sont déjà des résumés, ainsi le processus cognitif d’appropriation de la connaissance disparaît. De même qu’une formule mathématique n’a de sens que si l’on a compris la démonstration derrière, un résumé n’a de sens que si nous avons compris le texte initial qu’il résume. Or avoir de simple résumés powerpoints en cours équivaux à avoir une somme de formules qui peuvent être vraies mais n’ont aucun sens pour nous.
⦁ D’autre part on ne peut se limiter à l’apprentissage d’une somme de formules de cuisine. Au-delà des résultats ce sont les raisonnements entrepris qui sont la réelle source du savoir et dont on tirera la plus grande plus-value en entreprise. En n’ayant que des résumés on passe littéralement à côté du savoir dont nous avons besoin.
On le voit bien ici on ne peut faire l’économie de la lecture et du processus d’appropriation de la connaissance par la prise de note et le résumé. Et cela dans un cadre propice à la concentration (sans internet). Autrement dit il faut ARRETER avec les ordinateurs et powerpoints.
2) A qui la faute ? Des raisons fausses ou partielles :
Arrivé à ce moment de notre réflexion, il nous faut expliquer d’une part de la légèreté et la faible plus-value des cours enseignés en école et d’autre part le désintéressement total d’étudiants auparavant, pour la plupart, fort sérieux.
3 raisons – extérieures à la responsabilité des écoles – sont souvent avancées pour expliquer cette déchéance intellectuelle en école.
⦁ les étudiants, harassés à la suite de 2 à 3 ans de dur labeur en prépa, n’auraient plus ni l’énergie, ni la volonté de travailler.
⦁ le caractère plus pragmatique des nouvelles disciplines enseignées expliquerait à la fois leur superficialité ainsi que le désintérêt des étudiants.
⦁ la vie étudiante extrêmement importante en école de commerce réduirait à la fois l’intérêt et les capacités des étudiants à suivre les cours.
Ces raisons ne sont que partiellement vraies.
L’épuisement et les velléités festives des étudiants après la prépa me semblent exagérées. Toute personne ayant des amis en médecine sait qu’ils triment pendant toutes leurs études (lors de la 1ere année et de la 6e année notamment, avec 2 concours fort ardus et sélectifs : la PACES et l’ECN) mais aussi ensuite lors de leur internat et finalement…tout au long de leur vie professionnelle. Cette étude montre ainsi qu’un médecin généraliste travaille en moyenne 46h/semaine. Cela monte à 52h/semaine dans le Nord-Est de la France…tombent-ils pour autant dans la même léthargie intellectuelle que nous ? Non.
De même il ne me semble pas que les tout récents normaliens arrêtent de travailler une fois admis…alors même que la sélection pour rentrer à l’ENS est autrement plus forte.
Cette non-volonté de travailler est pourtant bien réelle. D’où vient-elle alors ? Selon moi à la fois du manque d’exigence des écoles (l’étudiant s’adaptant au niveau requis) et de cette fausse croyance qui pollue à la fois l’esprit des étudiants et de l’administration. Les uns pensent que leurs efforts passés légitiment leur désœuvrement actuel, les autres pensent la même chose et adaptent les cours en conséquence.
Un double changement s’impose ici : Changer les mentalités et rehausser les exigences.
Le 2e argument n’est pas plus pertinent. Certes, les disciplines enseignées en école de commerce ne bénéficient pas de la noblesse de celles enseignées en prépa. Il ne s’agit plus de partir en quête de la vérité physique, économique, historique ou encore métaphysique. L’objectif des disciplines étudiées est dorénavant plus prosaïque : il faut créer de la valeur, autrement dit faire du bif.
Pour autant, si l’objectif est moins attrayant (et encore, l’argent est pour beaucoup la raison même de leur orientation en prépa/école de commerce), la complexité de ces nouvelles disciplines existe bien. Du marketing à la finance en passant par le contrôle de gestion et la comptabilité, chacune de ces sciences de gestion a été institutionnalisée, possède sa propre chaire, son propre langage, ses propres concepts et théories ainsi que ses chercheurs. Autrement dit ces disciplines ont atteint un niveau de complexité suffisamment élevé pour que leur enseignement soit à la fois poussé et intellectuellement exigeant.
Les efforts consentis en prépa ainsi que la nature des disciplines étudiées sont donc insuffisants pour expliquer le constat décrit précédemment. La vie festive en école de commerce expliquerait-elle donc à elle seule le désintérêt des étudiant et la faiblesse des cours ?
Les dégâts sont incontestables. 3 semaines d’intégration, 3 semaines de campagnes, Wei, semineige, OB, Oktoberfest et autres, de par leur fréquence et la consommation de substances néfastes sur notre cerveau qu’elles entraînent, constituent un frein non négligeable à la capacité d’apprentissage et à la volonté d’apprendre.
Mais ces festivités excessives sont-elles la cause ou la conséquence de cette perte d’intérêt et de la faiblesse de l’apprentissage réalisé ? Un peu des deux sûrement. La solution est encore double ici :
D’une part rendre les cours suffisamment intéressants et avoir un niveau d’exigence suffisamment élevé pour que les étudiants, par envie ou par nécessité, étudient plus. D’autre part accepter les tristes conséquences physiologiques de l’alcool et du manque de sommeil sur le cerveau et organiser le calendrier de manière plus pragmatique, c’est-à-dire en distinguant très nettement les périodes de festivités intenses où la vie associative bat son plein, et les périodes de travail académique intense.
3) Rappel sur les particularités de l’enseignement en école de commerce et leurs quelques réussites
La particularité des écoles de commerce est qu’elles ne forment pas des universitaires destinés à des carrières académiques mais de futurs cadres qui iront travailler dans le monde de l’entreprise où les connaissances requises changent constamment et se doivent d’être un outil tourné vers la création de valeur, où les soft skills sont souvent plus importants que les hard skills.
Autrement dit les écoles de commerce se doivent de transmettre 4 choses :
⦁ des connaissances et des savoir-faire, première porte d’entrée dans le monde du travail
⦁ une capacité à se former soi-même constamment et efficacement
⦁ la capacité à partir de connaissances pour créer de la richesse
⦁ un certain savoir-être (les soft skills)
Les différents projets de groupe et l’importante vie associative font clairement partie des grandes réussites des écoles de commerce car elles permettent le développement des soft skills (et le réseautage) ainsi que la mise en œuvre de connaissances théoriques à des fins pratiques. Les nombreux stages renforcent encore plus cela. De plus, et on ne saurait le sous-estimer, les 3 ou 4 ans en école de commerce permettent de développer un certain état d’esprit favorisant la réussite dans le monde du travail ainsi que la capacité à entreprendre. La prépa avait élargi notre champ intellectuel, l’école de commerce élargit notre champ d’action.
Le grand échec des écoles de commerces se trouve malheureusement dans son incapacité à transmettre de réelles connaissances concrètes aux étudiants. Connaissances tant techniques (excel, photoshop, comptabilité, contrôle de gestion etc.) que théoriques (toutes les analyses en stratégie, en finance ou encore en « comportement et organisation » que l’on peut avoir). On acquiert des connaissances, mais celles-ci sont bien souvent superficielles et bien en deçà de ce que l’on pourrait espérer. Rares sont ceux qui peuvent se targuer d’une réelle expertise en Excel, Microsoft word, powerpoint, photoshop, comptabilité ou analyse financière. Et pour ceux qui ont cette expertise, l’ont-ils grâce à TBS ou par leur travail personnel et leur stage ? Or, au-delà du poids du diplôme et du réseautage, c’est aussi sur ces compétences que nous serons jugés sur le marché du travail.
4) Une ébauche de solution
On a précédemment fixé 4 objectifs d’apprentissage à l’école de commerce :
⦁ des connaissances et des savoir-faire, première porte d’entrée dans le monde du travail
⦁ une capacité à se former soi-même constamment et efficacement
⦁ la capacité à partir de connaissances pour créer de la richesse
⦁ un certain savoir-être (les soft skills)
Comme on l’a dit, les écoles de commerce se débrouillent remarquablement bien (en comparaison avec la fac notamment) pour nous transmettre la capacité à partir de connaissances pour créer de la richesse ainsi que pour la transmission d’un certain savoir être bénéfique sur les relations de travail et le réseau mais aussi et surtout sur la « capacité d’action » qu’elle donne à ses étudiants.
Les difficultés des écoles de commerce se situent surtout sur la transmission de réels savoirs et savoir-faire ainsi que sur la transmission d’une réelle capacité à « apprendre à apprendre » c’est-à-dire à s’adapter constamment aux nouveaux savoirs et savoir-faire nécessaires en entreprise.
Il s’agit donc de proposer des solutions permettant d’améliorer les points 1 et 2 sans nuire à la transmission des points 3 et 4. Autrement dit un retour aux méthodes et à la quantité de travail en prépa n’aurait aucun sens. Mais il est à fait possible de combiner un apprentissage poussé des savoirs et savoir-faire nécessaires en entreprise au développement des soft-skills et à la « mise en action » des étudiants. Cela commence par une définition claire des savoirs et savoir-faire à acquérir.
À suivre

par thinktank | 26 septembre 2017 | Think Tank Averroes
La véritable blitzkrieg mise en place par l’équipe d’Emmanuel Macron durant la campagne laisse aujourd’hui place à un vrai vide politique. Entre la déliquescence de l’opposition et l’amateurisme du groupe parlementaire, les conséquences de la victoire jupitérienne se font ressentir sur l’ensemble du paysage national. Soubresauts d’une vie politique marquée par les affaires, l’élection du désormais Président Macron marque le changement d’une époque. Il faut dire que son accession au trône de la République fut chose aisée. Entre une gauche déchirée par 5 ans de Hollandisme et un parti de droite décimé par les affaires Fillon un véritable boulevard s’est ouvert pour le candidat Macron. Cet alignement, (suspect ?), des planètes a permis au candidat et à son équipe d’atteindre l’Elysée.
Alors que la rentrée gouvernementale s’est déroulée le 28 août, il convient de faire un premier état des lieux de la présidence Macron. C’est en effet une réorganisation sociétale et politique qui avait été promise et celle-ci a bien eu lieu. Un programme ouvertement néo libéral, apparition d’un nouveau groupe parlementaire, implosion de tout groupe d’opposition, remodelage de la stature présidentielle -pour un retour à une image historique du président monarque- sont les apanages de la, nouvellement, Start-Up nation.
Un parti à l’image du Roi
« J’ai mis du temps, j’ai réfléchi, j’ai associé beaucoup de gens et j’ai décidé qu’on allait créer un mouvement politique nouveau. ». C’est par ces mots que commence Emmanuel Macron son allocution lors de la soirée de lancement de son parti En Marche ! (EM). Quoi de plus logique qu’un mouvement portant les initiales du maître pour montrer le véritable enjeu de celui-ci ? S’affranchissant de la barrière gauche/droite, l’ancien Ministre laissera flotter le (faux) doute quant à ses intentions pour 2017. A partir de ce moment, la machine En Marche ! était lancée. 15 millions d’euros levés auprès d’investisseurs en tout genre (banquiers, entrepreneurs, personnalités…) -révélés par les Macronleaks[i]-. 15 millions d’euros pour qu’un parti se forme ex-nihilo.
L’incroyable bulldozer EM s’est créé sur un espoir apporté à la base militante : l’espoir d’une plus grande démocratie participative, d’un renouvellement d’une classe politique âgée et attachée à ses privilèges. Il convient de constater qu’En Marche ! -devenue La République En Marche (LREM)- est tout sauf un exemple de démocratie participative. La fronde des militants face à la centralisation des décisions se fait de plus en plus grande[ii]. Cette grogne s’est notamment révélée lors des législatives ou les candidats ont été choisis depuis Paris. Cette décision fait fit de toute réalité de terrain, mais surtout du travail des militants fait non pas pour le mouvement, mais pour un idéal. En somme, LREM fait comprendre à ses militants qu’elle n’est pas qualifiée pour décider, mais juste exécuter les tâches ingrates de la campagne.
La figure d’Emmanuel Macron est centrale dans l’organisation du parti. En centralisant chaque décision, chaque nomination, c’est bien le désormais Président de la République qui décide d’absolument tout. Le Roi Macron place les pions de sa majorité, une majorité malléable qui ne se rebellera pas, à l’instar des frondeurs du Hollandisme. Le Fantasme de la démocratie directe prend fin avec le couronnement du monarque le 14 mai 2017. Dans la France macronnienne, le peuple se voit confisqué le pouvoir et c’est bien l’exécutif qui choisit le législatif, non le peuple.
Une majorité (dis)qualifiée
Cette formation LREM façonnée par l’architecte Macron est directement issue de la société « civile ». Avec une très large majorité, à laquelle le groupe des Constructifs se sont ralliés (par opportunisme ?), le Président a les coudées franches pour adopter son projet de société. Ce ne seront pas les 46 députés PS/PRG/DVG, les 118 députés LR/DVD ou même les 8 députés FN[iii] qui empêcheront quelconques réformes de passer. Il faut reconnaître que Macron a réussi son pari : décomposer totalement l’élite et le paysage politique français ainsi que mettre un terme au bipartisme en France.
La rapidité d’exécution du plan Macron entraine néanmoins de nombreux problèmes. En effet la politique nécessite clairement une certaine expérience, permettant de connaître les arcanes du pouvoir. La politique est professionnalisée car profonde et complexe. Même s’il faut dénoncer ceux qui s’accrochent indéfiniment à leurs mandats, un total néophyte ne pourra exercer pleinement ses fonctions. Ces professionnels, avec leurs connaissances, avaient les moyens de mettre des bâtons dans les roues à l’exécutif. Le Président Macron l’a bien compris. En propulsant des néophytes aux portes du pouvoir législatif, celui-ci s’assure de leur loyauté et surtout nomme leurs conseillers et chefs de cabinets, perpétuant ainsi la phagocytose du pouvoir par une certaine élite, formée dans les mêmes écoles et par les mêmes instances. En somme, LREM a mis sur pied le parlement si cher à Boris Eltsine « Un bon parlement, un parlement qui vote les lois et qui ne fait pas de politique. ». Il en résulte une réelle cacophonie au Parlement, illustrant le parfait amateurisme de ces députés[iv], qui se fait aussi ressentir en dehors de l’hémicycle. Ces députés qui se sentent hors-système, sont bien partie intégrante du système, ce qu’ils n’intègrent -ou font semblant- toujours pas. Cette stratégie vise à la domination de la classe bourgeoise propriétaire et parfaitement intégrée dans la mondialisation, représentée par les députés de la majorité. Il ne fait aucun doute que LREM nous gratifiera d’autres coquecigrues similaires au cours du mandat 2017-2022.
La situation n’est pas non plus reluisante à Matignon et dans les différents ministères. Avec un Premier Ministre rallié sur le tard, Edouard Philippe manque encore de crédibilité aux yeux des Français, de sa propre majorité et surtout aux yeux des militants. Ses ministres manquent de l’expérience du pouvoir et déjà des affaires remontent, mettant à mal ces ministres qui « n’ont rien à se reprocher »[v].
De l’hyperprésence du candidat à l’hypoprésence du Président
Durant la campagne, c’est aussi l’image que le candidat Macron avait voulu donner. Transparence sur sa vie, sur son niveau d’imposition… On peut dire que le candidat brillait par sa volonté de se rapprocher de ces militants et électeurs. Mais l’élection en tant que Président marque un revirement abrupt de la stratégie de communication du couple désormais présidentiel. Parole rare de la figure suprême de la nation, apparitions millimétrées et silencieuses, pensée trop « complexe » pour être partagée… le Président Macron se fait remarquer par son absence. Cependant, cette absence n’est que physique. En effet le Président jupitérien brille par son omniprésence dans l’absence. On voit la main et la décision de l’Elysée partout. Cette schizophrénie macronnienne est l’une des causes de la chute de la confiance des français envers le couple de l’exécutif.
Et soudain, une clameur se fit entendre : « Jean-Luc bomaye »
On peut alors se demander à qui profitera cette défiance envers le Président et son Premier Ministre. Il est clair que l’opposition dite traditionnelle n’est plus dans la course. Après leur auto-sabordage, Les Républicains (LR) et le Parti Socialiste (PS) ne sont même plus comptés comme des forces politiques majeures. Les dernières gesticulations des Républicains pour la course à la tête du parti ressemblent plus à des soubresauts funestes d’un ancien colosse dépassé par la « marche du progrès » qu’à un vrai parti politique.
Il en est de même pour le Front National (FN). Après l’incroyable espoir qui avait traversé ses rangs au soir du premier tour (21,30%)[vi], le retour à la réalité fut rapide, mais surtout brutal pour les militants du Front. Au soir du débat du deuxième tour, les conseillers et militants ont pu admirer le naufrage du navire FN en direct à la télévision. Le capitaine Marine Le Pen (MLP) montra à la France entière son incompétence, son manque de préparation et son incompréhension des débats sociétaux ainsi qu’internationaux actuels. Après un résultat plus que décevant aux législatives, MLP tente aujourd’hui de s’incarner comme une force d’opposition majeure. Force est de constater qu’encore une fois, elle échoue et se donne en spectacle à Brachay. Ses troupes n’y croient plus et MLP entérine la fin du FN[vii], aidé par son fidèle ex-lieutenant Philippot qui claque la porte.
Seul Jean-Luc Mélenchon et sa France Insoumise (FI) semblent bénéficier de vents favorables, à l’orée de cette nouvelle ère[viii] qu’incarne la présidence Macron. Jouissant d’une popularité croissante, le groupe FI multiplie les coups de communications et s’impose petit à petit comme étant la formation d’opposition de ce mandat. L’émergence de nouvelles figures, tel Adrien Quatennens, renforce cette importance. D’ailleurs le groupe se tient prêt à prendre les rênes du pouvoir au cas où le peuple français désapprouverait massivement le Président Macron. Néanmoins, on peut s’interroger sur la réelle possibilité pour le groupe FI de gouverner. Les promesses de campagnes et autres convictions résisteraient-elles à la réalité du pouvoir ? Rien n’en est moins sûr.
Finalement, l’élection d’Emmanuel Macron à la tête du pays bouleverse aussi bien les équilibres politiques que l’organisation du pouvoir. Son projet de société vise à altérer en profondeur les « dysfonctionnements » qui empêchent la France de retrouver la voie du « progrès et de la croissance ». Un véritable chambard sociétal est En Marche !. Le Président aura à faire pour remonter la pente et faire oublier ses erreurs de début de mandat. Néanmoins, un groupe peut tirer son épingle du jeu politique actuel, c’est celui de la France Insoumise. Il y a forte à parier que les députés de la FI ne retiendront leurs coups face à un Jupiter acculé dans les cordes du ring politique.
[i]https://www.mediapart.fr/journal/france/210517/macron-leaks-les-secrets-dune-levee-de-fonds-hors-norme?onglet=full
[ii]http://www.francetvinfo.fr/politique/emmanuel-macron/info-franceinfo-des-adherents-en-marche-en-colere-contre-le-manque-de-democratie-interne-ecrivent-a-macron_2363305.html#xtor=CS1-746
[iii]https://www.marianne.net/politique/resultats-definitifs-elections-legislatives-2017-voici-la-nouvelle-assemblee-nationale
[iv]http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/07/27/des-deputes-de-la-majorite-rejettent-par-erreur-un-article-de-la-loi-de-moralisation_5165841_823448.html
[v]http://www.bfmtv.com/politique/macron-a-las-vegas-penicaud-martele-n-avoir-rien-a-se-reprocher-1213169.html
[vi]http://www.lemonde.fr/data/france/presidentielle-2017/
[vii]http://www.lemonde.fr/politique/article/2017/09/09/marine-le-pen-fait-sa-rentree-politique-a-brachay_5183348_823448.html
[viii]http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=3831

par thinktank | 7 octobre 2016 | Géopolitique, TBS Press, Think Tank Averroes
Lié d’amitié avec d’anciens SS, cheville ouvrière de la CIA en Asie orientale, confident des dictateurs et complice de G.W Bush, le Dalaï-lama est-il vraiment un parangon de sagesse ?
 |
|
Nos lecteurs suffoquent, comment oserions-nous nous attaquer à cet Océan de Sagesse, ce parangon de spiritualité et de vertu dont la présence dans nos contrées est invariablement saluée comme la quintessence de la paix ?
Nous pourrions feindre de ne pas percevoir cette duplicité douteuse chez notre sujet, cette propension à n’incarner qu’accessoirement le bodhisattva de la compassion, au profit idéologique et stratégique d’un dessein géopolitique impérial.
Il n’en sera rien, nous voici lancés dans une tentative d’épuisement d’un lieu tibétain, fort jalousé par les acteurs géopolitiques qui dessinent depuis des siècles son destin et celui de son meneur spirituel, le Dalaï-lama.
Tenons-nous d’abord à exprimer avec clarté le but poursuivi dans cette démarche analytique : il ne s’agit pas de pourfendre ou de mésestimer la réalité de la culture tibétaine, sa richesse, et les croyances qui lui sont propres depuis des siècles. Nous aspirons à une certaine neutralité axiologique dans l’analyse du Tibet comme objet de convoitise géopolitique.En premier lieu, étonnons-nous de la fréquence et de l’ampleur de la couverture médiatique dédiée à ce territoire lointain, distant de Paris de 9300 kilomètres. Notre lectorat a toujours été exposé à un nombre intarissable de campagnes de sensibilisation à la cause tibétaine, il n’est d’ailleurs pas exclu que certains aient un jour porté un drapeau tibétain dans une de ces manifestations le plus souvent organisées par des non-tibétains et hors du territoire tibétain. La médiatisation des immolations de prêtres tibétains à travers le monde et l’érection du Dalaï-lama comme figure de proue de la paix ont-elles des raisons moins humanitaires que géopolitiques ? Voici quelques éléments de réponse.

Le Dalaï-lama, figure controversable de la paix ?
« Un des défis pour notre nation est de garder pure la race tibétaine » Sandhong Rimpoché, premier ministre du gouvernement tibétain en exil de 2001 à 2011, fermement opposé au mariage mixte, entre tibétains et non-tibétains.
« L’activité de la CIA au Tibet se compose d’une action politique, de propagande et d’activité paramilitaire. Le but du programme est de maintenir le concept politique d’un Tibet autonome (…) et de construire une capacité de résistance aux développements politiques possibles à l’intérieur de la Chine » extrait du programme de la CIA au Tibet*
Il s’agit d’abord de rappeler ce qu’est le Tibet avant 1950, une théocratie esclavagiste au sein de laquelle les nobles et les moines peuvent utiliser les jeunes garçons comme partenaires sexuels. Un territoire sur lequel l’espérance de vie est de 35 ans, le taux d’analphabètes est de 90%, la torture (sévices, amputations) est réservée aux contrevenants aux règles de vie imposées par la Caste au pouvoir, moines largement compris.
En 1959, la CIA organise la fuite du Dalaï-lama – Tenzin Gyatso – hors du Tibet*. Entre 1959 et 1964, des commandos tibétains sont entraînés par les services américains pour combattre la Chine*, sans succès puisqu’ils ne bénéficient pas du soutien de la population qui ne souhaite pas le retour de la théocratie.
Les indiens rechignent à accueillir des réfugiés tibétains, Nehru conclue un accord avec Eisenhower : L’Inde accueillera le Dalaï-lama et ces réfugiés, en échange, les Etats-Unis fourniront la technologie nucléaire aux indiens. La première bombe nucléaire indienne sera nommée « Bouddha souriant ».* *
Les Etats-Unis, par le biais de la CIA, du Département d’Etat et du Pentagone vont mettre en place un « Programme tibétain »* qui coûtera à la CIA, entre 1951 et 1972, presque deux millions de dollars annuels*. Ce plan consiste à organiser la résistance tibétaine face à la chine, par des moyens de « complots politiques, de propagande et de support paramilitaire »
Suite à la fin de ce plan, la NED (National Endowment for Democracy) prendra le relais. Cet organisme vise à promouvoir la paix dans la monde, en théorie. Concrètement, elle est le bras armé de la géopolitique étasunienne parallèle. Son fondateur, Allen Weinstein, a déclaré au Washington Post que « Bien des choses faites pas la NED maintenant étaient faites clandestinement par la CIA il y a 25 ans ».
Le Dalaï-lama obtiendra la médaille de l’ « honneur » de la part de la NED en 2010, pour services rendues à la « défense de la démocratie et des droits de l’homme ».* *
Parmi les amitiés du Dalaï-lama, on notera avec profit ses accointances avec des pures produits de l’Allemagne nazie. Heinrich Harrer fit partie de l’expédition allemande au Tibet (1938-1939)* placée sous la direction d’Himmler et de l’Institut d’anthropologie raciale allemand. Il sera un précepteur du Dalaï-lama. Adhérant à la SS en 1938 (unité SS 38, matricule 73896), membre des chemises brunes depuis 1933, il a une vision du monde bien particulière.
 |
|
Son ami, Bruno Berger, capitaine SS et élève du raciologue Clauss, sélectionna notamment des déportés juifs à Auschwitz pour mener des expériences scientifiques. Il a noué pendant son séjour au Tibet de nombreuses amitiés avec l’aristocratie tibétaine, notamment la famille du Dalaï-lama. Il rencontrera à nouveau le Dalaï-lama en 1983, 1984, 1985, 1986 et 1994. En 1994, il signe à Londres et aux côtés de son ami Harrer et du Dalaï-lama un document déclarant le Tibet comme « pleinement souverain avant 1950 ». Le même Berger publiera un livre intitulé « Mes rencontres avec l’Océan de Sagesse ».*
Nous passerons sur les amitiés avec Miguel Serano, chef du parti nazi chilien ou avec Jorg Haider, furieux nostalgique du 3ème Reich.
Que penser enfin de la demande formulée par le Dalaï-lama pour la libération de Pinochet* ? Ou encore de son soutien à son ami de toujours, George W.Bush, dans l’invasion de l’Irak* (violant tous les principes fondamentaux du droit international et provoquant plus d’un million de morts) ?*
Concrètement, le Dalaï-lama et son entourage proche est historiquement inféodé à la CIA, au département d’Etat et au Pentagone*, des institutions qui ont une conception de la paix Bien à elles.

Il est indispensable de retracer rapidement l’Histoire des relations entre le Tibet et la Chine pour mettre en perspective ce soutien américain au Tibet et au Dalaï-lama. Le Tibet fait partie intégrante du territoire national chinois, il n’a été indépendant qu’entre 622 et 842. Sa présumée indépendance entre 1913 et 1950 n’a été reconnue par aucun Etat, et n’avait aucune valeur dans le droit international. Parler d’une « annexion » du Tibet parait donc abusif, ce territoire ayant toujours été rattaché au territoire chinois. a toujours oscillé entre une position de faiblesse-soumission à la Chine dans les périodes d’apogée de celle-ci et une position de révolte indépendantiste lorsque la Chine connaissait des déboires. En 1911, la Chine sombrait après le renversement de la dynastie mandchoue, le Tibet en profita par le biais de son XIIIe Dalaï-lama pour proclamer son indépendance en 1913. Après la prise de pouvoir des communistes en Chine, celle-ci se lança dans la reconquête du Tibet, en 1950. C’est là que le rôle des Etats-Unis deviendra majeur. Dans un premier temps, les stratèges étasuniens vont chercher à disposer d’une assise hautement stratégique en Asie Orientale, au cours de l’Histoire, d’abord dans une stratégie d’endiguement du communisme, puis dans le contexte actuel de guerre économique et géostratégique contre une puissance en mesure de menacer l’ordre hégémonique étasunien.
Enfin, le Dalaï-lama actuel a son successeur politique* parmi les membres de sa communauté en exil. Celui-ci se nomme Lobsang Sangay* et n’est pas vraiment connu pour avoir des relations privilégiées avec les gouvernements russes ou chinois. En effet, il a été l’heureux bénéficiaire d’une Bourse Fullbright*, financée par le Département d’Etat Américain et intimement lié à la CIA, il a étudié à Harvard et vit aux Etats-Unis en tant que premier ministre du Tibet en exil*. Un palmarès qui lui vaudra sans aucun doute la sympathie de l’ensemble des représentants politiques et médiatiques atlantistes.
Le Tibet, verrou stratégique incontournable
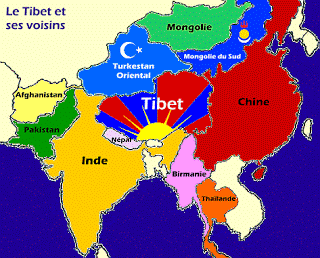
Géographiquement, le Tibet repose sur de hauts plateaux qui culminent entre 4000 et 5000 mètres d’altitude, ces plateaux offrent à toute puissance le contrôlant une position haute le long d’une frontière sensible, à la charnière de la Chine, du monde indien et de l’Asie centrale.
Ces hauts plateaux sont le lieu idéal pour disposer des engins balistico-nucléaires pour épauler l’allié Pakistanais et tenir en respect l’Union indienne (cf l’escalade militaire Inde-Pakistan).
Au plan énergétique, l’importance du Tibet n’est pas moindre. Il héberge la source et le cours supérieur de tous les grands fleuves d’Asie orientale, il s’agit en somme du Château d’eau qui permet à la Chine de sécuriser ses approvisionnements hydrauliques.
Le Tibet est également une source de matières premières de premier choix pour Pékin. Ses sols sont riches en bois, charbon, pétrole et minerais (dont uranium et or). L’ouverture d’une ligne de chemin de fer entre Pékin et Lhassa en 2006, ne doit rien au hasard.
 Il existe une analogie géopolitique qui permet d’illustrer les conséquences d’une possible indépendance du Tibet (indépendance qui serait reconnue par les Nations Unies). Il s’agit du Kosovo, cet Etat-OTAN dont la création n’a été possible que dans la mesure où les Etats-Unis et vassaux assimilés ont soutenu le mouvement terroriste dirigé par Hashim Thaçi (UCK)*. L’indépendance de ce territoire vis-à-vis de la Serbie permit la création d’une immense base américaine, la plus grande d’Europe, dans la région hautement stratégique des Balkans*. Ce soutien participe donc de la volonté d’encerclement des Etats les plus susceptibles de contrarier les plans géopolitiques étasuniens, à savoir la Chine et la Russie, en contestant même les territoires qui leur sont intrinsèquement liés par le biais de l’intégration à l’OTAN-Union européenne.
Il existe une analogie géopolitique qui permet d’illustrer les conséquences d’une possible indépendance du Tibet (indépendance qui serait reconnue par les Nations Unies). Il s’agit du Kosovo, cet Etat-OTAN dont la création n’a été possible que dans la mesure où les Etats-Unis et vassaux assimilés ont soutenu le mouvement terroriste dirigé par Hashim Thaçi (UCK)*. L’indépendance de ce territoire vis-à-vis de la Serbie permit la création d’une immense base américaine, la plus grande d’Europe, dans la région hautement stratégique des Balkans*. Ce soutien participe donc de la volonté d’encerclement des Etats les plus susceptibles de contrarier les plans géopolitiques étasuniens, à savoir la Chine et la Russie, en contestant même les territoires qui leur sont intrinsèquement liés par le biais de l’intégration à l’OTAN-Union européenne.
Un simple regard porté sur la carte des bases de l’OTAN dans le monde permet de s’en assurer définitivement.
Après des décennies de bons et loyaux services de la part des Grandes Puissances, le Dalaï-lama offre les siens en défendant corps et âme l’Union européenne et la doctrine impériale étasunienne, œuvres qui nous subjuguent chaque jour que Dieu fait par leur dimension pacifique et démocratique.
En définitive, que reste-t-il de la dimension humanitaire et spirituelle du Dalaï-lama lorsqu’on daigne s’intéresser au réel géopolitique ?
Think Tank Averroès
Source principale : https://www.upr.fr/actualite/31-mars-1959-31-mars-2015-il-y-a-56-ans-la-cia-organisait-levacuation-du-dalai-lama-du-tibet
Note informative:Tous les éléments, documents, sources et faits rapportés dans le présent article émanent directement des plus hautes institutions des Etats-Unis (Maison Blanche, Département d’Etat, Pentagone, CIA) et de sources recoupées par les journaux jugés les plus sérieux.Leur véracité n’est pas de nature à être remise en cause. Néanmoins, par déontologie, nous encourageons nos lecteurs à faire preuve de perspicacité et ainsi à vérifier systématiquement ces sources.









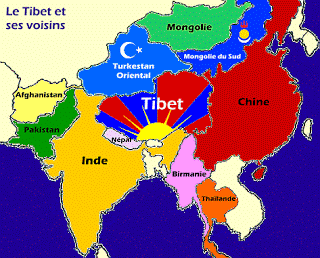

Commentaires récents